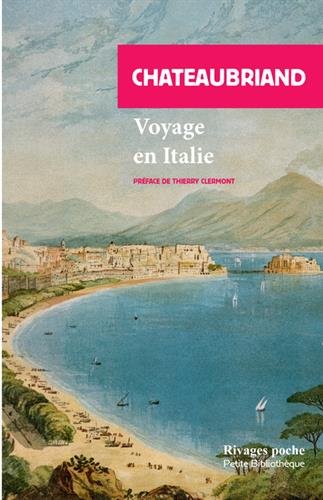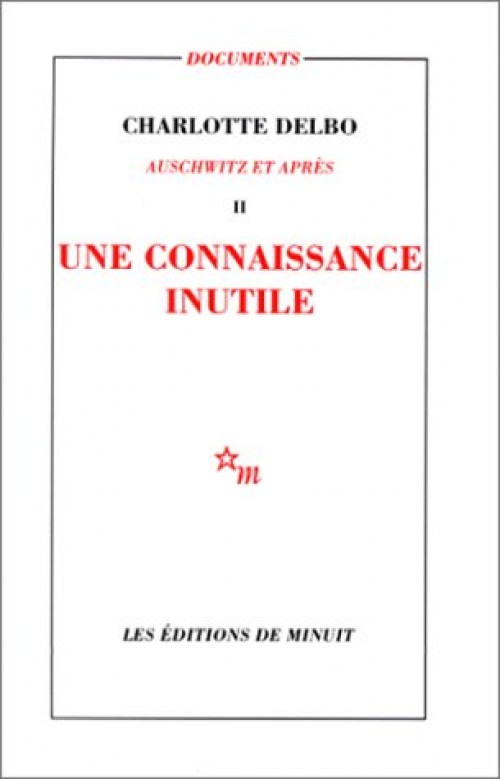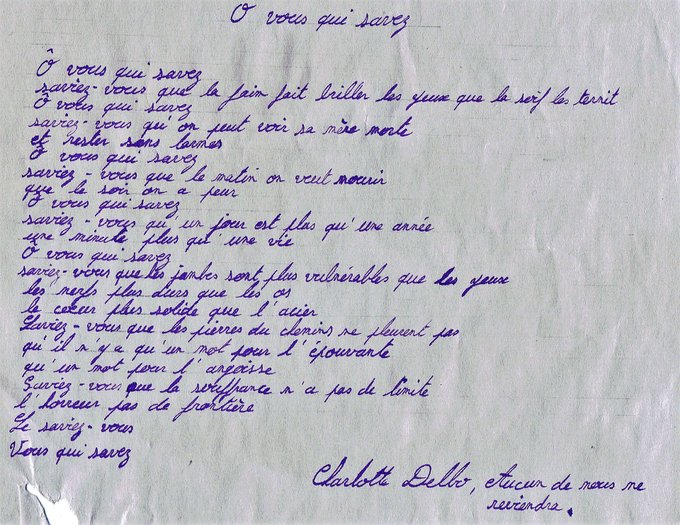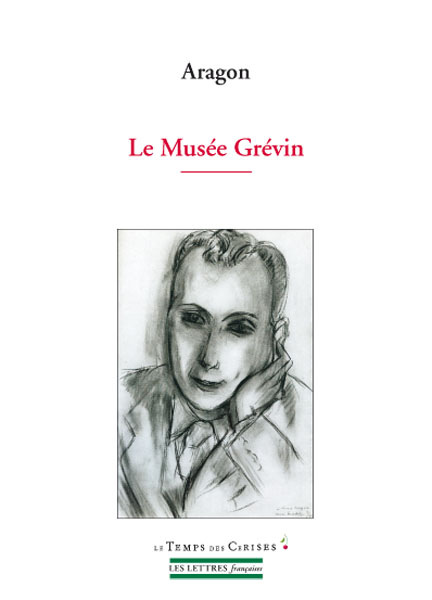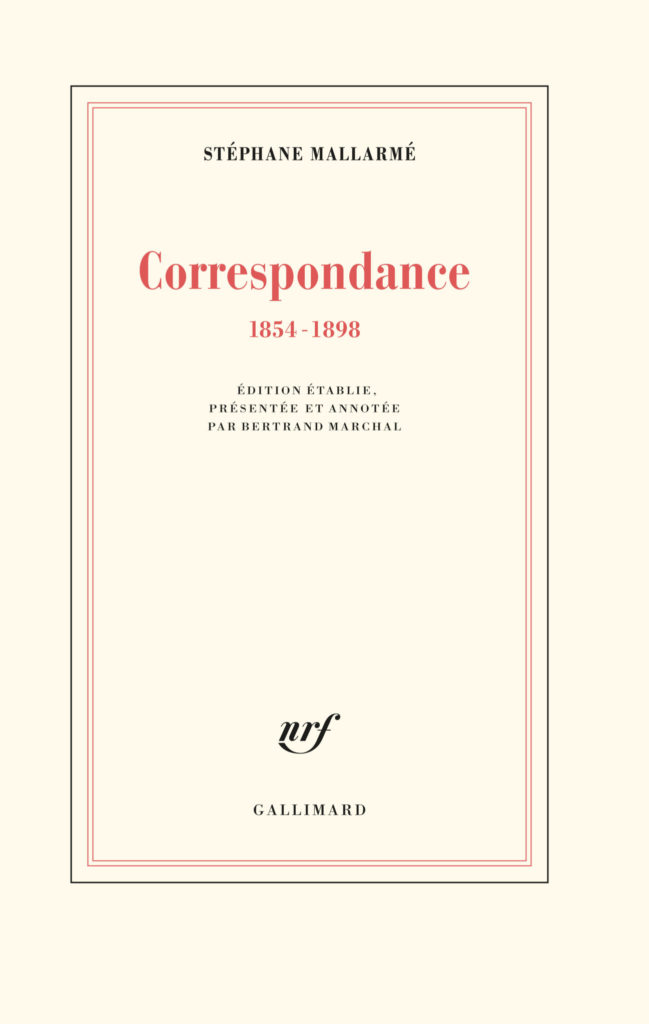Ah le vers entre mes mains mes vieilles mains gonflées nouées de veines se brise et l’orage de la prose sillonnée de grêle et d’éclairs
s’abat toute mesure perdue sur le poème lâché comme un chien débridé qui court à droite et à gauche flairant tournant cherchant la rime
tombée à terre et cela fait un joli désastre tout ce verre de Venise en morceaux où la bête échappée hurle à douleur et le sang paraît à ses pattes si bien qu’il n’y a plus qu’à se laisser emporter par le torrent par le langage sans autre frein que la souffrance le souffle le cœur défaillant la chute et les genoux couronnés la sueur tout le long du corps détraqué qu’occupe un bondissement déréglé dans sa cage d’os
la guerre c’était hier car quarante ans ça passe vite sur la carcasse la guerre d’il y a quarante ans et cette autre qui vint en l’an quarante est-ce que nous ne sommes pas tous les enfants de ce monstre qu’on croit mort à chaque fois qu’il n’est qu’endormi n’avons-nous pas au front de notre tête au fond de notre chair à notre nuque prête à ployer à nouveau la marque du monstre dont nous sommes sortis la guerre
et nos bouches pâles parlent contre le ventre qui nous a portés qui nous a faits à sa semblance horrible et rien n’est plus pacifique à l’entendre que le soldat couvert du sang versé qui jure que c’est fini plus jamais plus jamais il ne versera le sang d’autrui même si on lui joue de la musique même si on lui raconte des histoires de fantômes si on lui donne de belles bottes neuves pour cacher cette tristesse des pieds las
la guerre c’est de la guerre que je parlais quand la prose s’y est mise comme la misère sur le pauvre monde et bien sûr que tout me paraît pauvre enfantin qui s’arrête au bout de quelques syllabes comme un qui balbutie pour dire l’énorme dévastation mais la prose la prose ici croyez-m’en ce n’est pas l’impuissance à décrire l’horreur ici qui la ramène écumante soufflante haletante hors d’elle animal traqué ce n’est pas la guerre hors d’échelle toujours et toujours dévorante ce n’est pas la guerre la mémoire le spectre de ce qu’elle fut et j’ai vu la Woëvre à tombe ouverte j’ai vu la Champagne dépouillée de gencives sur ce ricanement de squelette et la forêt d’Argonne avec l’épouvante des patrouilles égarées les sables la tourbe de la Somme et le long dos d’âne disputé du Chemin des Dames cette arête vive du massacre et j’ai vu l’intermède espagnol jetant ses cadavres sur la route et Valence nocturne et bleue Madrid plein de coups de feu le torrent d’hommes qui reflue aux défilés avec les larmes de l’enfance au Boulou tout ce retour d’apocalypse préfigurant les mille nationales de la mort leurs détours et leurs stratagèmes de Tirlemont à Angoulême ô noyés de Dunkerque cimetière de proues ô cohue aux ponts de la Loire et le Piège sur les fuyards refermé que des oiseaux de feu jubilant cernent et piquent sont-ce les jeux du cirque et le pas de fer des chars me dispense enfin de compter sur mes doigts l’ânonnement alexandrin non ce n’est pas la guerre je vous dis ce n’est pas
la guerre abattant sur moi cette trombe ce déferlement qui ne sait d’où il vient où il va ce qu’il fait qui me roule m’ emporte me traîne me rejette et me reprend me met en pièces me balaye et me balance m’enlève au haut de sa vague et je tombe je tombe je tombe de son retrait ce n’est pas la guerre je vous dis mais la vie ma vie notre vie
simplement la vie de tous les jours qui ne s’arrête pas quand j’écris un poème la prose de tous les jours la haine de tous les jours la nuit de tous les jours la mise en pièces coutumière un mal banal à chaque respiration réinventée la douleur mesquinement immense et que disais-je
Et le pis est qu’à tous les pas je heurte contre ce que j’aime
et le pis est que la déchirure passe par ce que j’aime et que c’est dans ce que j’aime que je gémis dans ce que j’aime que je saigne et que c’est dans ce que j’aime qu’on me frappe qu’on me broie qu’on me réduit qu’on m’agenouille qu’on m’humilie qu’on me désarçonne qu’on me prend en traître qu’on fait de moi ce fou ce perdu cette clameur démente et le pis est que chaque mot que chaque cri chaque sanglot comme un écho retourne blesser d’où il sort et cette longue peur que j’ai de lui comme un boomerang inhumain suivez sa courbe en haut de l’air et voyez donc comme il revient le meurtrier par une merveille physique
comme il revient frapper d’abord ce que je voulais protéger ce dont j’écartais son tranchant son cheminement assassin ce qui m’est plus cher que ma chair et le dedans de ma pensée ce qui m’est l’être de mon être ma prunelle ma douceur ma joie majeure mon souci tremblant mon haleine mon coeur comme un oiseau tombé du nid ma déraisonnable raison mes yeux ma maison ma lumière ce par quoi je comprends le ciel la feuille l’eau départagés le juste et l’injuste écarté de ses brumes le bien et comme le baiser d’une aube la bonté
Laissez-moi laissez-moi je ne puis pas voir souffrir ce que j’aime et je dis des choses sans lien comme des plaies ouvertes et je pose des simples sur les brûlures je propose des remèdes usés je répète les mots des anciennes superstitions oubliées je refais les gestes des rebouteux je mets la maladresse de mes doigts où cela souffre et ce vent qui traverse ma lèvre dérisoire l’imbécile qui croit dire ce que cela fait en moi quand je détourne la lâcheté de mes yeux laissez-moi je ne puis pas voir souffrir ce que j’aime je fais souffrir ce que j’aime à refuser de le voir souffrir je ne puis pas je ne puis pas que ce soit moi du moins qui flambe et grille et me torde écartelez-moi je vous en supplie moi seul écorchez-moi laissez-moi souffrir pour ce que j’aime donne -moi ta main donne-moi ton mal passe-moi le feu qui t’habite passe-moi ce feu qu’il te quitte et qu’il se mette à se nourrir de moi de moi seul de mes fibres mes muscles mes nerfs que je l’emporte loin de toi que je l’emporte ah laissez-moi le détourner dans mes bras contre mon ventre l’enserrer qu’il se propage à mes entrailles qu’il me morde moi et nul autre moi changé en signal en torche en incendie en cendres ah pluie étouffante des cendres brûlante pluie enfin qui va descendre pluie de moi seul à la fin consumé
Laissez-moi la tourmente des phrases fait voler des bouts de papier griffonnés des sortes de papillons noirs et bruns les vestiges d’hier une écriture déchirée
Nul ne peut lire les mots de l’encre après la flamme ni
que cette poussière qui retombe ne fut qu’une longue une seule une interminable lettre amour interminée»
Le roman inachevé, 1956.