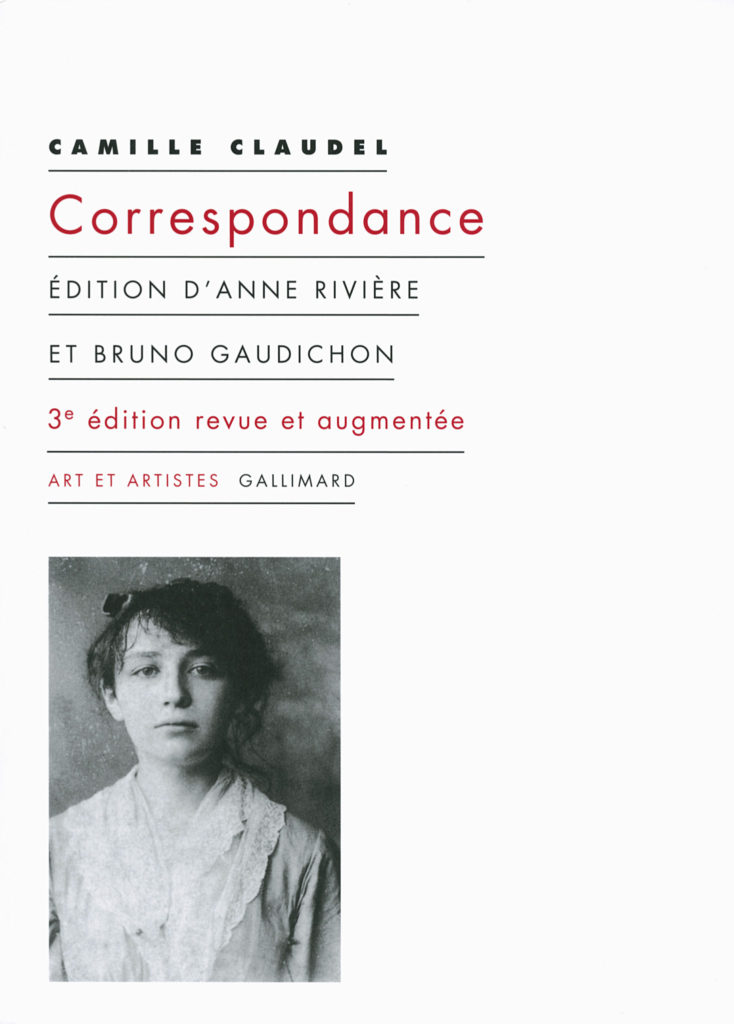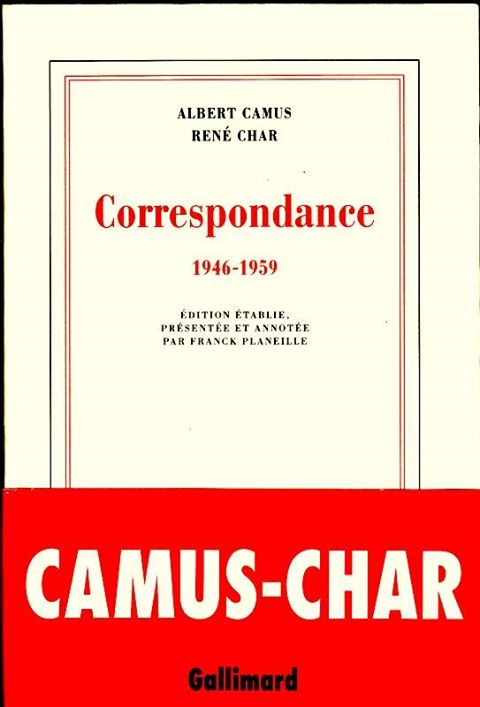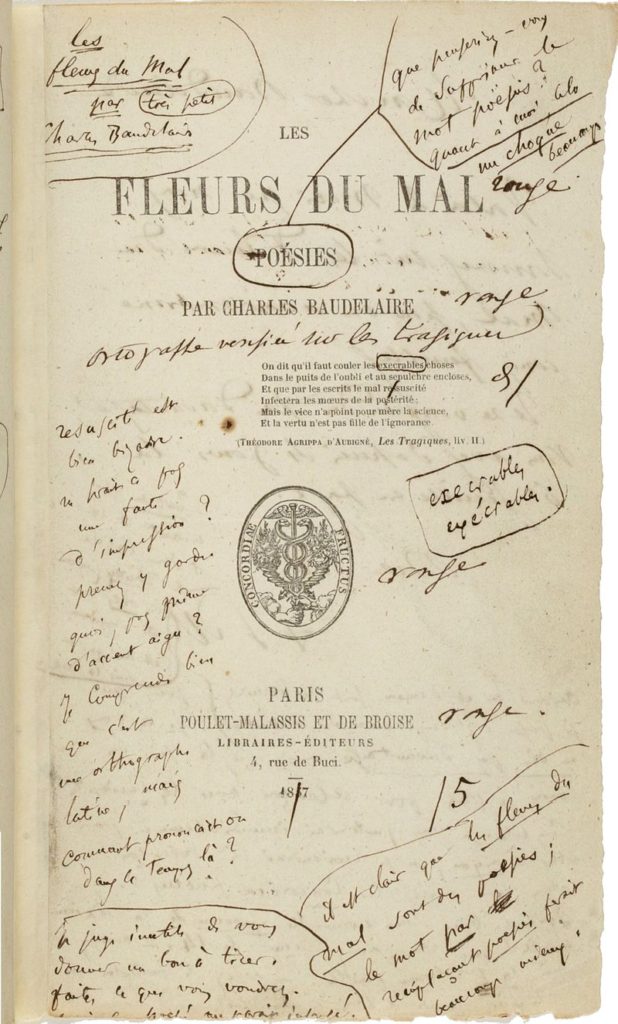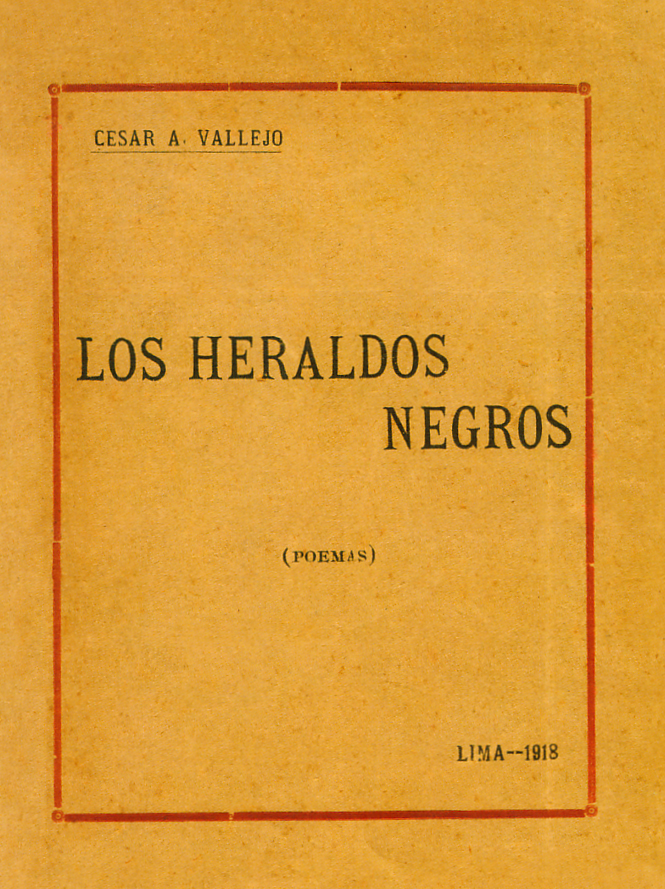Le poète chilien, Pablo Neruda, Prix Nobel de littérature 1971, visita Machu Picchu le 22 octobre 1943 avec sa seconde épouse Delia del Carril.
El poeta chileno, Pablo Neruda, Premio Nobel de literatura en 1971, visitó Machu Picchu el 22 de octubre de 1943 con su segunda esposa Delia del Carril.
“Pero antes de llegar a Chile hice otro descubrimiento que agregaría un nuevo estrato al desarrollo de mi poesía.
Me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Machu Picchu. Ascendimos a caballo. Por entonces no había carretera. Desde lo alto vi las antiguas construcciones de piedra rodeadas por las altísimas cumbres de los Andes verdes. Desde la ciudadela carcomida y roída por el paso de los siglos se despeñaban torrentes. Masas de neblina blanca se levantaban desde el río Wilcamayo. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra; ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos.
Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto.
Allí nació mi poema “Alturas de Machu Picchu”.
Pablo Neruda, Confieso que he vivido, 1974.
Alturas de Machu Picchu
XII
Sube a nacer conmigo, hermano…
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.
Mírame desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado,
porque la joya no brilló o la tierra
no entregó a tiempo la piedra o el grano:
señaladme la piedra en que caísteis
y la madera en que os crucificaron,
encendedme los viejos pedernales,
las viejas lámparas, los látigos pegados
a través de los siglos en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche,
como si yo estuviera con vosotros anclado,
contadme todo, cadena a cadena,
eslabón a eslabón, y paso a paso,
afilad los cuchillos que guardasteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano,
como un río de tigres amarillos,
como un río de tigres enterrados,
y dejadme llorar, horas, días, años,
edades ciegas, siglos estelares.
Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.
Acudid a mis venas y a mis bocas.
Hablad por mis palabras y mi sangre.
Canto General, 1950.
Les Hauteurs de Machu Picchu
XII
Monte naître avec moi, mon frère.
Donne-moi la main, de cette profonde
zone de ta douleur disséminée.
Tu ne reviendras pas du fond des roches.
Tu ne reviendras pas du temps enfoui sous terre.
Non, ta voix durcie ne reviendra pas.
Ne reviendront pas tes yeux perforés.
Regarde-moi du tréfonds de la terre,
laboureur, tisserand, berger aux lèvres closes:
dresseur de tutélaires güanacos:
maçon de l’échafaudage défié:
porteur d’eau de larmes andines:
joaillier des doigts écrasés:
agriculteur qui trembles dans la graine:
potier répandu dans ta glaise:
apportez à la coupe de la vie nouvelle
vos vieilles douleurs enterrées.
Montrez-moi votre sang, votre sillon,
dites-moi: en ce lieu on m’a châtié
car le bijou n’a pas brillé ou car la terre
n’avait pas donné à temps la pierre ou le grain:
Désignez-moi la pierre où vous êtes tombés
et le bois où vous fûtes crucifiés,
illuminez pour moi les vieux silex,
les vieilles lampes, les fouets collés
aux plaies au long des siècles
et les haches à l’éclat ensanglanté.
Je viens parler par votre bouche morte.
Rassemblez à travers la terre
toutes vos silencieuses lèvres dispersées
et de votre néant, durant toute cette longue nuit, parlez-moi
comme si j’étais ancré avec vous,
racontez-moi tout, chaîne à chaîne,
maillon à maillon, pas à pas,
affûtez les couteaux que vous avez gardés,
mettez-les sur mon cœur et dans ma main,
comme un fleuve jaune d’éclairs,
comme un fleuve des tigres enterrés,
et laissez-moi pleurer, des heures, des jours, des années,
des âges aveugles, des siècles stellaires.
Donnez-moi le silence, l’eau, l’espoir.
Donnez-moi le combat, le fer et les volcans.
Collez vos corps à moi ainsi que des aimants.
Accourez à ma bouche et à mes veines.
Parlez avec mes mots, parlez avec mon sang.
Chant général. Traduction: Claude Couffon, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1977.