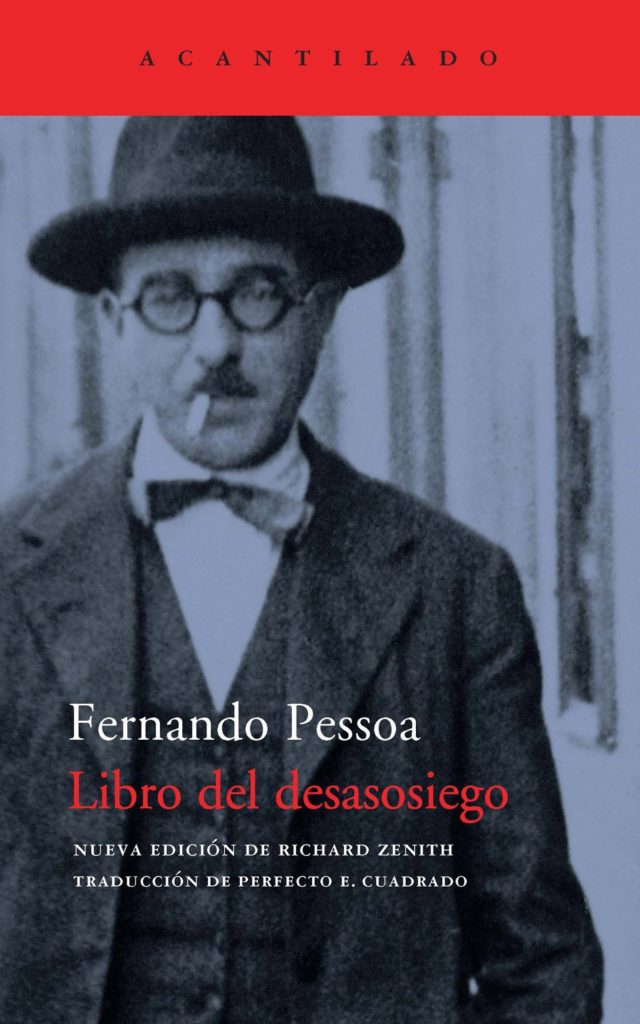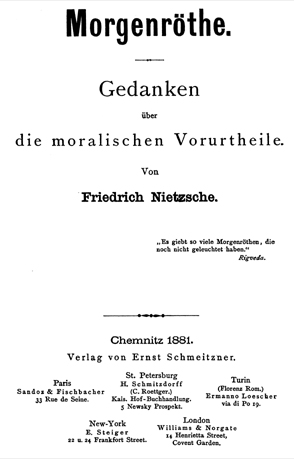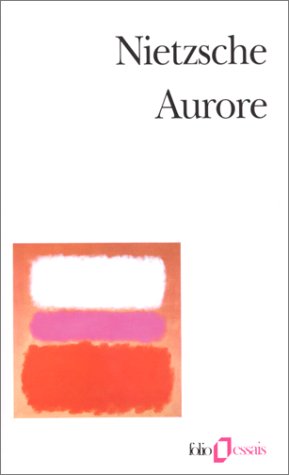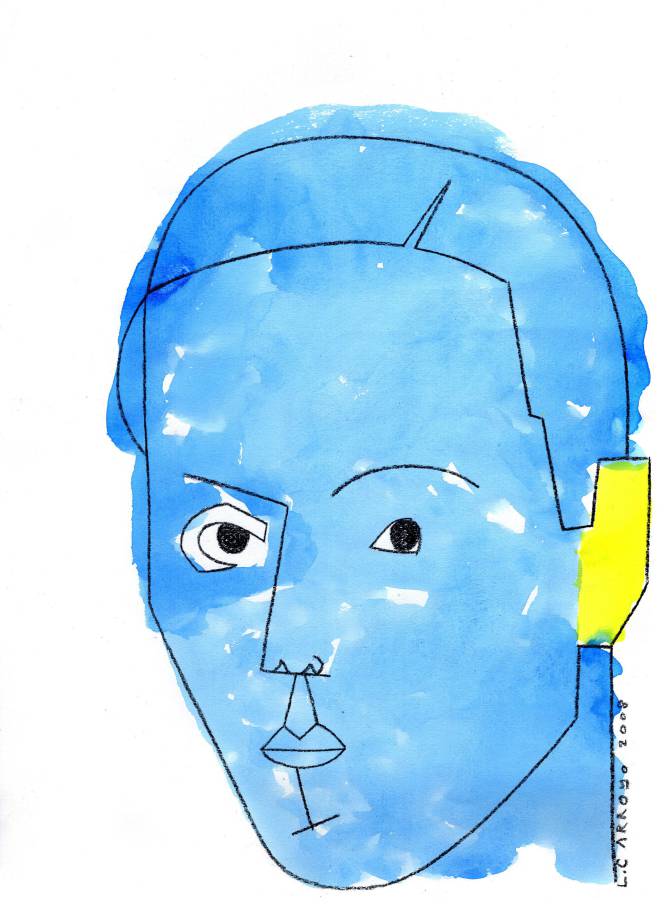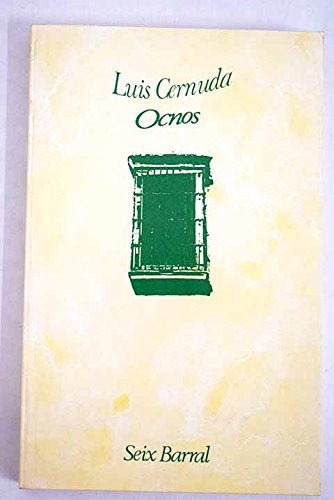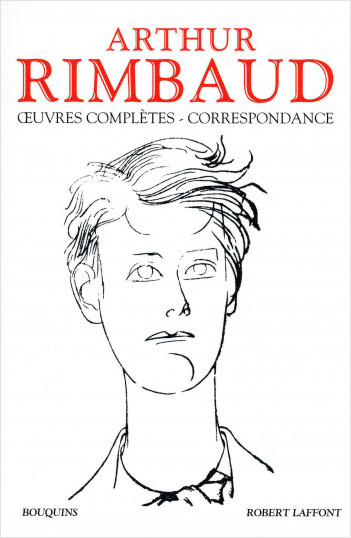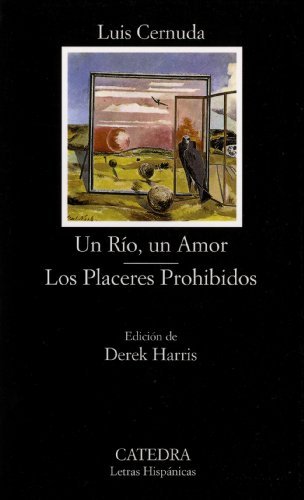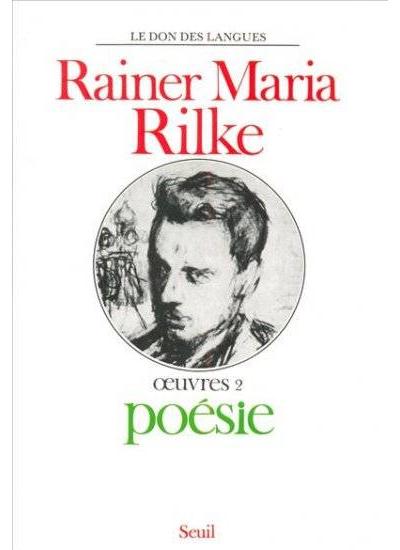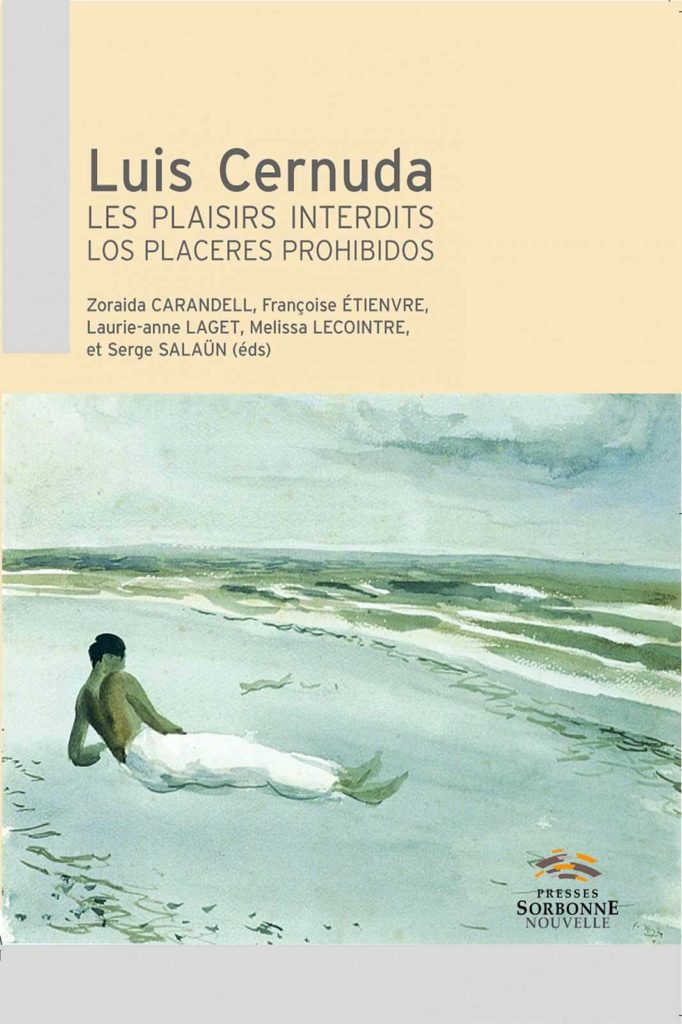«A qui est demeuré longtemps confiné dans la ville»
A qui est demeuré longtemps confiné dans la ville
Il est bien doux d’absorber son regard
Dans le visage ouvert et beau du ciel – d’exhaler une prière
En plein sourire du firmament bleu.
Qui donc est plus heureux, lorsque, dans le contentement du coeur,
Il sombre de fatigue sur une couche agréable au creux
D’une houle d’herbes, et lit une tendre
Et gracieuse histoire d’amour et de langueur?
De retour au foyer le soir, une oreille
Captant les notes de Philomèle – un œil
Guettant la course scintillante du petit nuage qui vogue
Il pleure d’un tel jour la fuite si rapide:
Rapide comme une larme versée par un ange au passage
Et qui tombe dans l’éther transparent, en silence.
Seul dans la splendeur. 1990. La Différence Collection Orphée. Edition bilingue. Traduction Robert Davreu. Réédition Points Seuil, 2009.
«To one who has been long in city pent»
To one who has been long in city pent,
’Tis very sweet to look into the fair
And open face of heaven, – to breathe a prayer
Full in the smile of the blue firmament.
Who is more happy, when, with heart’s content,
Fatigued he sinks into some pleasant lair
Of wavy grass, and reads a debonair
And gentle tale of love and languishment?
Returning home at evening, with an ear
Catching the notes of Philomel, – an eye
Watching the sailing cloudlet’s bright career,
He mourns that day so soon has glided by:
E’en like the passage of an angel’s tear
That falls through the clear ether silently.
Poème écrit dans les champs. Juin 1816. Le sonnet trouve son point de départ dans une adaptation de Milton: “As one who long in Populous City pent”. (Paradis perdu, IX, 445.)