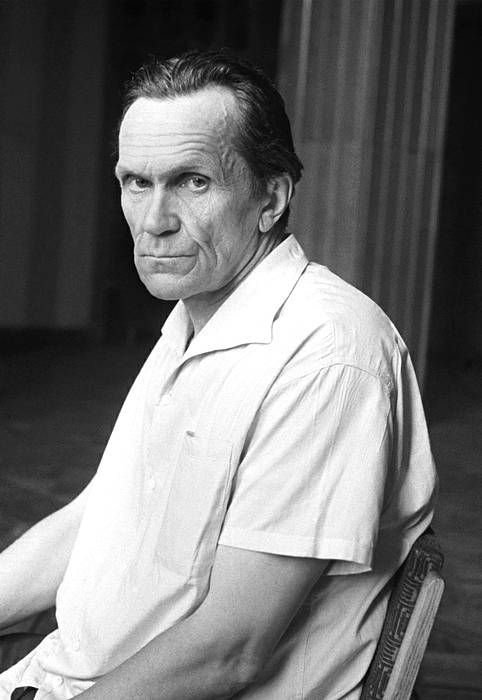La vision du film de Jean-Paul Civeyrac Des filles en noir où il est question de suicide partagé et d’ Heinrich von Kleist m’ a poussé à parcourir à nouveau l’oeuvre de ce poète romantique allemand qui a profondément marqué des écrivains tels que Friedrich Nietzsche, Stefan Zweig, André Breton, Julien Gracq, Michel Tournier, Louis-René des Forêts et même des cinéastes tels qu’ Eric Rohmer et Marco Bellocchio.
Heinrich von Kleist est né le 18 octobre 1777 à Francfort-sur-l’Oder dans une famille de l’aristocratie militaire prussienne, modeste mais farouchement attachée aux valeurs de la caste des Junkers.
Son oeuvre comprend huit pièces :
Trois tragédies: – La Famille Schroffentsein (1802),
– Robert Guiscard, duc des Normands (dont il brûlera le manuscrit en 1803),
– Penthésilée (1805/1807).
Deux comédies: – La Cruche cassée (1806),
– Amphitryon (d’après Molière, 1805-07).
Deux drames : – La Bataille d’Arminius (1809),
– Le Prince de Hombourg (1811).
Un grand drame historique médiéval: – La Petite Catherine de Heilbronn (1808-10).
Il a écrit aussi huit nouvelles (Michael Kohlhaas, La Marquise d’O…, Le Tremblement de terre du Chili, Fiançailles à Saint-Domingue, La Mendiante de Locarno, L’Enfant trouvé, Sainte Cécile ou la Puissance de la musique, Le Duel), des poèmes (certains patriotiques), des écrits politiques (Le Catéchisme des Allemands ), des essais (L’Élaboration progressive de la pensée par la parole; Sur le théâtre de marionnettes) et de nombreux articles pour une revue nationaliste prussienne (Germania), une revue littéraire (Phebus) ou un journal (Die berliner Abendblätter), qu’il a lui-même fondés.
Les lectures d’Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau l’ont profondément marqué.
Comme pour les romantiques allemands de sa génération, l’adhésion de Kleist aux idées émancipatrices des Lumières s’est transformé en haine du despotisme napoléonien. Il était tiraillé entre le désir d’action et la certitude que tout effort de la volonté est vain, toute expérience du réel illusoire et lacunaire. Il voulait égaler Goethe et n’a eu que des échecs de son vivant.
Ce désespoir de la conscience poussera Kleist à préparer méticuleusement son suicide, le 21 novembre 1811, en compagnie d’Adolfine Vogel (qu’il rebaptisera Henriette), femme mariée et atteinte d’un cancer qui accepta de partager sa mort près de l’auberge Stimmung au bord du Petit Wannsee, lac des environs de Berlin. Armé d’un pistolet, il tuera son amie avant de diriger l’arme contre lui. On retrouvera Henriette, les yeux grands ouverts, le corsage taché de sang. Kleist était à genoux devant elle, serrant entre ses dents le pistolet. Il avait 34 ans.
On peut lire sur la tombe un vers tiré du Prince de Hombourg: «Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein» (Maintenant, ô immortalité, tu es toute à moi!)

Lettre de Heinrich von Kleist à sa cousine Marie von Kleist
Berlin, le 19 novembre 1811
Ma très chère Marie,
Au milieu du chant triomphal qu’entonne mon âme à l’approche du dernier instant, je pense à toi plus que jamais et j’éprouve le besoin de m’ouvrir à toi autant que je le pourrai, à toi qui est le seul dont le sentiment et le jugement m’importent. Car j’ai chassé tout le reste de mon coeur, tout ce qui est sur la terre, en détail et en bloc. Oui, c’est vrai, je t’ai trompée, ou plus exactement je me suis trompé moi-même. Et certes je t’avais juré mille fois que si je venais à te tromper, je n’y survivrais pas. Mais justement je vais mourir bientôt, et ceci est une lettre d’adieux. Pendant que tu étais à Berlin, je t’ai abandonnée pour une autre, mais si cela peut diminuer ta peine, sache que cette nouvelle amie se propose non pas de vivre, mais de mourir avec moi, et sois persuadée que si elle prétendait vivre avec moi, je lui serais aussi peu fidèle que je le suis à toi. Je ne peux t’en dire davantage sur cette jeune femme, mes relations avce elle me l’interdisent. Tout ce que je peux encore te dire, c’est qu’au simple contact de son âme, mon âme a mûri tout à coup, et qu’elle est désormais prête pour la mort. C’est que son coeur m’a fait mesurer tout à coup toute la noblesse du coeur humain; c’est que je meurs parce qu’il ne me reste sur la terre plus rien à apprendre ni à acquérir. Adieu! Tu es le seul être au monde que je souhaite retrouver dans l’au-delà. Ma sœur Ulrike? Oui, non, non, oui. Cela dépend de ses propres sentiments. Elle n’a pas encore compris, il me semble, que le comble de la félicité sur la terre, et ce en quoi le ciel doit consister s’il existe, c’est le sacrifice total de soi-même à la personne qu’on aime. Adieu! Considère également que j’ai trouvé une amie dont l’âme plane dans les hauteurs comme un jeune aigle. Elle a bien compris que ma tristesse était un mal supérieur, profondément enraciné, incurable, et elle a décidé de mourir avec moi , bien qu’elle dispose des moyens de me rendre heureux ici-bas. Elle m’a donné la joie inouïe de s’offrir à moi avec la simplicité d’une violette qu’on cueille dans les herbes. Elle abandonne pour moi un père qui l’adore, un mari assez généreux pour accepter de s’effacer devant moi, et un enfant, une petite fille belle comme le soleil du matin. Tu dois comprendre que ma seule joyeuse préoccupation n’est désormais que de trouver une tombe assez profonde pour m’y laisser glisser avec elle. Adieu pour la dernière fois.
Dans le tome IV de la correspondance de Samuel Beckett, on apprend qu’ Emil Cioran sachant que l’écrivain irlandais allait à Berlin, le pressa de se rendre à Wannsee afin de fouler la terre où le poète Kleist et son amie Henriette se sont suicidés. (Lettres IV, 1966-89)
Lettre de Heinrich von Kleist à sa cousine Marie von Kleist
Auberge Stimming, 21 novembre 1811
Si tu savais, ma très chère Marie, de quelles fleurs célestes et terrestres l’Amour et la Mort se couronnent l’un l’autre pendant ces derniers moments de ma vie, je suis sûr que tu me verrais mourir sans te révolter. Ah, je te le jure, je suis totalement bienheureux. Matin et soir, je tombe à genoux, comme je n’avais jamais pu le faire auparavant, et je prie Dieu. Maintenant, oui, je peux lui rendre grâce de cette vie – la plus tourmentée qu’un homme vécût jamais – parce que Dieu l’a compensée par la plus magnifique et la plus voluptueuse des morts. Ah que ne puis-je faire quelque chose pour adoucir l’âpre souffrance que je vais te causer! J’avais d’abord pensé faire faire mon portrait à ton intention, et puis l’idée m’est venue que j’avais trop de torts à ton égard pour pouvoir supposer que mon image pût te donner quelque joie. Trouveras-tu quelque consolation dans ce que je vais te dire maintenant: jamais je ne t’aurais abandonnée pour suivre cette amie qui va mourir avec moi si elle n’avait aspiré qu’à vivre simplement avec moi. Je te le jure, je t’aime tellement, tu as tant de prix à mes yeux que j’ose à peine dire que j’aime cette amie plus que toi. Mais la résolution de mourir avec moi qui s’est formée dans son âme m’a attiré dans ses bras avec une violence plus ineffable, plus irrésistible que je ne saurais le dire. Est-ce que tu te souviens que je t’ai demandé plusieurs fois si tu acceptais de mourir avec moi? Mais tu m’as toujours répondu non. Je suis emporté par une fidélité tumultueuse que je n’avais jamais éprouvée, et je ne peux nier que la tombe de cette femme m’attire davantage que le lit de toutes les impératrices du monde.
Ah, ma très chère Marie, puisse Dieu t’appeler bientôt dans ce monde meilleur où l’amour des anges nous réunira tous dans une même étreinte! Adieu!