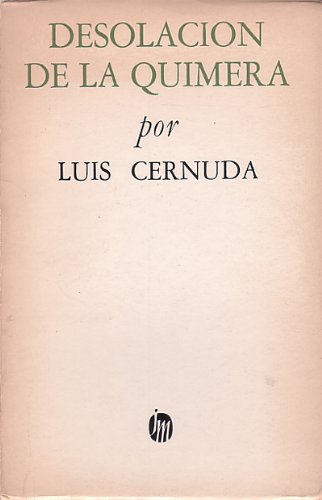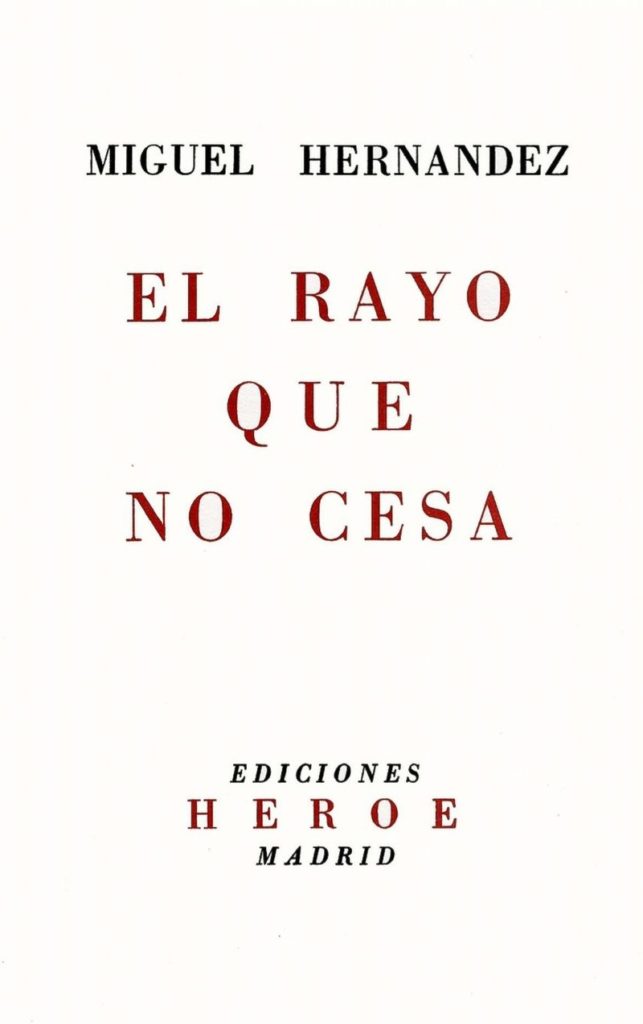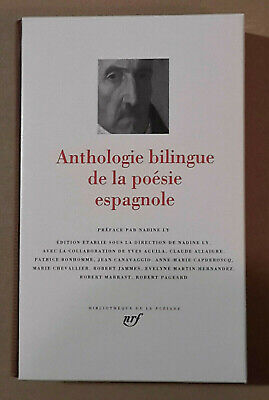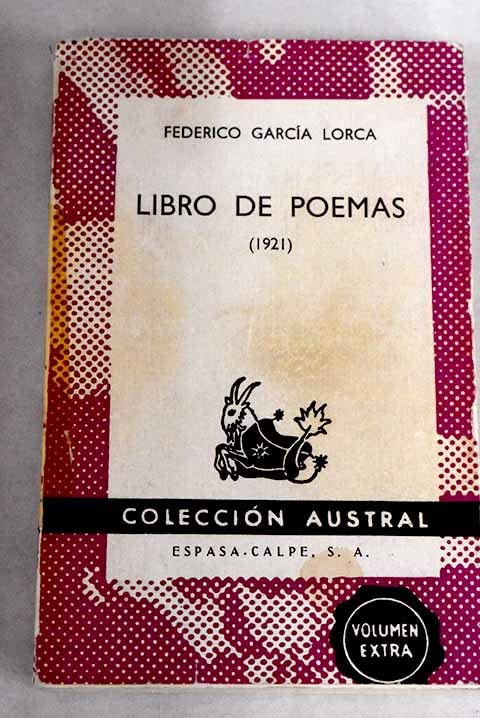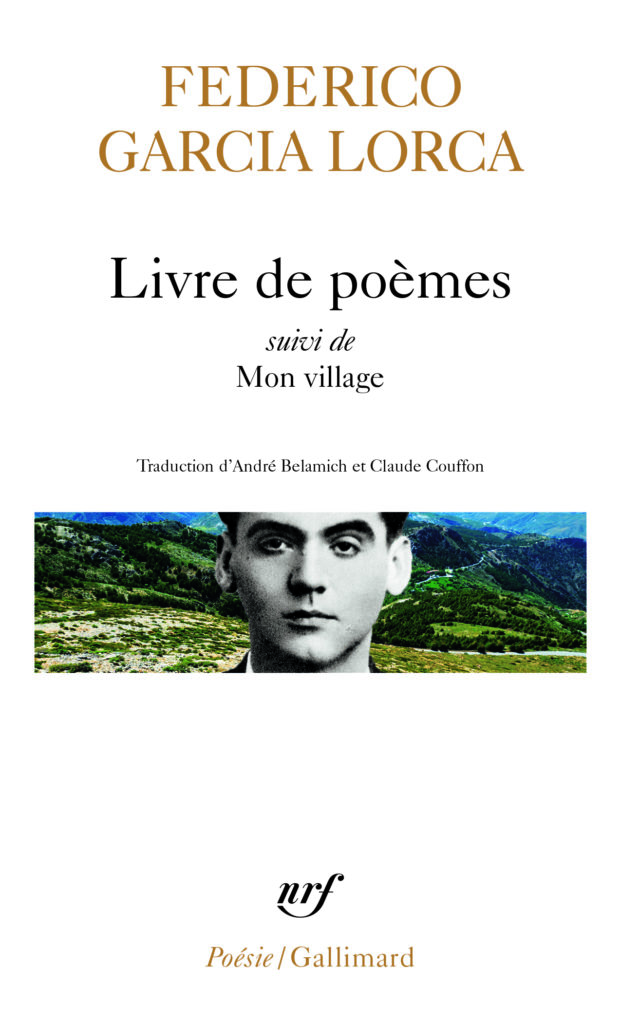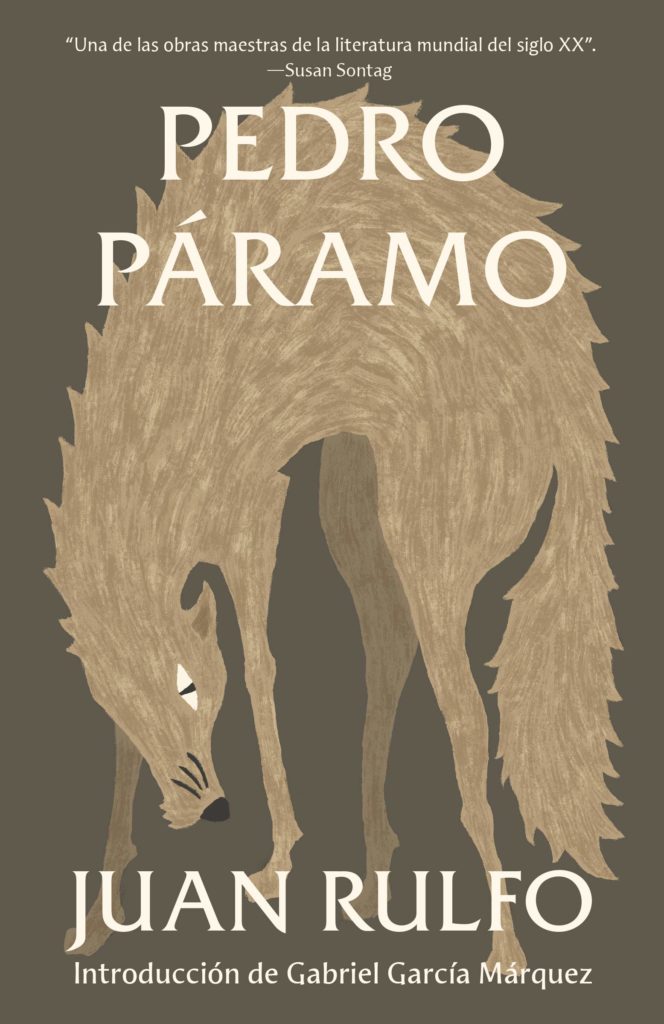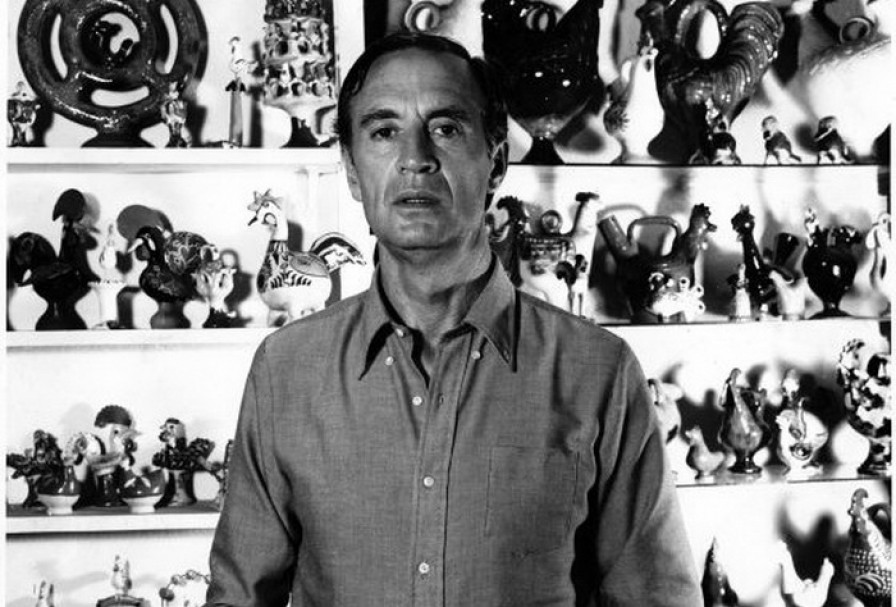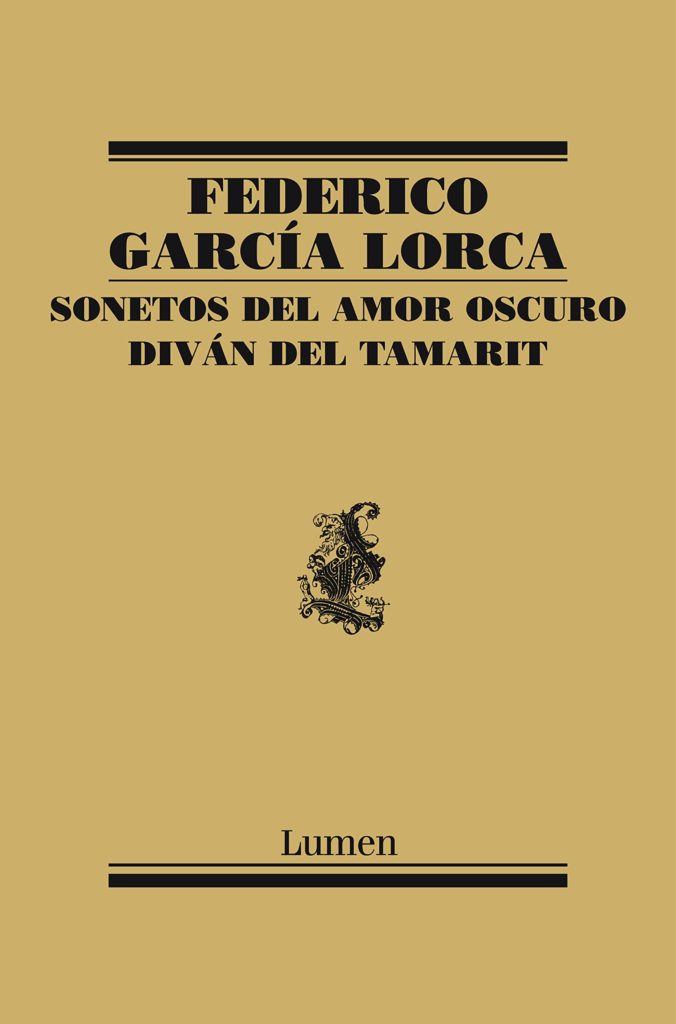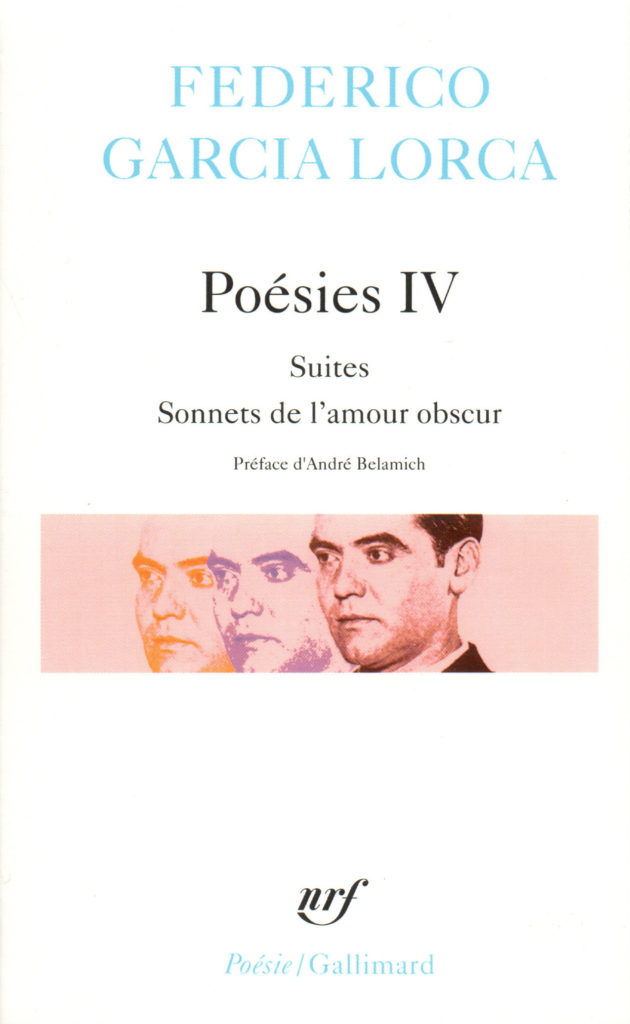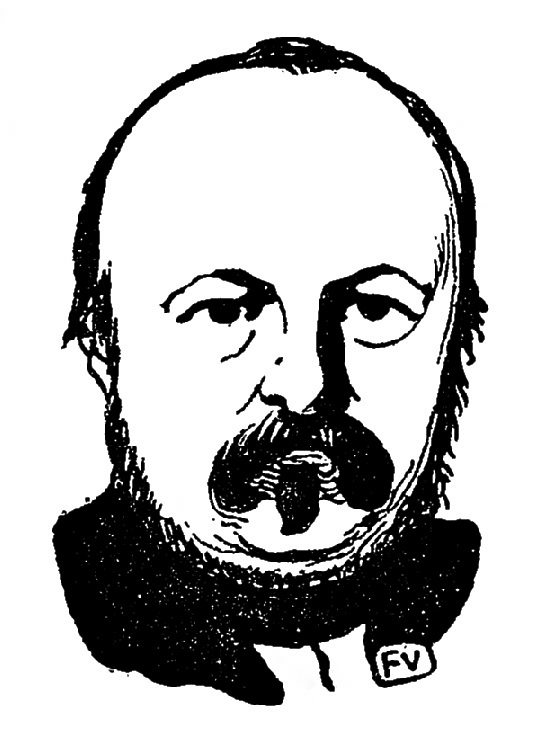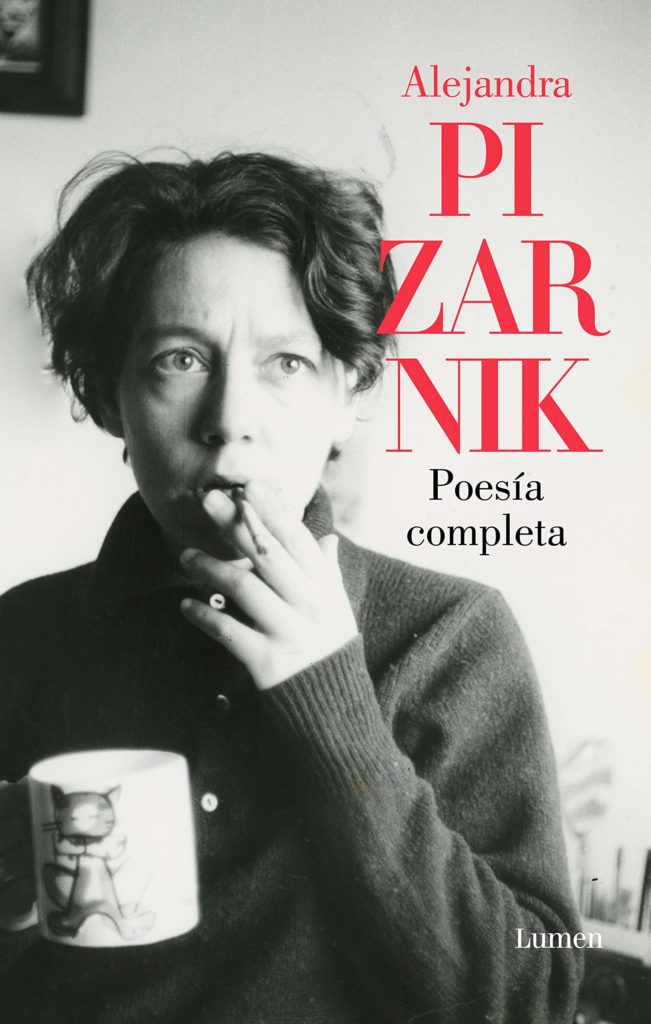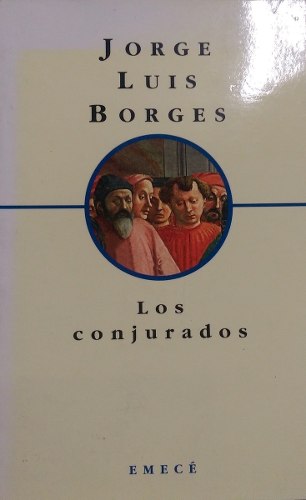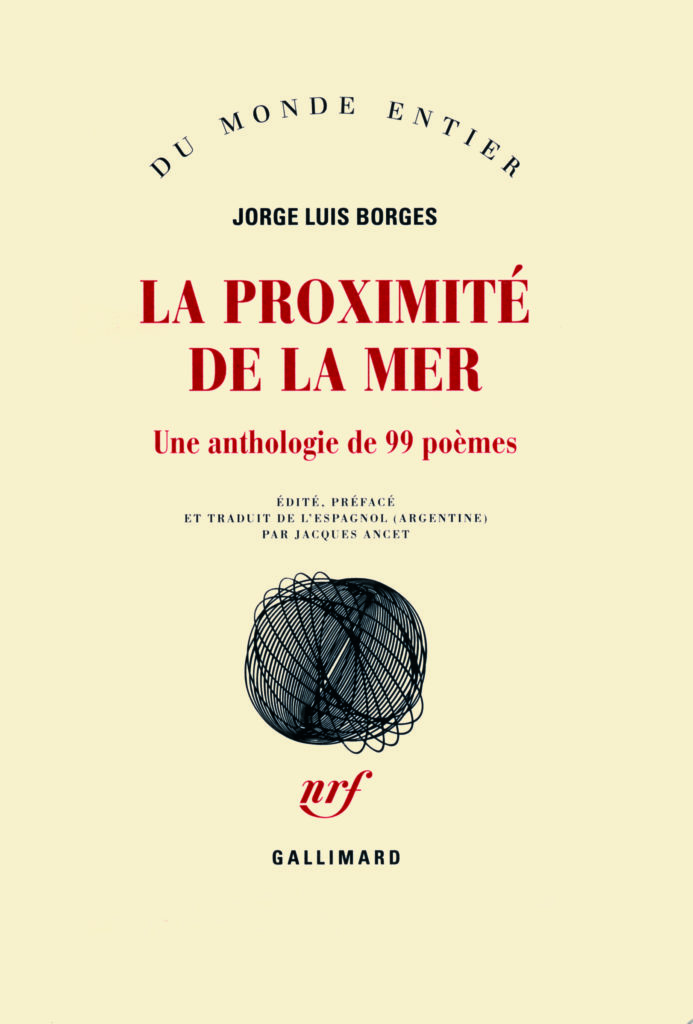Le 20 février dernier, j’avais publié sur ce blog le poème de Luis Cernuda 1936. Il s’agit de l’avant-dernier poème de toute son oeuvre, le dernier étant A sus paisanos ( Á ses compatriotes ). Il fait partie du recueil Desolación de la Quimera ( Désolation de la chimère ) qui regroupe des poèmes écrits entre 1956 et 1962. Cernuda a quitté l’Espagne en février 1938 et vit en exil à México depuis novembre 1952. Il enseigne à l’Université de Californie à Los Angeles et au San Francisco State College en 1961-1962 . Il récite ses poèmes en public. Á la fin d’une de ces séances, un ancien brigadiste est venu le saluer. Il commence à écrire ce poème à San Francisco en décembre 1961 et le termine en avril 1962. La Brigade Abraham Lincoln (ou XVe Brigade internationale) était constituée de volontaires des États-Unis qui avaient servi pendant la guerre civile espagnole dans les Brigades internationales.
Luis Cernuda meurt le 5 novembre 1963 à 61 ans. Il est enterré dans la section espagnole du Panteón Jardín de la ville de México.
Je conseille la lecture de la revue Europe n° 1118-1119-1120 (Juin-juillet-août 2022) Écrivains et reporters dans la guerre d’Espagne. La traduction française de ce poème y figure (pages 13-14-15).

1936
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
Cuando asqueados de la bajeza humana,
Cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recúerdalo a otros.
En 1961 y en ciudad extraña,
Más de un cuarto de siglo
Después. Trivial la circunstancia,
Forzado tú a pública lectura,
Por ella con aquel hombre conversaste:
Un antiguo soldado
En la Brigada Lincoln.
Veinticinco años hace, este hombre,
Sin conocer tu tierra, para él lejana
Y extraña toda, escogió ir a ella
Y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida,
Juzgando que la causa allá puesta al tablero
Entonces, digna era
de luchar por la fe que su vida llenaba.
Que aquella causa aparezca perdida,
Nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
Sólo atendieran a ellos mismos,
Importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
Como en aquellos días:
Noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
A tráves de los años, la derrota,
Cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.
Gracias, Compañero, gracias
Por el ejemplo. Gracias porque me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
Como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.
Desolación de la químera. Joaquín Mortiz, México, 1962.
1936
Souviens-t’en et que d’autres s’en souviennent,
Les écoeurés de la bassesse humaine,
Les lassés de la dureté humaine :
Cet homme seul, cet acte seul, cette foi seule,
Souviens-t’en et que d’autres s’en souviennent.
En 1961, dans une ville étrangère,
Et plus d’un quart de siècle
Après. Une circonstance banale,
la contrainte pour toi d’une lecture publique,
Où tu as parlé à cet homme :
Un ancien soldat de la Brigade Lincoln.
Voici vingt-cinq ans, cet homme,
Sans connaître ta terre, lointaine pour lui,
Tout à fait étrangère, a choisi d’y aller
Et si l’occasion s’offrait, d’y engager sa vie,
Jugeant que la cause proposée sur le tableau
Était digne
De lutter pour la foi qui emplissait sa vie.
Que cette cause-là semble perdue,
Peu importe ;
Que tant d’autres, prétendant avoir foi en elle,
Ne s’occupent que d’eux-mêmes,
Aucune importance.
Seule importe et nous suffit la foi d’un seul.
C’est pourquoi la cause aujourd’hui t’apparaît
Comme elle le fit alors :
Noble et si digne de lutter pour elle.
Et sa foi, cette foi-là, il l’a maintenue
Á travers les ans, dans la défaite,
Quand tout semblait la trahir.
Car cette foi, te disais-tu, est ce qui seul importe.
Merci Compagnon, merci
De cet exemple. Merci car tu me dis
Que l’homme est noble.
Peu importe que si peu le soient :
Un seul, il suffit d’un seul
Comme témoin irréfutable
de toute la noblesse humaine.
Traduction : Laurence Breysse-Chanet.