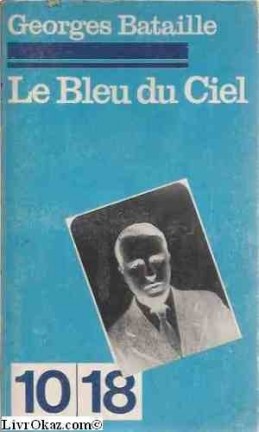Vu lundi 11 juin au Centre Pompidou l’exposition Jean-Jacques Lebel l’outrepasseur.
J’ y suis allé avec une certaine curiosité. J’avais beaucoup apprécié les pièces que Jean-Jacques Lebel avait présentées dans les expositions collectives, 1917 (Centre Pompidou-Metz, 2013) et Les Désastres de la Guerre (Louvre-Lens, 2014).
Dans ma bibliothèque, j’ai retrouvé La poésie de la Beat Generation (Textes traduits et présentés par Jean-Jacques Lebel. Denoël, 1965) et La Double vue de Robert Lebel (Deyrolle éditeur, 1993 (1ère édition, collection «Le Soleil Noir», 1964). Robert Lebel (1901-1986), son père, historien d’art s’exila à New York en 1939. Il participa aux activités et publications des surréalistes et fut, en 1959, l’auteur de la première monographie consacrée à Marcel Duchamp.
Jean-Jacques Lebel est né à Paris en 1936. Installé à New York avec sa famille pendant la Seconde Guerre Mondiale, il a rencontré, très jeune, Billie Holliday en 1948, mais aussi André Breton, Benjamin Péret, Max Ernst, Claude Lévi-Strauss, Marcel Duchamp.
Breton l’a aidé à trouver sa place. “Mes parents ne savaient plus quoi faire de moi, Breton est le premier à m’avoir dit : “Vous tenez le bon bout.” Et nous avons commencé à aller aux Puces ensemble, où je cherchais des objets de dépaysement comme ces douilles sculptées par des poilus pendant la Première Guerre mondiale.”
J’ai retrouvé dans les vitrines du Centre Pompidou certains des livres de Jean-Jacques Lebel que je connaissais, par exemple L’Internationale Hallucinex, ensemble de documents dépliants in-8°, sous boîte carton imprimée rouge vif. (Paris, Le Soleil Noir, 1970). Cet ensemble contient des textes de Burroughs, Pélieu, Weissner, Nuttal, Sanders, Goutier, Kahn qui ont eu leur importance dans l’effervescence post-1968.
Jean-Jacques Lebel n’aime pas le mot «exposition». Il préfère le terme de«montrage», concept inventé par le peintre et réalisateur Robert Lapoujade (1921-1993). On retrouve à Beaubourg une partie de son activité des années 1950-60. Exclu du mouvement surréaliste en 1960 avec Alain Jouffroy, à la même époque, il traduit en français et publie William Burroughs, Allen Ginsberg, Michael McClure, Lawrence Ferlinghetti et Gregory Corso.
En 1960, il sera l’auteur, à Venise, de L’Enterrement de « La Chose » de Tinguely, sculpture jetée dans la lagune, ce qui est considéré comme le premier happening européen. Il a publié le premier essai critique en français sur ce type d’actions. En 1979, il lance le festival pluridisciplinaire Polyphonix, mêlant arts plastiques, vidéo, musique, performance, poésie, festival qui existe encore aujourd’hui.
En 1961, il prend l’initiative du Grand Tableau Antifasciste collectif, dont le sujet est la torture pendant la Guerre d’Algérie et sera sequestré par la Questura de Milan pendant 23 ans.
En 1968, Jean-Jacques Lebel prend part aux activités du « Mouvement du 22 mars », puis du Groupe anarchiste « Noir et Rouge » et à « Informations et correspondances ouvrières ». Il suit l’enseignement de Gilles Deleuze à la faculté de Vincennes et sera l’ami de Félix Guattari.
En 2016, Jean-Jacques Lebel a été co-commissaire de l’exposition rétrospective consacrée à la Beat Generation au Musée national d’Art moderne / Centre Georges Pompidou, Paris.
“Ce que l’on demande au regardeur, en somme, c’est de participer à l’insurrection de l’art et de cesser d’être un voyeur, un témoin passif, un consommateur résigné.” (1966)
“La seule chose nécessaire aujourd’hui, c’est de faire irruption dans le monde de l’art pour déciller les yeux, pour ouvrir les regards.”
L’exposition commence assez significativement par un Hommage à Billie Holliday (1959, Collection particulière). Elle est intéressante, mais m’a semblé d’une qualité un peu irrégulière.
J’ai écouté ensuite avec plaisir en podcast l’émission L’Heure bleue de Laure Adler sur France Inter: Jean-Jacques Lebel, engagé, 53’.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-30-mai-2018
Jean-Jacques Lebel explique son parcours et écoute les archives proposées par Laure Adler:
Archive Ina de 1954 (au micro d’Emmanuel Berl et Maurice Clavel): Georges Bataille parle de son enfance. Lebel insiste sur l’importance qu’a eu Georges Bataille sur lui. Il évoque aussi la figure de Simone Weil évoquée dans Le Bleu du ciel.
Archive du 13 janvier 1947: Antonin Artaud. Conférence au Vieux Colombier.
Archive Ina du 22 mars 1996: Allen Ginsberg lit un de ses poèmes.