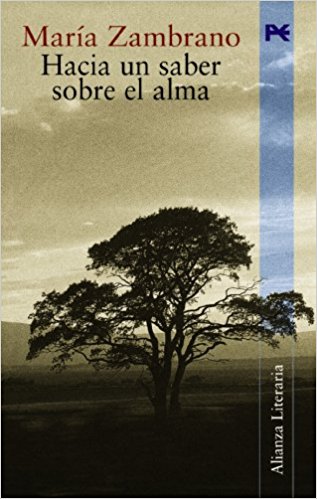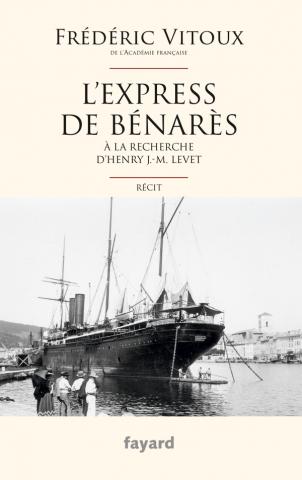“No parece demasiado necesario justificar que creamos estar viviendo en crisis; es ya un lugar común de nuestros días, y como tantos lugares comunes nos hace correr el peligro de que resbalemos sobre él, sin adentrarnos. Mas, si sucede así será tanto como resbalar sobre nuestra propia vida. Y lo grave es que tal cosa: resbalar sobre la propia vida, sin adentrarse en ella, puede ocurrir con suma facilidad. Por eso es necesario que intentemos desentrañar lo que hay dentro de esta realidad a que aludimos al decir crisis. Es necesario. Y sin embargo, no podemos atrevernos a definirla de veras. Sólo nos cabe hacer eso que no resulta fácil confesar que se hace, por el indebido uso de una palabra, que fue en otro tiempo humilde y expresiva como tantas otras. La actividad humana denominada meditación, de humilde expresión que no significa resultado alguno, sino sencillamente una actividad, una actitud casi, muy pegada a la vida de todos los días, pues la meditación no es sino la preocupación un poco domada, que corre sin revolverse por un cierto cauce; una preocupación que se ha fundido con nuestra mente, incrustada en nuestras horas. Y tan pegada a la vida diaria que como ella no tiene término fijo de antemano, que no va a concluir en ninguna obra ni resultado y que sólo se va a justificar modificándose a sí misma,haciéndose paso a paso más transparente, alcanzando mayor claridad. Algo, en fin, parecido a una confesión. Buscamos saber lo que vivimos; como se ha dicho poéticamente «vigilar el sueño».
Vivir en crisis es vivir en inquietud. Mas toda vida se vive en inquietud. Ninguna vida mientras pasa alcanza la quietud y el sosiego por mucho que lo anhele. No será la inquietud simplemente lo que caracterice el vivir en crisis sino, en todo caso, una inquietud determinada, o una inquietud excesiva, más allá o en el límite de lo soportable.
Así parece ser. Si repasamos los títulos de las revistas literarias jóvenes y aun de los libros de Poemas, o de Ensayos de los años que van de 1915 a 1930, la palabra «inquietud» o «inquietudes» es la que con mayor frecuencia aparece. Y sabido es lo delator que resulta el que una palabra sea usada con preferencia en la expresión literaria y más todavía, en la expresión literaria balbuciente.”
María Zambrano Hacia un saber sobre el alma, Alianza Literaria. Madrid 2004.