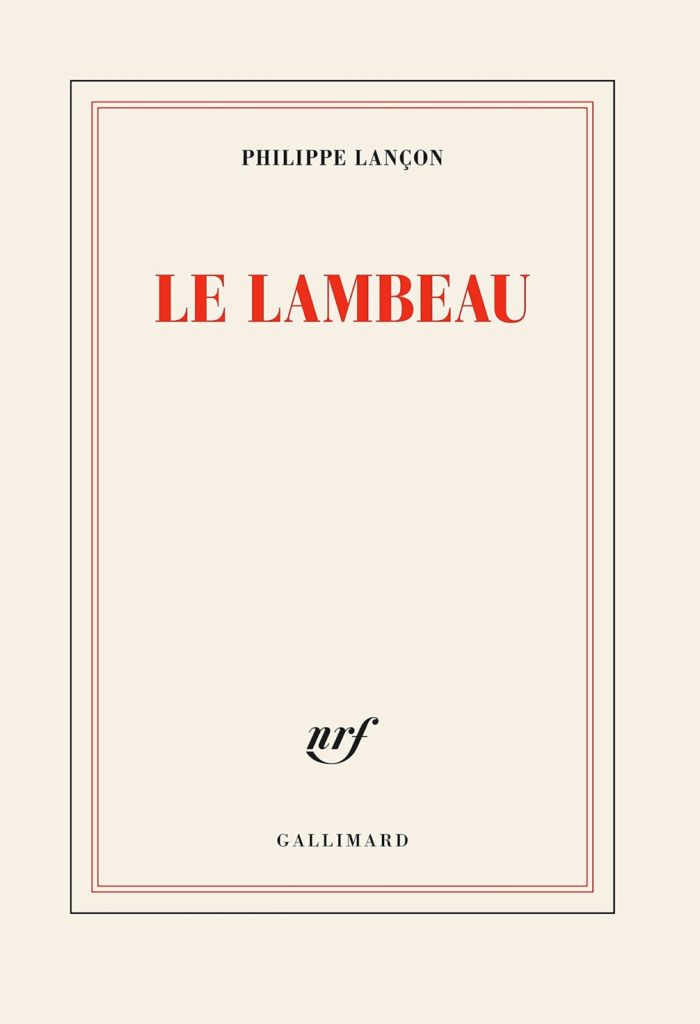«J’ai raconté, dans «Le monde d’en bas», comment je descendais régulièrement au bloc avec les lettres à Milena, mais je n’ai pas encore dit comment elles avaient atterri là. Une nouvelle édition venait de paraître chez Nous, traduite par Robert Kahn. Mon amie et chef de service à Libération, Claire, était venue quelques jours après l’attentat et me l’avait apportée. Quand elle est arrivée, j’étais au bloc. Comme elle ne disposait d’aucun papier, elle écrivit sur la page de garde: «Mon cher Philippe, je repasserai te voir bien sûr. Je t’embrasse bien fort. Claire.» Il avait fallu ces circonstances pour qu’elle en vienne à faire une chose que sa délicatesse et son éducation lui interdisaient, dédicacer un livre qu’elle n’avait pas écrit. Ce petit geste né des circonstances m’avait terriblement ému et ces quelques mots de Claire, joints aux lettres qui les suivaient, firent du livre un talisman qui, de chambre en chambre, de maison en maison et de pays en pays, ne m’a plus quitté.
Le jour où Claire me l’apporta, remontant du bloc à moitié endormi et nauséeux, je l’ai pris comme un ivrogne passant sous une douche glacée pour se réveiller, et je suis tombé sur des phrases que j’ai jusqu’ici simplement évoquées. Kafka est à Merano, au printemps 1920. Il parle de ses fiançailles ratées, mais on a l’impression qu’il parle du monde des malades, d’ailleurs comme tout est maladie il finit par en parler et il écrit. «De toute façon la réflexion sur ces choses n’apporte rien. C’est comme si l’on voulait s’efforcer de briser une seule des marmites de l’enfer, premièrement on échoue, et deuxièmement, si on réussit, on est consumé par la masse embrasée qui s’en échappe, mais l’enfer reste intact dans sa magnificence. Il faut commencer autrement. En tout cas s’allonger dans un jardin et tirer de la maladie, surtout si elle n’est pas vraiment une, le plus de douceurs possible. Il y a là beaucoup de douceurs.»
Ces phrases me servaient depuis lors de bréviaire, et même de viatique. Je les ai lues dans ma chambre, dans le monde d’en bas, dans le parc de l’hôpital, dans des salles d’attente de toutes sortes. Je les aurais lues sur le billard si j’avais pu, et cela jusqu’au moment où la brûlure de l’anesthésiant m’annonçait la perte de conscience. Elles me fixaient deux horizons qui, dans ma situation, étaient essentiels. D’abord, ne pas chercher à briser une seule des marmites de l’enfer dans lesquelles je me trouvais. Ne pas céder à la tristesse, à la colère, ne pas être obsédé par la destruction d’un enfer qui, comme celui de Kafka, resterait de toute façon, «intact dans sa magnificence». Ce mot, magnificence, à cet endroit, résumait sa modestie, son ironie, son innocence supérieure. On n’échappe pas à l’enfer dans lequel on est, on ne le détruit pas. Je ne pouvais pas éliminer la violence qui m’avait été faite, ni celle qui cherchait à en réduire les effets. Ce que je pouvais faire en revanche, c’était apprendre à vivre avec, l’apprivoiser, en recherchant, comme disait Kafka, le plus de douceurs possible. L’hôpital était devenu mon jardin. Et, regardant les infirmières, les aide-soignants, les chirurgiens, la famille, les amis, dans ce service d’urgence où chacun se plaignait et s’affrontait, où la crise était l’état naturel des patients et des soignants, je sentais que la douceur kafkaïenne existait, mais qu’elle n’était pas plus molle qu’une pierre et que la trouver dépendait de moi.»
Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard.