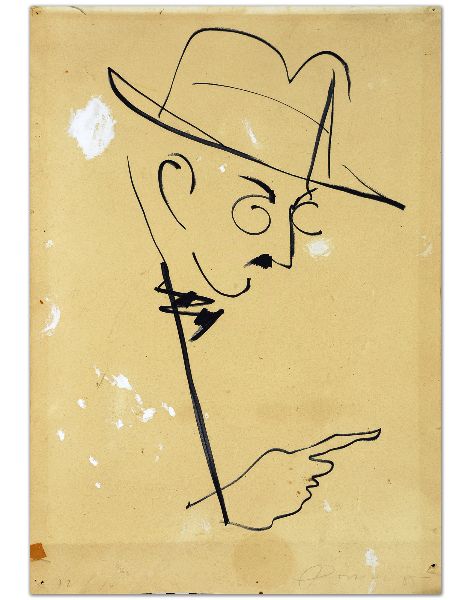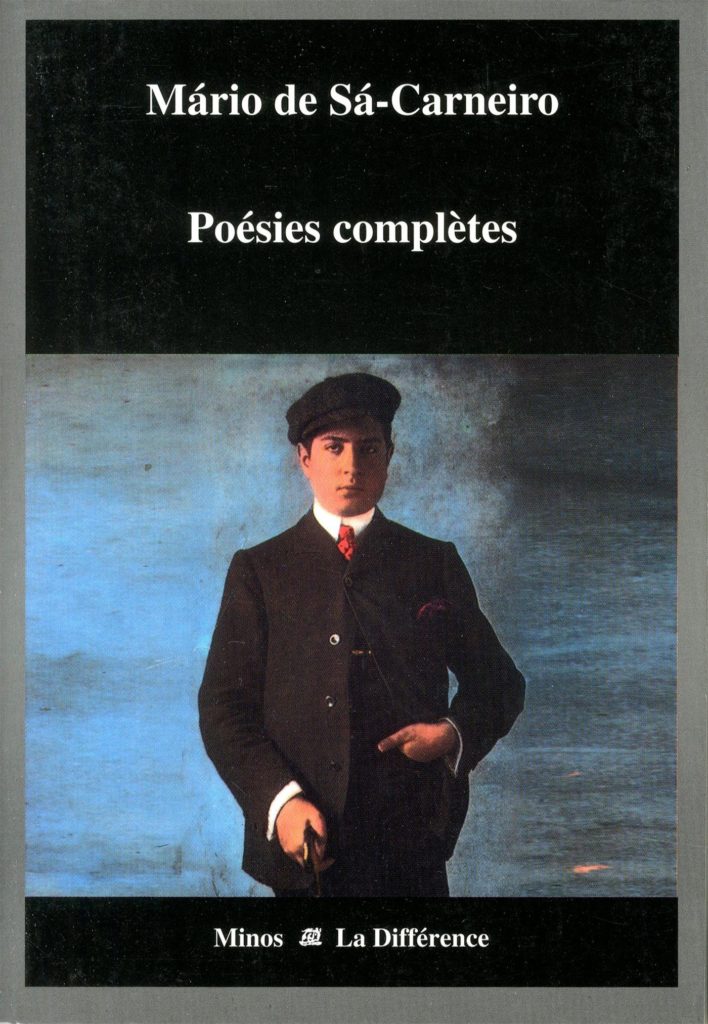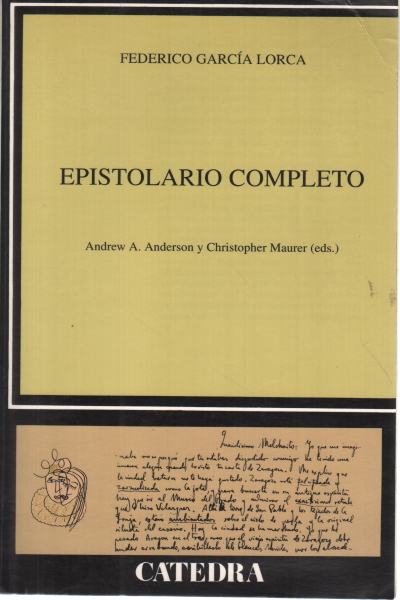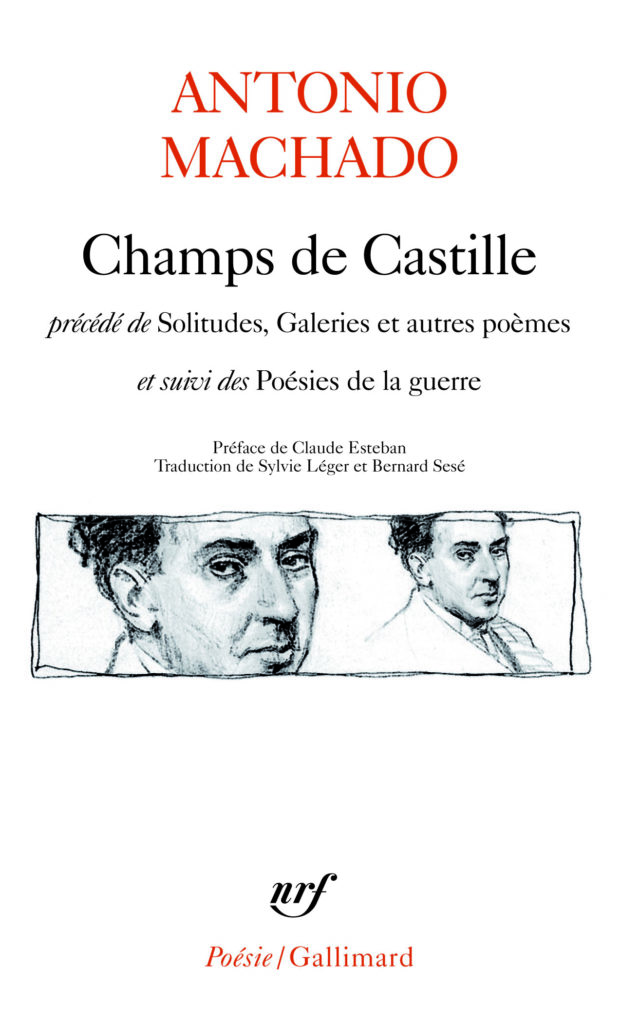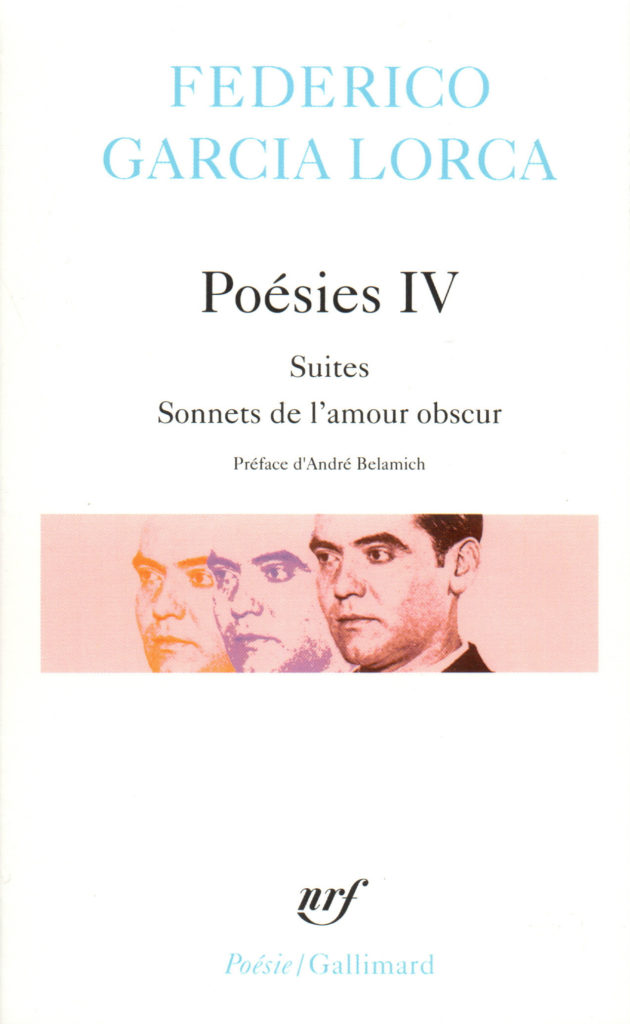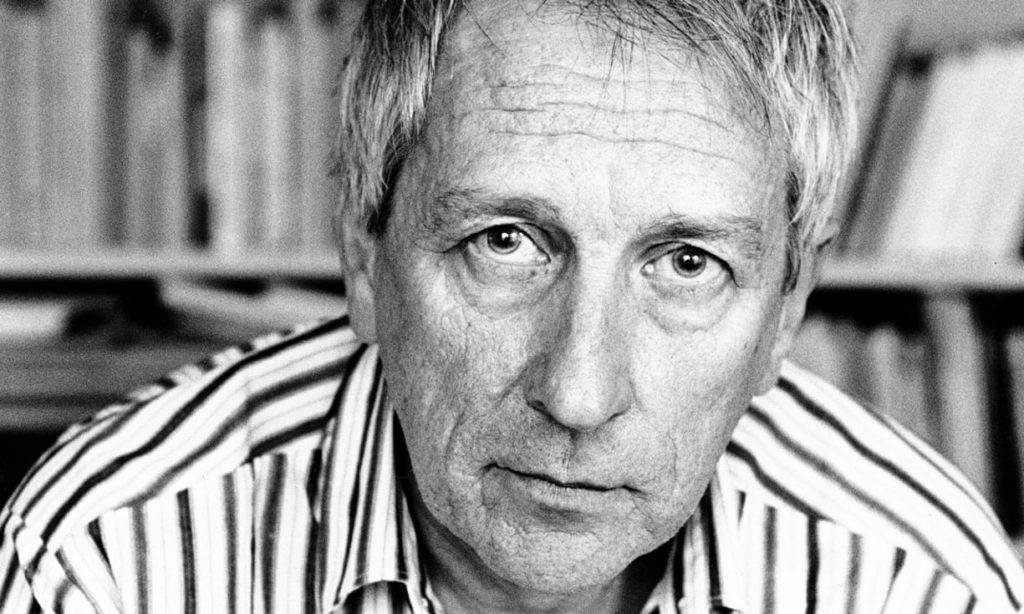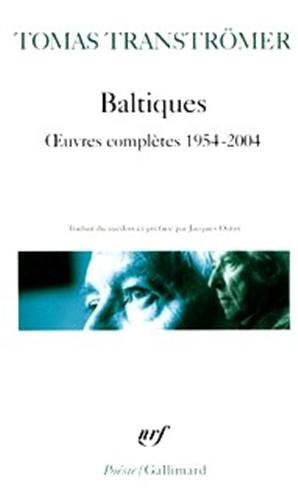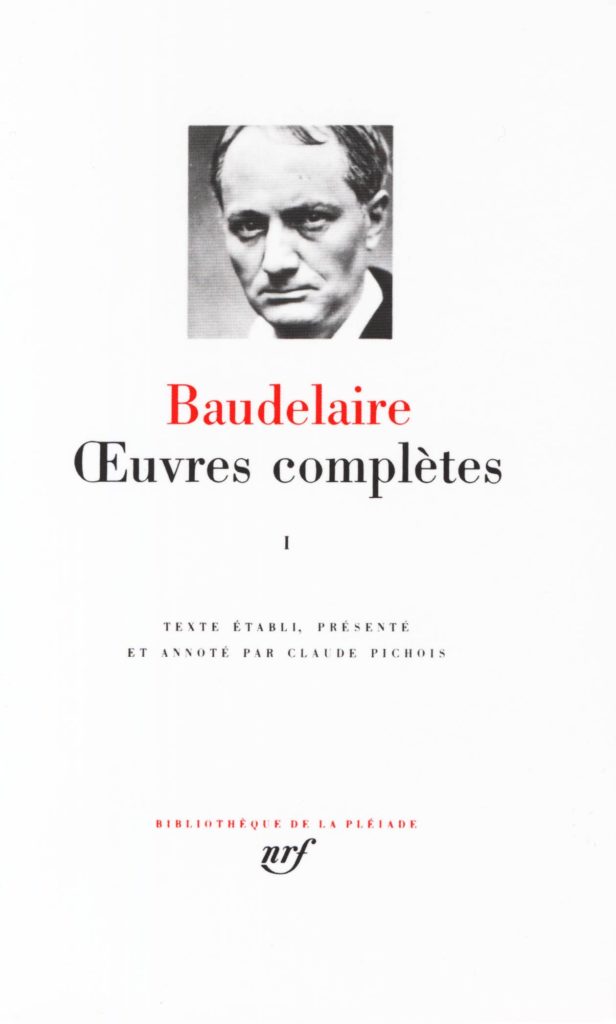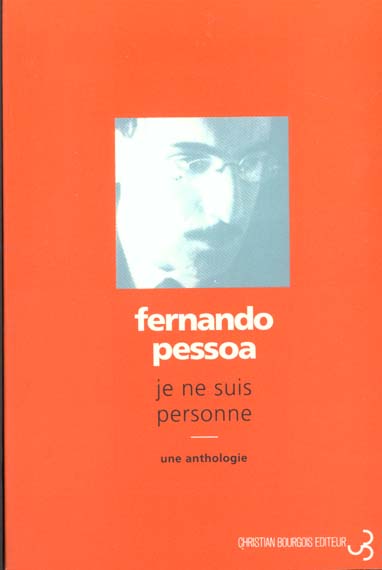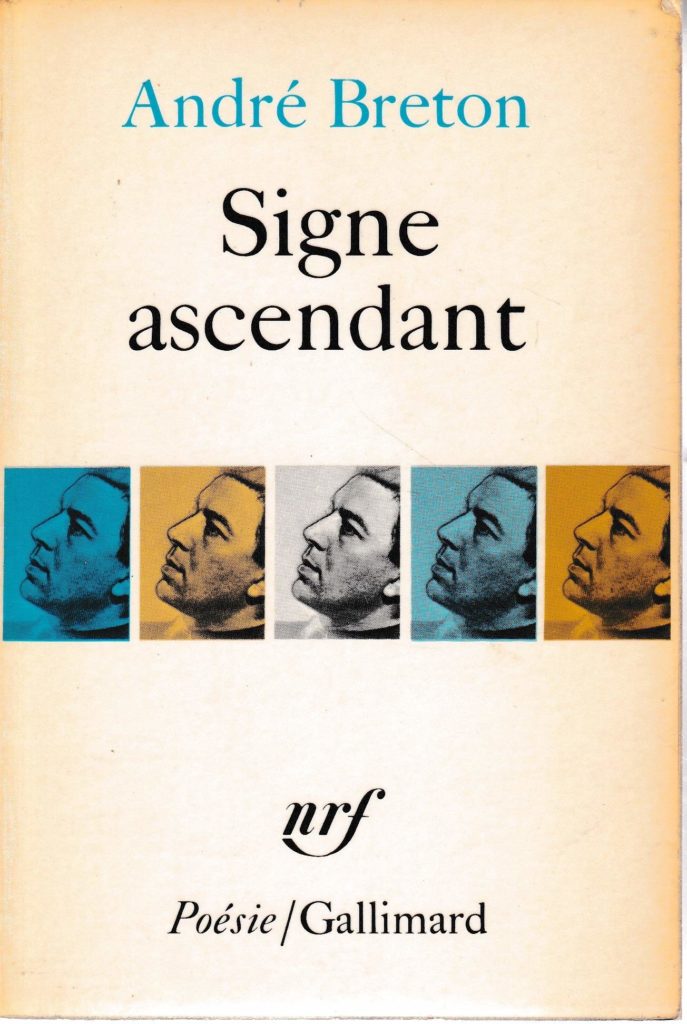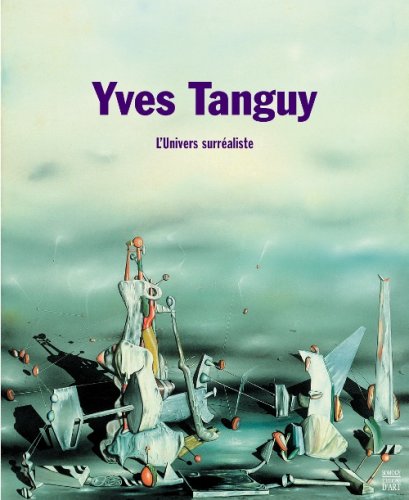Friedrich Hölderlin (1770-1843) arrive à Bordeaux le 28 janvier 1802 au matin, après un voyage difficile (par Lyon, l’Auvergne, le Périgord). Il demande son chemin pour arriver jusqu’au domicile du consul de la république de Hambourg (37 allées de Tourny), Daniel Christophe Meyer, négociant en vins installé depuis vingt-sept ans à Bordeaux, marié à une française et propriétaire de vignobles à Blanquefort, dans le Médoc. Il doit servir de précepteur aux enfants du couple. Fatigué par de longues journées de marche, il traverse la Garonne. Il aime ce fleuve et sa courbe, le port rempli de bateaux. Le vent sent le sel, la mer qu’il n’a jamais vue. Il est bien reçu par le consul en personne. On lui montre sa chambre. Le soir même, il écrit à sa mère : « Je suis presque trop magnifiquement logé. ». L’instruction des cinq fillettes ne lui donne aucun mal, mais son caractère taciturne frappe les Meyer. Il se promène souvent sur les quais de la Garonne et accompagne les enfants au bord de l’océan. Il quitte de façon précipité la ville en mai 1802. Il aura passé cent deux jours en Aquitaine. On sait peu de choses de ce séjour, mais il a laissé un beau poème, Souvenir, et quelques allusions dans des esquisses.
Il décrit ainsi son état : « L’élément violent, le feu du ciel et le silence des hommes […] cela m’a saisi et, comme on le dit des héros, je peux dire de moi aussi qu’Apollon m’a frappé. » Il a probablement effectué à pied le voyage de retour à travers la France post-révolutionnaire. Il passe par la Vendée et Paris où il visite les Antiquités au Louvre. Un mois après son départ, il reparaît à Stuttgart, « blanc comme un mort, amaigri, avec de grands yeux creux et le regard égaré, la barbe et le cheveu longs, vêtu comme un mendiant ». En passant par Francfort, il y a appris la mort le 22 juin 1802 de sa muse Susette Gontard (1769-1802), épouse d’un banquier d’origine grenobloise et huguenote, Jacob Gontard. Hölderlin l’a célébrée sous le nom de Diotima dans le roman épistolaire Hypérion ou l’Ermite de Grèce (1797-99). « C’est un terrible mystère qu’un être pareil soit destiné à mourir ».
Les critiques datent l’éclosion de la « folie » du poète du retour de Bordeaux. Son état de santé se dégrade de plus en plus. Il est interné le 11 septembre 1806 de force en clinique à Tübingen. Il échappe à cet enfer le 3 mai 1807, et devient pendant trente-six ans le pensionnaire du menuisier Ernst Zimmer, grand lecteur d’Hypérion, au premier étage d’une tour de Tübingen qui domine le Neckar. Hölderlin rédige encore des poèmes portant principalement sur le cycle naturel des saisons. Il meurt à 73 ans le 7 juin 1843 vers onze heures du soir. Il est enterré au cimetière de Tübingen.
Souvenir
Le vent du Nord-Est se lève,
De tous les vents mon préféré
Parce qu’il promet aux marins
Haleine ardente et traversée heureuse.
Pars donc et porte mon salut
A la belle Garonne
Et aux jardins de Bordeaux, là-bas
Où le sentier sur la rive abrupte
S’allonge, où le ruisseau profondément
Choit dans le fleuve, mais au-dessus
Regarde au loin un noble couple
De chênes et de trembles d’argent.
Je m’en souviens encore, et je revois
Ces larges cimes que penche
Sur le moulin la forêt d’ormes,
Mais dans la cour, c’est un figuier qui croît.
Là vont aux jours de fête
Les femmes brunes
Sur le sol doux comme une soie,
Au temps de Mars,
Quand la nuit et le jour sont de même longueur,
Quand sur les lents sentiers
Avec son faix léger de rêves,
Brillants, glisse le bercement des brises.
Ah! qu’on me tende,
Gorgée de sa sombre lumière,
La coupe odorante
Qui me donnera le repos ! Oh, la douceur
D’un assoupissement parmi les ombres !
Il n’est pas bon
De n’avoir dans l’âme nulle périssable
Pensée, et cependant
Un entretien, c’est chose bonne, et de dire
Ce que pense le cœur, d’entendre longuement parler
Des journées de l’amour
Et des grands faits qui s’accomplissent.
Mais où sont-ils ceux que j’aimai ? Bellarmin
Avec son compagnon ? Maint homme
A peur de remonter jusqu’à la source;
Oui, c’est la mer
Le lieu premier de la richesse. Eux,
Pareils à des peintres, assemblent
Les beautés de la terre, et ne dédaignent
Point la Guerre ailée, ni
Pour des ans, de vivre solitaires
Sous le mât sans feuillage, aux lieux où ne trouent point
La nuit
De leurs éclats les fêtes de la ville,
Les musiques et les danses du pays.
Mais vers les Indes à cette heure
Ils sont partis, ayant quitté
Là-bas, livrée aux vents, la pointe extrême
Des montagnes de raisin d’où la Dordogne
Descend, où débouchent le fleuve et la royale
Garonne, larges comme la mer, leurs eaux unies.
La mer enlève et rend la mémoire, l’amour
De ses yeux jamais las fixe et contemple,
Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure.
Que mille rivières bercent tes gestes.
Oeuvres. Gallimard. Bibliothèque de la Pléiade. Édition sous la direction de Philippe Jaccottet. 1967. Traduction : Gustave Roud.