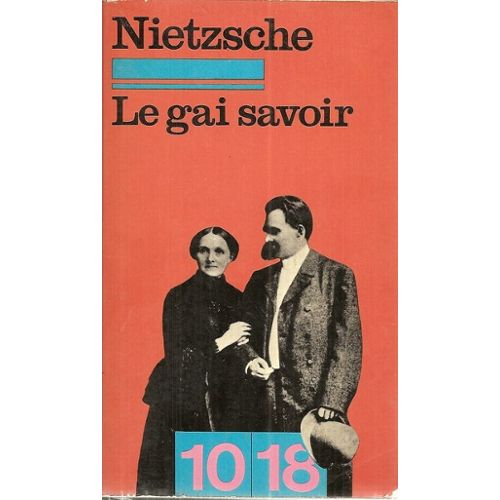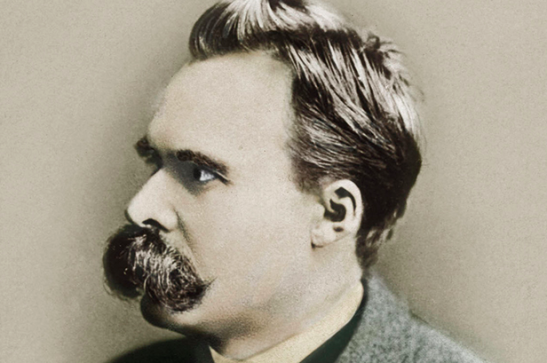
Préface de la deuxième édition. Le gai savoir.
I.
Ce livre a peut-être besoin de plus d’une préface; et finalement il reste toujours le doute qu’il soit possible que quelqu’un, sans qu’il ait fait quelque expérience semblable, soit par une préface rapproché de l’expérience de ce livre. Il semble écrit dans la langue du vent du dégel: il y a dedans de l’excitation, de l’intranquillité, de la contradiction, du temps d’avril, si bien que l’on est rappelé aussi bien à la proximité de l’hiver qu’à la victoire sur l’hiver, qui vient, qui doit venir, qui peut-être est déjà venue… La gratitude jaillit perpétuellement, comme si même le plus inattendu s’était produit, la gratitude de celui qui guérit, – car la guérison fut cet inattendu. «gai savoir»: cela signifie les saturnales d’un esprit qui a résisté patiemment à une pression effroyablement longue – patiemment, fortement, froidement, sans se soumettre, mais sans espoir –, et qui d’un seul coup est assailli par l’espoir, par l’espoir de santé, par l’ivresse de la guérison. Comment s’étonner que cela mette au jour beaucoup de déraisonnable et de fou, beaucoup de tendresse vandale gaspillée à des problèmes qui ont le poil piquant et qui ne sont pas conçus pour être cajolés et séduits. Ce livre entier n’est rien que réjouissance après une longue privation et impuissance, la jubilation des forces revenues, de la foi éveillée de nouveau en un demain et en un lendemain, du soudain sentiment et du pressentiment de l’avenir, des aventures proches, des mers réouvertes, des buts de nouveau permis, en lesquels de nouveau avoir foi. Et tout ce qui était derrière moi alors! Ce bout de désert, d’épuisement, d’incroyance, de givre au milieu de la jeunesse, cette état de vieillard intervenant au mauvais endroit, cette tyrannie de la douleur encore dépassée par la tyrannie de la fierté, qui repoussait les conclusions de la fierté – et les conclusions sont des consolations -, cette solitude radicale comme défense contre un mépris de l’humanité devenu maladivement lucide, cette réduction fondamentale sur ce que la connaissance a d’amer, d’âpre, de douloureux, et comment la prescrivait le dégoût qui d’une peu prudente diète et complaisance spirituelle – on l’appelle romantisme – avait peu a peu grandi, oh qui pourrait le sentir après moi! Mais celui qui pourrait m’accorderait sans doute davantage qu’un peu de folie, d’exubérance de «gai savoir», – par exemple la poignée de chants qui cette fois sont jointes à ce livre – des chants dans lesquels un poète d’une façon difficilement pardonnable se moque de tous les poètes. – Ah, ce n’est pas seulement sur les poètes et leurs beaux «sentiments lyriques» que ce ressuscité doit exercer sa méchanceté: qui sait quelle victime il se cherche, quel monstre d’étoffe parodique le provoquera sous peu? «Incipit tragoedia» – c’est la fin de ce livre préoccupant-non-préoccupant: il faudra être sur ses gardes! Est donné congé à quelque chose d’exemplairement grave et méchant: incipit parodia, il n’y a aucun doute…
II.
– Mais laissons là Monsieur Nietzsche: qu’est-ce que ça peut nous faire que Monsieur Nietzsche ait retrouvé la santé?…Un psychologue connaît peu de questions aussi attirantes que celle du rapport entre la santé et la philosophie, et au cas où il tombe lui-même malade, il apporte toute sa curiosité scientifique avec lui dans la maladie. On a en effet, à supposer que l’on soit une personne, nécessairement la philosophie de sa personne: mais il y a là une différence considérable. Chez l’un ce sont ses manques qui philosophent, chez l’autre ses richesses et ses forces. Le premier a la nécessité de sa philosophie, ne serait-ce que comme appui, apaisement, médecine, soulagement, élévation, mise à distance de lui-même; chez l’autre elle n’est qu’un beau luxe, dans le meilleur cas la volupté d’une gratitude triomphante, qui doit quand même pour finir s’inscrire en majuscules cosmiques au ciel des notions. Dans l’autre, dans les cas les plus habituels toutefois, quand les états de nécessité font la philosophie, comme chez tous les penseurs malades – et peut-être que les penseurs malades sont majoritaires dans l’histoire de la philosophie –: qu’est-ce qu’il sera de la pensée même qui est soumise à la pression de la maladie? Voilà la question qui concerne le psychologue: et ici l’expérimentation est possible. Pas autrement que ne le fait un voyageur qui résout de se réveiller à une heure déterminée et qui ensuite se livre tranquille au sommeil: ainsi nous philosophes à supposer que nous tombions malade, nous nous abandonnons temporairement corps et âme à la maladie – nous fermons pour ainsi dire les yeux devant nous. Et comme celui-là sait que quelque chose ne dort pas, que quelque chose compte les heures et le réveillera, ainsi nous aussi nous savons que l’instant décisif nous trouvera éveillé, – qu’ensuite quelque chose surgit et prend l’esprit sur le fait, je veux dire la faiblesse ou le changement d’avis ou la résignation ou l’endurcissement ou l’empoussièrement et toutes ces façons de désigner l’état maladif de l’esprit, qui aux jours de la santé ont contre elles la fierté de l’esprit (car on en reste au vieux dicton «l’esprit fier, le paon, le cheval sont les trois bêtes les plus fières»-). Après une telle interrogation de soi-même, tentation de soi-même, on apprend à regarder d’un œil plus fin tout ce qui dans l’absolu a été philosophé jusqu’alors; on devine mieux qu’avant les involontaires détours, ruelles latérales, places pour le repos, endroits ensoleillés de la pensée, sur lesquels sont conduits et séduits les penseurs souffrants justement en tant que souffrants, on sait désormais où inconsciemment le corps malade et ses besoins entraîne l’esprit, le pousse, l’attire – vers le soleil, le calme, la douceur, la patience, la médecine, le baume en un sens quelconque. Chaque philosophie qui met la paix au dessus de la guerre, chaque éthique avec une conception négative du concept de bonheur, chaque métaphysique et physique qui connaît un point final, un état final de quelque nature que ce soit, chaque exigence principalement esthétique ou religieuse d’un en-marge, d’un au-delà, d’un en-dehors, d’un au-dessus, autorise à se demander si ce n’est pas la maladie qui a inspiré le philosophe. Le déguisement inconscient des besoins physiologiques sous le manteau de l’objectif, de l’idéal, du purement spirituel s’étend loin jusqu’à l’épouvante, – et bien souvent je me suis demandé si, en fin de compte, la philosophie jusqu’alors n’avait pas été qu’une interprétation du corps et un malentendu du corps. Derrière les plus hauts jugements de valeur par lesquels l’histoire de la pensée a été menée jusqu’ici, gisent dissimulés des malentendus sur la texture corporelle, soit de l’individu, soit des états ou des races entières. Il faut dans un premier temps toujours prendre toutes les folies de la métaphysiques, en particulier ses réponses à la question de la valeur de l’existence, comme les symptômes de corps bien précis; et si ces approbations du monde ou négations du monde en bloc, mesurées scientifiquement, ne contiennent pas une graine de signification, en revanche elles donnent à l’historien et au psychologue des indices d’autant plus valables qu’ils sont des symptômes, comme déjà dit, du corps, de ce qui lui réussit et de ce qu’il manque, de sa plénitude, de sa puissance, de sa domination de soi dans l’histoire, ou bien au contraire de ses scrupules, de ses épuisements, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté de fin. J’attends toujours qu’un médecin philosophique dans le sens extraordinaire du terme – un homme tel qu’il puisse s’occuper de la santé d’ensemble du peuple, de l’époque, de la race, de l’humanité – aie le courage de promouvoir jusqu’à son terme mon soupçon et d’oser cette phrase: dans toute la philosophie il s’est agi jusqu’ici non pas de vérité, mais de quelque chose d’autre, disons de santé, avenir, croissance, puissance, vie…
III.
– On devine que je veux sans ingratitude prendre congé de cette époque de lourd dépérissement, dont les gains ne sont pas encore épuisées pour moi aujourd’hui: de même que je suis absolument conscient de l’avantage que j’ai avec ma santé changeante sur tous les trapus de l’esprit. Un philosophe qui fait le chemin à travers de nombreuses santés et qui continue à le faire, a traversé autant de philosophies: il ne peut qu’appliquer à chaque fois l’état dans lequel il est à la forme et au monde spirituels – cet art de la transfiguration c’est précisément la philosophie. Il n’est pas libre à nous philosophes de séparer âme et corps comme le fait le peuple, il nous est encore moins libre de séparer âme et esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, pas des appareils à objectiver et à enregistrer et aux viscères froides, – nous devons continuellement enfanter nos pensées de notre douleur et maternellement leur donner tout ce que nous avons en nous de sang, cœur, feu, désir, passion, tourment, conscience, destin, fatalité. Vivre – cela veut dire pour nous continuellement transformer tout ce que nous sommes en lumière et flamme, et aussi tout ce qui nous touche, nous ne pouvons autrement. Et pour ce qui concerne la maladie: ne serions nous pas presque tentés de nous demander si elle nous est superflue absolument? C’est seulement la grande douleur qui est la dernière libératrice de l’esprit, comme le maître d’apprentissage du grand soupçon, qui fait de chaque U un X, un vrai X véritable, ce qui veut dire l’avant dernière lettre avant la dernière…C’est seulement la grande douleur, cette longue lente douleur qui prend son temps, dans laquelle nous sommes comme brûlés dans un feu de bois vert, qui nous force nous philosophes à descendre dans notre tréfonds ultime et à nous défaire de toute confiance, de tout ce qui est bon, dissimulant, doux, moyen, dans quoi nous avons peut-être auparavant placé notre humanité. Je doute qu’une telle douleur «améliore» –; mais je sais qu’elle approfondit. Soit parce que nous apprenons à lui opposer notre fierté, notre sarcasme, notre volonté et que nous faisons comme l’indien qui, si violemment torturé soit-il, se dédommage de son tortureur par la méchanceté de sa langue; soit parce que devant la douleur nous nous retirons dans ce néant oriental – on l’appelle Nirvana – dans le muet, raide, sourd abandon de soi, oubli de soi, dissolution de soi: on ressort de tels longs, dangereux exercices de maîtrise de soi comme un autre homme, avec quelques nouveaux points d’interrogation, avant tout avec la volonté d’interroger à présent davantage, d’interroger plus profondément, plus sévèrement, plus durement, plus méchamment, plus calmement que l’on avait interrogé jusque là. C’en est fini de la confiance en la vie – la vie même est devenu problème. – Qu’on ne croie pas qu’on en devient nécessairement un sombre type! Même l’amour de la vie est encore possible – mais on aime autrement. C’est l’amour pour une femme qui nous fait douter… Le charme de tout ce qui pose problème, la joie en X est en revanche chez de tels gens plus spirituels, plus spiritualisés, trop grande pour que cette joie ne se déverse pas toujours telle une claire lueur sur toute la détresse du problème, sur tout le danger de l’incertitude, et même sur la jalousie de l’amant. Nous connaissons un bonheur nouveau…
IV.
Enfin, pour ne pas laisser l’essentiel non dit: on sort de tels abîmes, d’un si grave dépérissement, et aussi du dépérissement du grave soupçon, comme né de nouveau, mué, plus délicat, plus méchant, avec un goût plus fin pour la joie, avec une langue plus délicate pour toutes les bonnes choses, avec des sens plus gais, avec une deuxième dangereuse innocence dans la joie, plus enfant à la fois et cent fois plus raffiné que l’on ne l’a jamais été. Oh comme la jouissance répugne désormais, la grossière sourde brune jouissance telle que la comprennent sinon les jouisseurs, nos «cultivés», nos riches et gouvernants! Avec quelle méchanceté nous écoutons désormais le gros boum-boum de foire annuelle par lequel l’«homme cultivé» et l’habitant des grandes villes se fait violer à travers art, livre et musique, pour des «jouissances spirituelles», avec l’aide de boissons spirituelles! Combien maintenant nous fait mal aux oreilles le cri théâtral de la passion, comme est devenu étranger à notre goût toute l’émeute romantique et le fatras des sens qu’aime la populace cultivée, avec ses aspirations au sublime, à l’élevé, à l’extravagant! Non, s’il faut absolument que nous qui guérissons ayons besoin d’art, c’est d’un autre art – un art moqueur, léger, fugitif, divinement désembarassé, divinement artificiel, qui comme une flamme claire nous fait grimper dans un ciel sans nuage! Avant tout: un art pour les artistes, seulement pour les artistes! Nous nous entendons mieux à ce qui est la première nécessité en la matière, la gaieté, toute gaieté, mes amis! aussi en tant qu’artistes –: je voudrais le prouver. Nous savons trop bien plusieurs choses à présent, nous les savants: oh comme désormais nous apprenons à bien oublier, à bien ne pas savoir, en tant qu’artistes! Et pour ce qui touche à notre avenir: on nous trouvera difficilement encore sur les chemins de ces jeunes égyptiens, qui la nuit rendent les temples peu sûrs, qui embrassent les colonnes sculptées et qui dévoilent, découvrent, veulent étaler dans la claire lumière absolument tout ce qui a été avec de bonnes raisons dissimulé. Non, ce mauvais goût, cette volonté de vérité, de «vérité à tout prix», ce délire de jeune homme dans l’amour de la vérité – nous n’y avons plus goût: nous sommes pour cela trop expérimentés, trop sérieux, trop joyeux, trop consumés, trop profonds… Nous ne croyons plus que la vérité reste la vérité quand on lui retire son voile; nous avons trop vécu pour croire encore à cela. Aujourd’hui une chose nous semble convenable: ne pas vouloir voir toute chose nue, ne pas vouloir être là pour toute chose, ne pas vouloir tout comprendre et «savoir. «Est-ce que c’est vrai que le bon Dieu est partout?» demandait une petite fille à sa mère: «mais je trouve ça indécent» – un signe pour les philosophes! On devrait davantage honorer la honte avec laquelle la nature s’est cachée derrière des énigmes et des incertitudes colorées. Peut-être la vérité est une femme qui a des raisons de ne pas laisser voir ses raisons? Peut-être que son nom est, pour parler grec, Baubo? … Oh ces Grecs! Ils s’y entendaient à vivre: et il est nécessaire de s’en tenir bravement à la surface, au pli, à la peau, d’adorer l’apparence, de croire aux formes, aux sons, aux paroles, à toute l’Olympe de l’apparence! Ces Grecs étaient superficiels – par profondeur! Et n’y revenons nous pas justement, nous les intrépides de l’esprit, qui avons escaladé les plus hauts et dangereux sommets de l’esprit actuel et de là avons regardé autour de nous, qui de là avons regardé en contrebas? N’y sommes nous pas justement – des Grecs? Adorateurs des formes, des sons, des paroles? Justement pour cela – des artistes?
Ruta près de Gênes, à l’automne 1886.
(Traduit par Claire Placial)