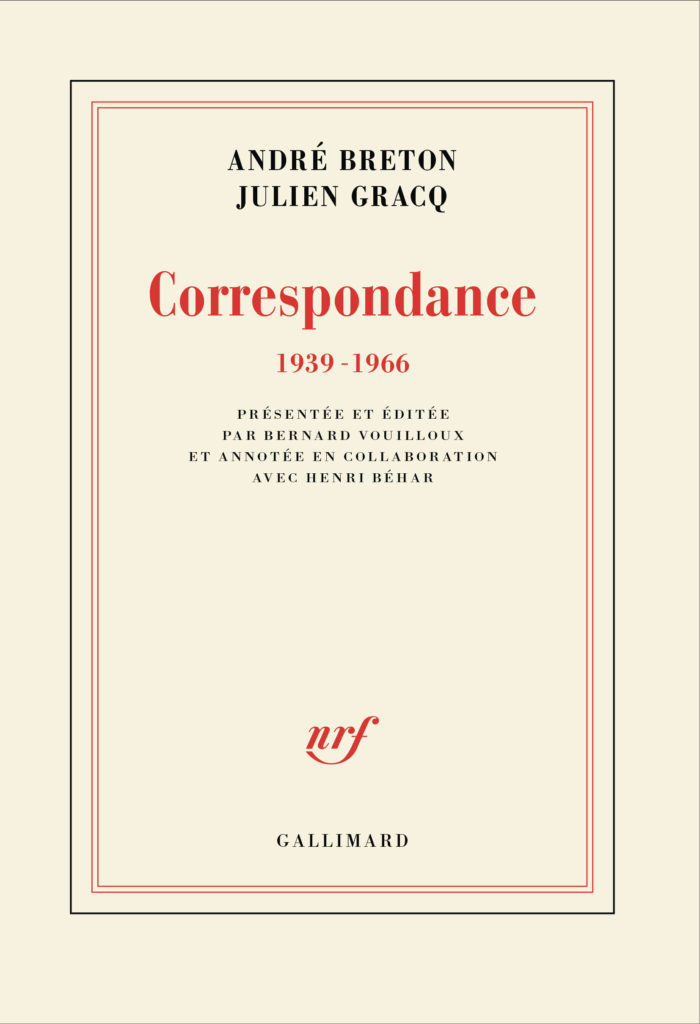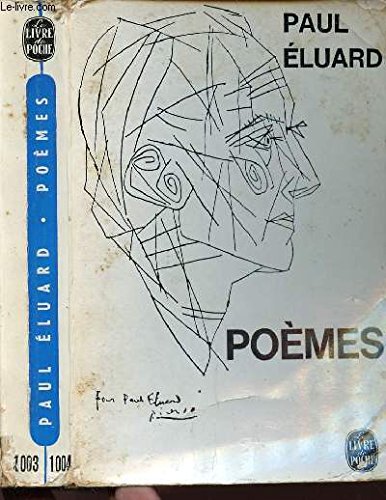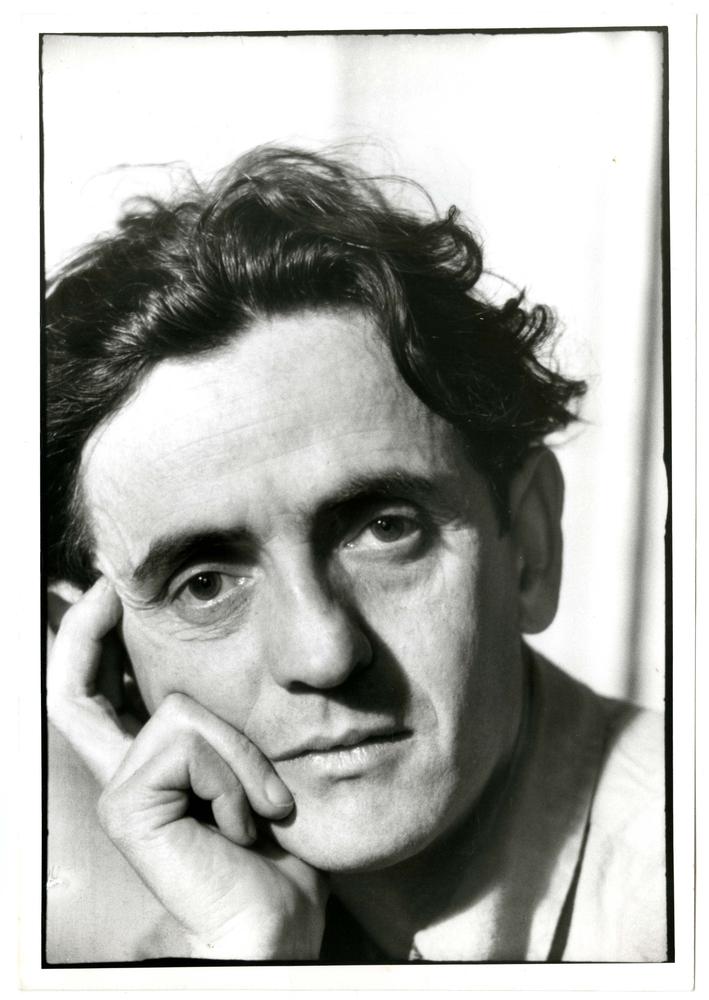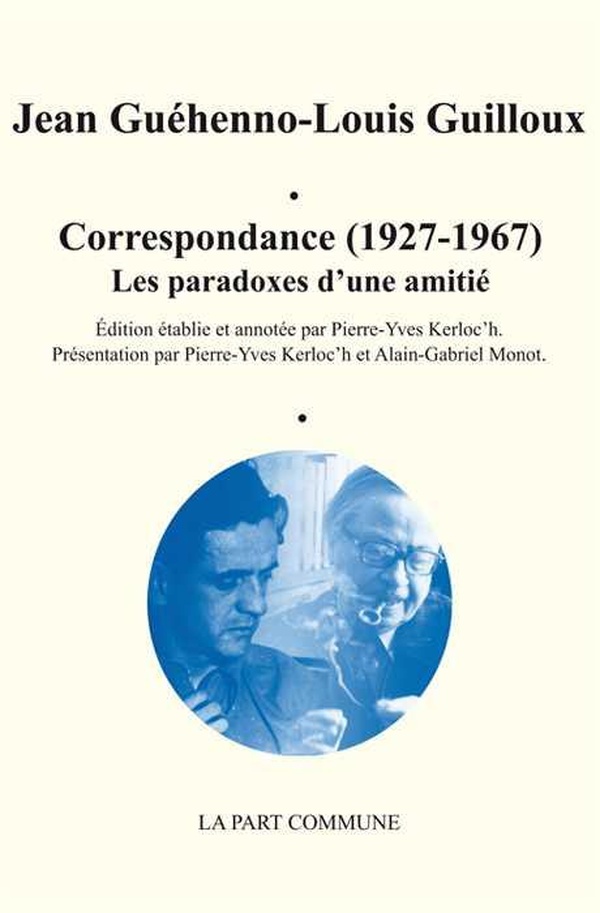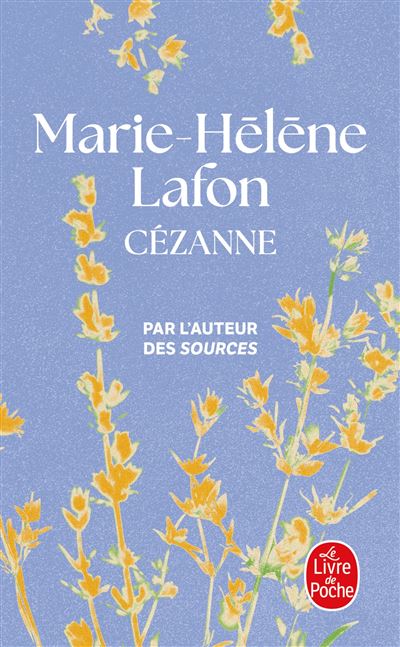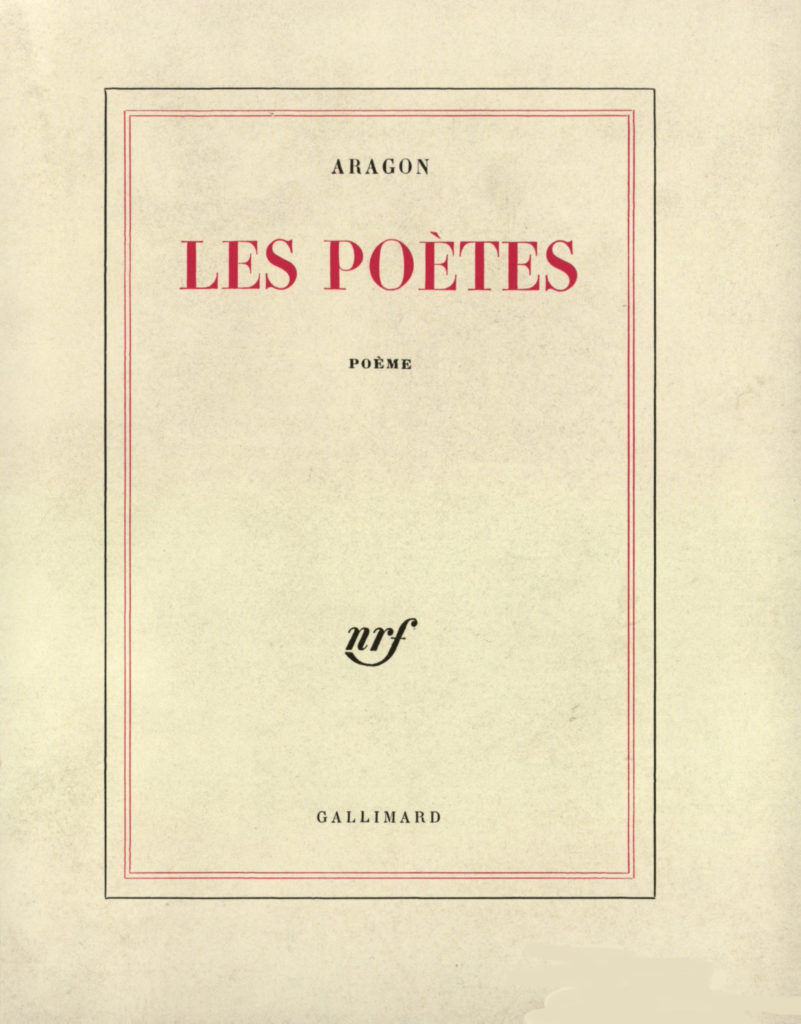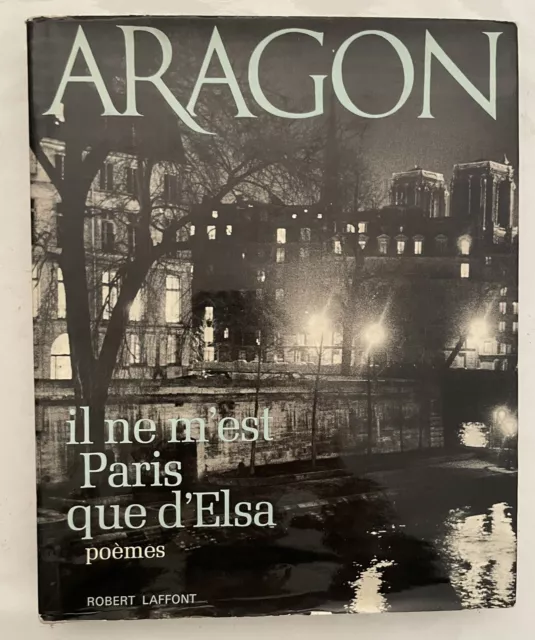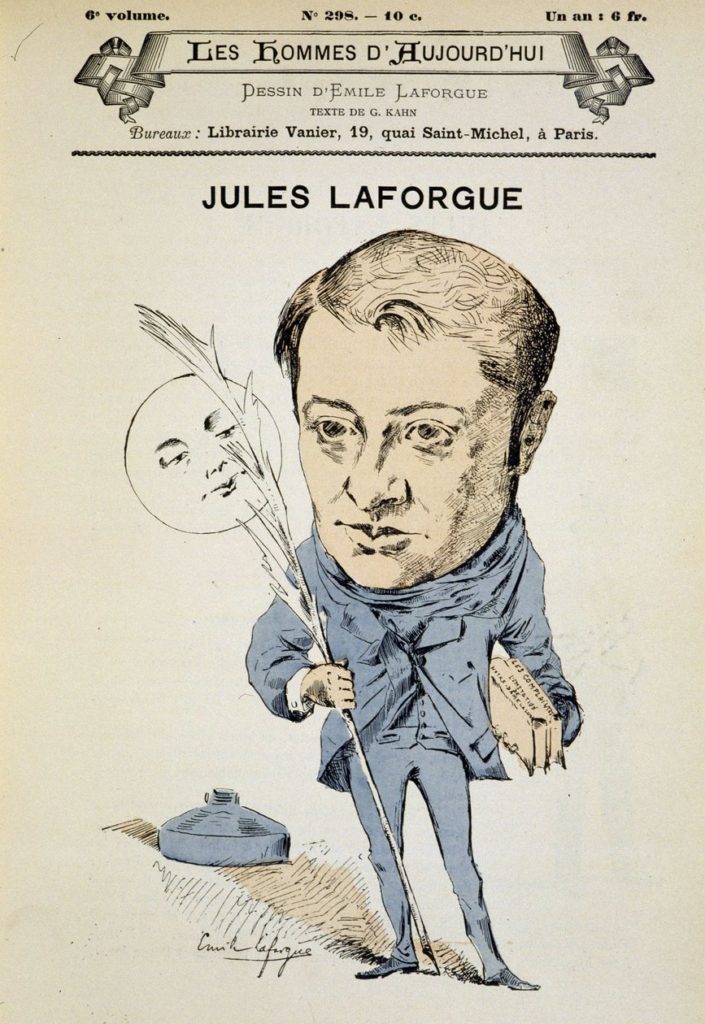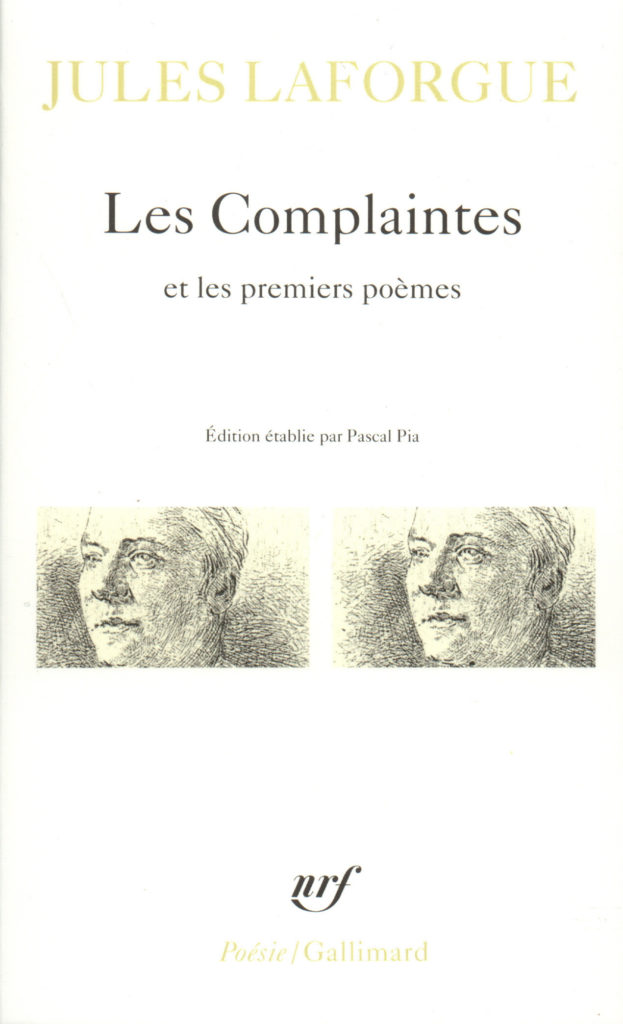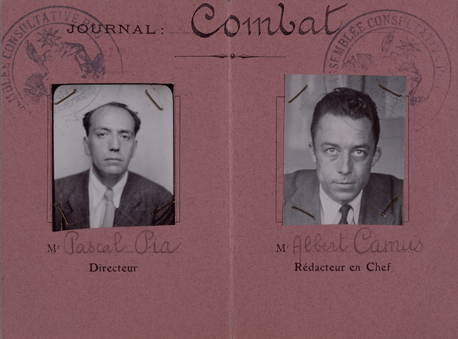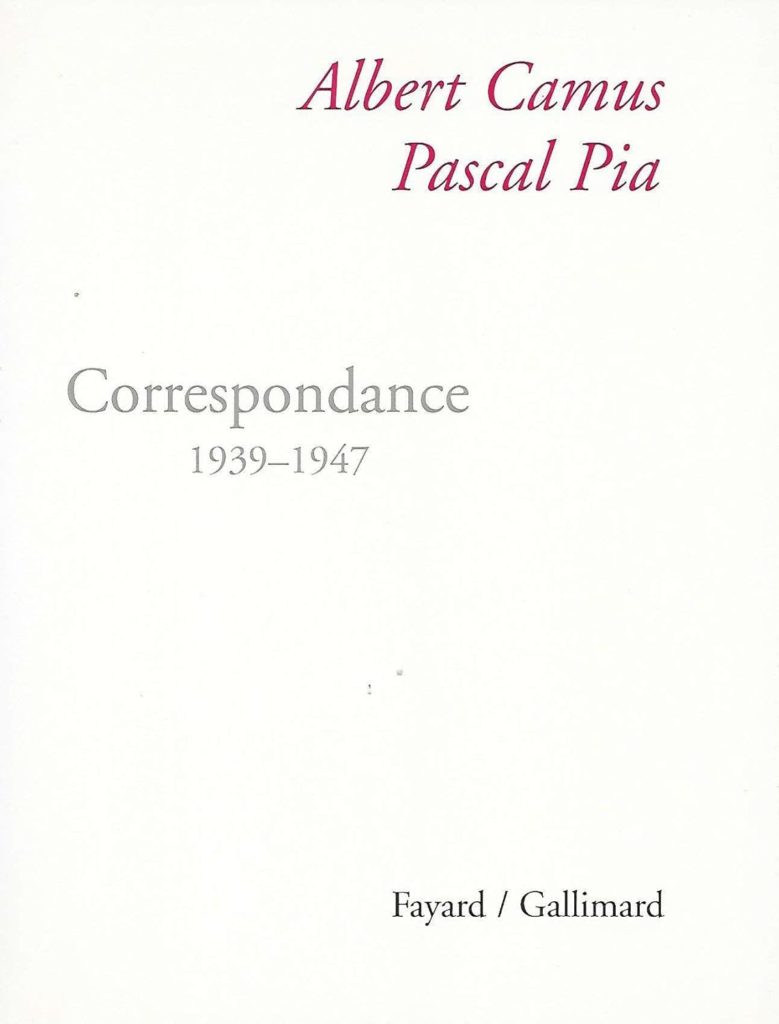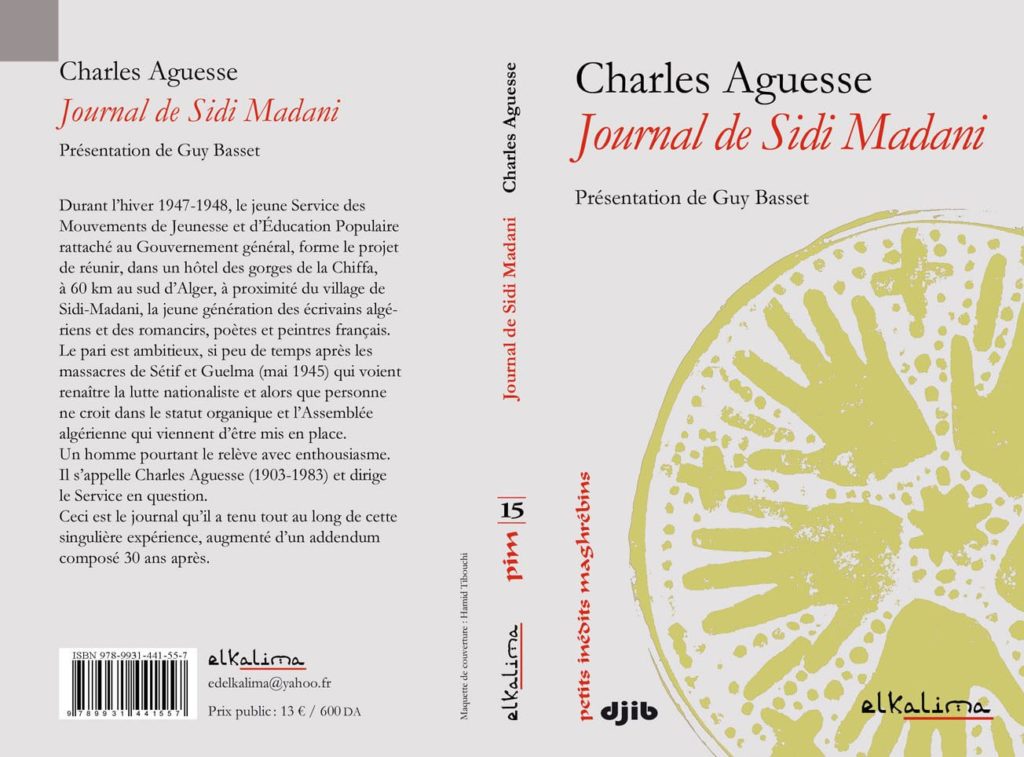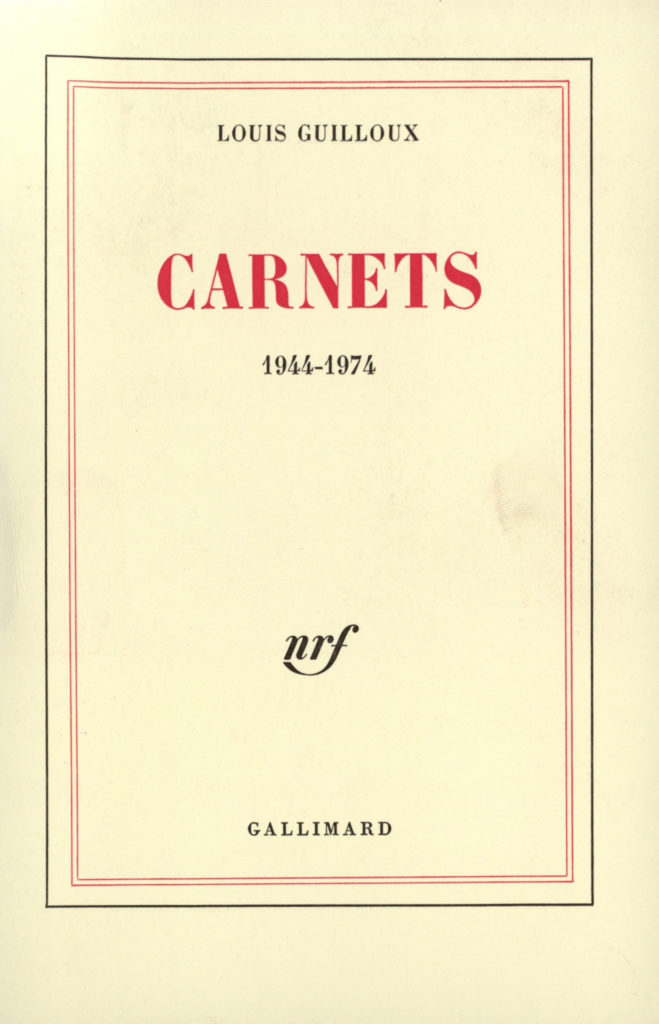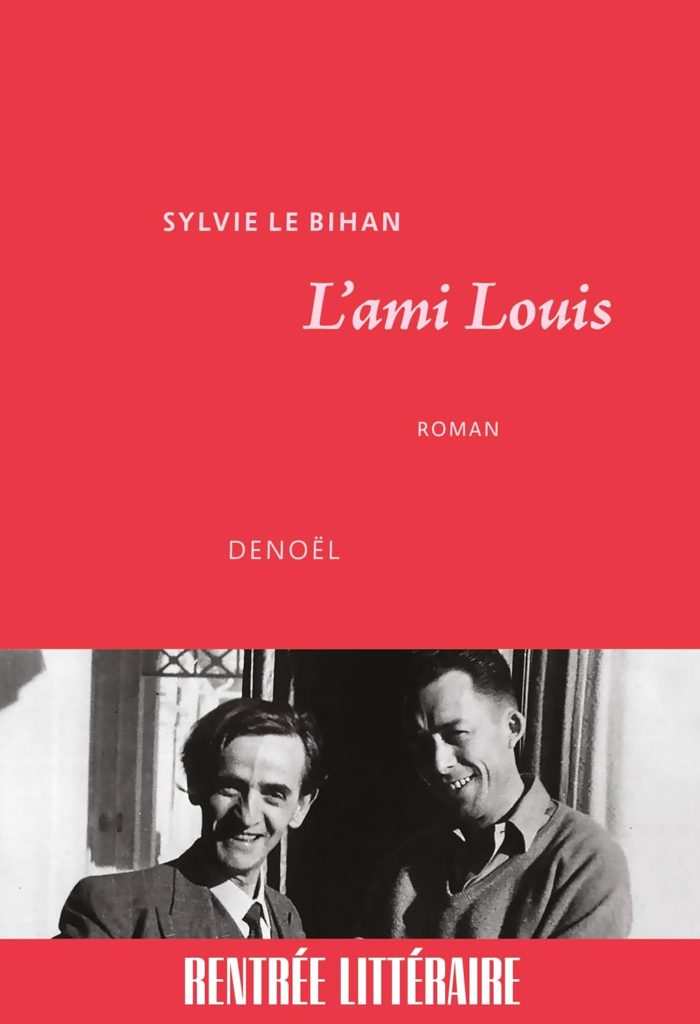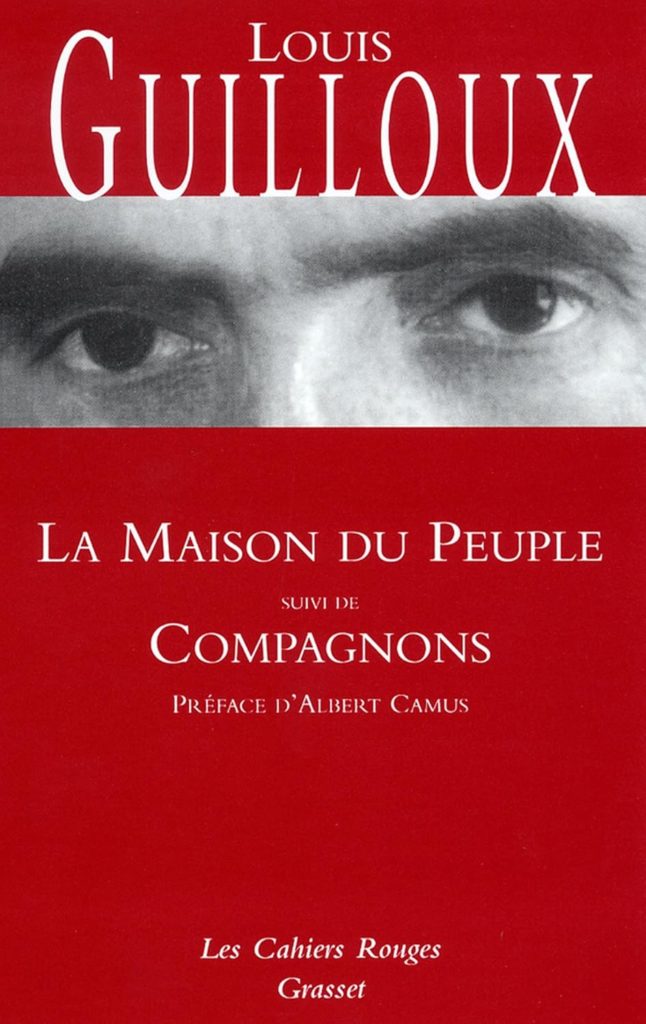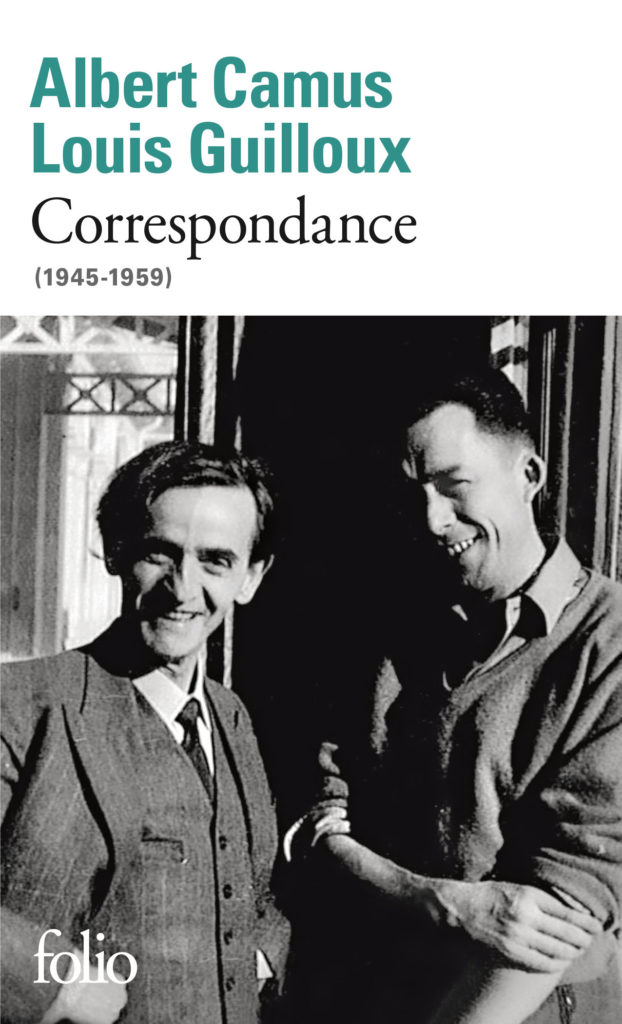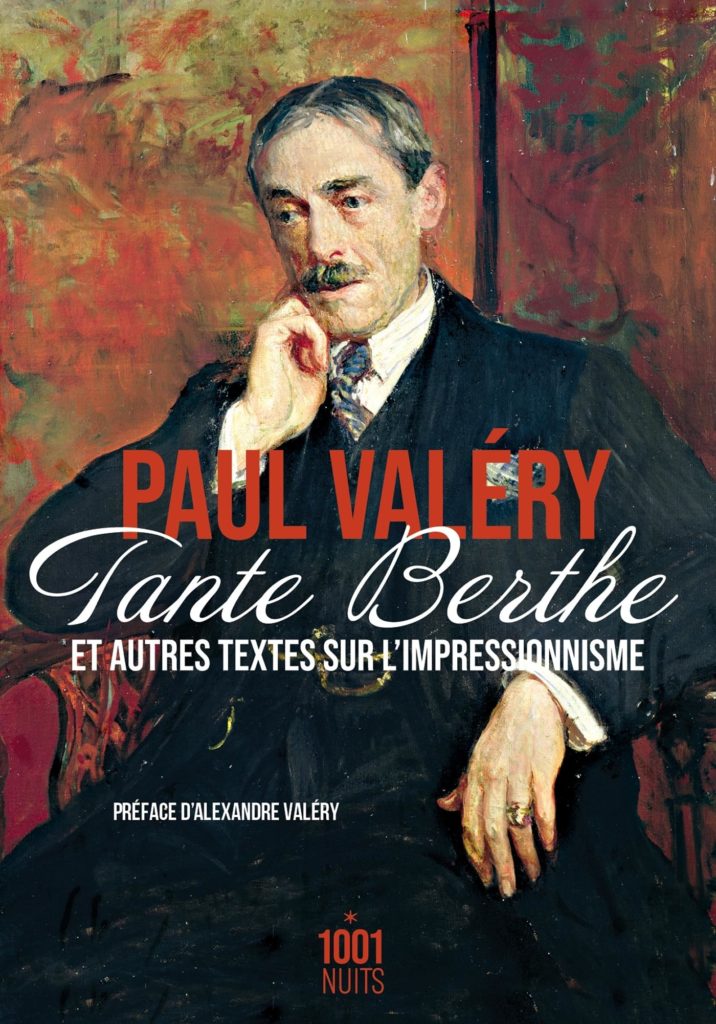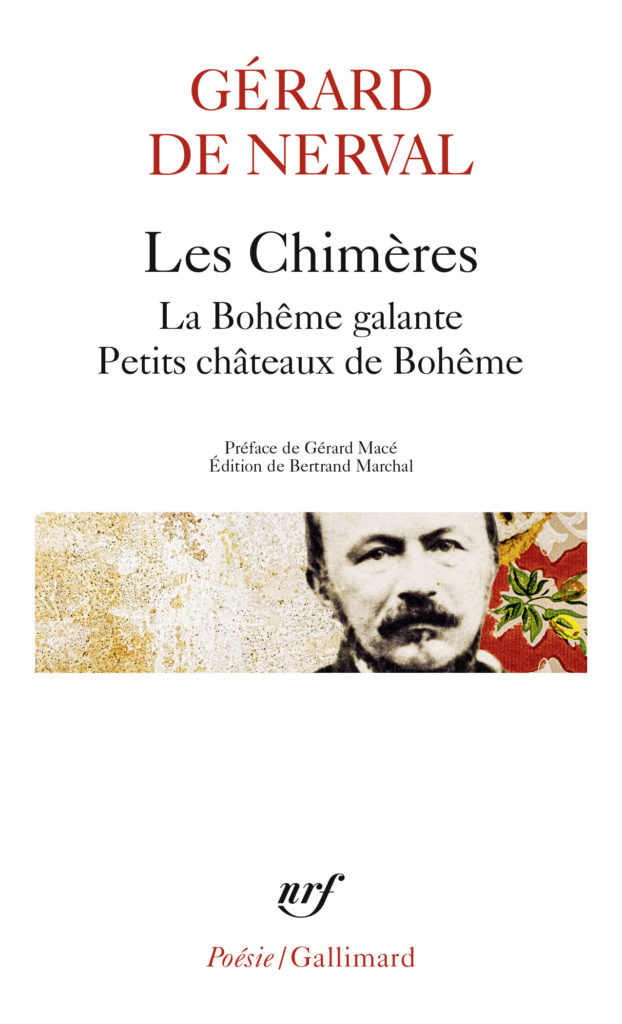À la fin de 1949, Nora Mitrani (1921-1961), écrivaine surréaliste et sociologue, visite pendant trois mois le Portugal, où vivait son oncle maternel. À l’invitation du Groupe Surréaliste de Lisbonne, elle fait une conférence au Jardin universitaire des Beaux-Arts le 12 janvier 1950. Celle-ci a été traduite par le poète portugais Alexandre O’Neill (1924-1986) et publiée sous forme de brochure : A Razão Ardente (do Romanticismo ao Surrealismo), Cuadernos Surrealistas, Lisboa, 1950.
Ce texte n’a pas été inclus dans l’anthologie de ses écrits, Rose au coeur violet (Paris, Éditions Terrain Vague, collection Le Désordre, Losfeld, 1988), réunis par Dominique Rabourdin avec une préface de Julien Gracq.
Il n’a été publié pour la première fois en français qu’en 2025 par les éditions le Retrait (La raison ardente Du romantisme au surréalisme).
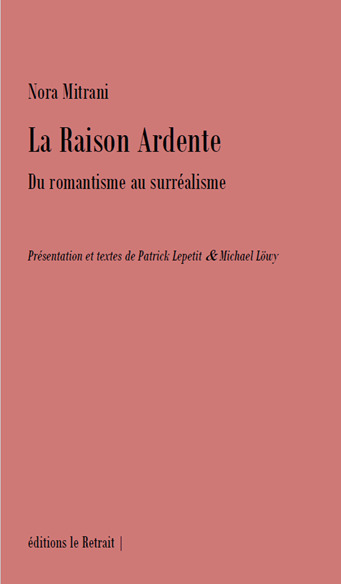
Nora Mitrani et Alexandre O’Neill eurent une courte relation amoureuse. Mais, le poète portugais, privé de passeport par la Pide, la police politique du régime salazariste, ne pouvait pas sortir du pays. Il ne la revit plus. Il ne put jamais oublier cette brève mais intense rencontre et il lui dédia le poème Un adieu portugais (Um Adeus Português) en 1951. Il publia aussi Six poèmes confiés à la mémoire de Nora Mitrani, inclus dans son recueil Poemas con Endereço (Poèmes avec adresse, 1962). Nora Mitrani deviendra la compagne de Julien Gracq en 1953 et mourra d’un cancer à 39 ans le 22 mars 1961.
Um Adeus Português (Alexandre O’Neill)
Nos teus olhos altamente perigosos
vigora ainda o mais rigoroso amor
a luz de ombros puros e a sombra
de uma angústia já purificada
Não tu não podias ficar presa comigo
à roda em que apodreço
apodrecemos
a esta pata ensanguentada que vacila
quase medita
e avança mugindo pelo túnel
de uma velha dor
Não podias ficar nesta cadeira
onde passo o dia burocrático
o dia-a-dia da miséria
que sobe aos olhos vem às mãos
aos sorrisos
ao amor mal soletrado
à estupidez ao desespero sem boca
ao medo perfilado
à alegria sonâmbula à vírgula maníaca
do modo funcionário de viver
Não podias ficar nesta cama comigo
em trânsito mortal até ao dia sórdido
canino
policial
até ao dia que não vem da promessa
puríssima da madrugada
mas da miséria de uma noite gerada
por um dia igual
Não podias ficar presa comigo
à pequena dor que cada um de nós
traz docemente pela mão
a esta pequena dor à portuguesa
tão mansa quase vegetal
Não tu não mereces esta cidade não mereces
esta roda de náusea em que giramos
até à idiotia
esta pequena morte
e o seu minucioso e porco ritual
esta nossa razão absurda de ser
Não tu és da cidade aventureira
da cidade onde o amor encontra as suas ruas
e o cemitério ardente
da sua morte
tu és da cidade onde vives por um fio
de puro acaso
onde morres ou vives não de asfixia
mas às mãos de uma aventura de um comércio puro
sem a moeda falsa do bem e do mal
*
Nesta curva tão terna e lancinante
que vai ser que já é o teu desaparecimento
digo-te adeus
e como um adolescente
tropeço de ternura
por ti
Publié dans la revue Unicórnio (Juin 1951), puis dans le livre Tempo de Fantasmas (Temps de fantômes) (novembre 1951).
Un adieu portugais
Dans tes yeux hautement dangereux
l’amour le plus rigoureux revigore toujours
la lumière par ombres pures et l’ombre
par une angoisse déjà bien purifiée
Non toi tu ne pouvais rester prise avec moi
à cette roue où je pourris
nous pourrissons
à cette patte ensanglantée toute frissons
presque méditation
qui avance en mugissant dans le tunnel
d’une vieille douleur
Tu ne pouvais rester fixée à cette chaise
où je passe mes jours bureaucratiques
cet au-jour-le-jour du malheur
qui monte aux yeux arrive aux mains
aux sourires
à l’amour à peine épelé
à la stupidité au désespoir sans bouche
à la peur profilée
à la joie somnambule à la virgule maniaque
du mode fonctionnaire de vie
Tu ne pouvais rester dans ce lit avec moi
dans un transit mortel jusqu’au sordide jour
jour canin
policier
jusqu’au jour qui ne vient pas de la promesse
si pure et plus que pure de l’aurore
mais du malheur d’une nuit engendrée
par un jour identique
Tu ne pouvais tester prise avec moi
à l’infime douleur que chacun d’entre nous
porte doucement dans sa main
à cette infime douleur-à-la-portugaise
si moelleuse presque végétale
Non toi tu ne mérites pas cette cité tu ne mérites pas
cette roue de nausée où nous tournons
jusqu’à la bêtise
cette petite mort
avec son minutieux rituel de gros porcs
cette absurde raison que nous avons à être
Non toi tu es de la cité aventureuse
de la cité en qui l’amour trouve ses rues
et le cimetière ardent
de sa mort
tu es de la cité où tu vis sur un fil
de pur hasard
où tu meurs et vis non pas d’asphyxie
mais dans les mains d’une aventure d’un commerce pur
sans la fausse monnaie du bien et du mal
*
Dans ce tournant si tendre et lancinant
que va être, qu’est déjà ta disparition
je te dis adieu
comme un adolescent
je balbutie de tendresse
pour toi
Traduction de Patrick Quillier.
La Poésie du Portugal des origines au XX e siècle. Chandeigne, 2021.