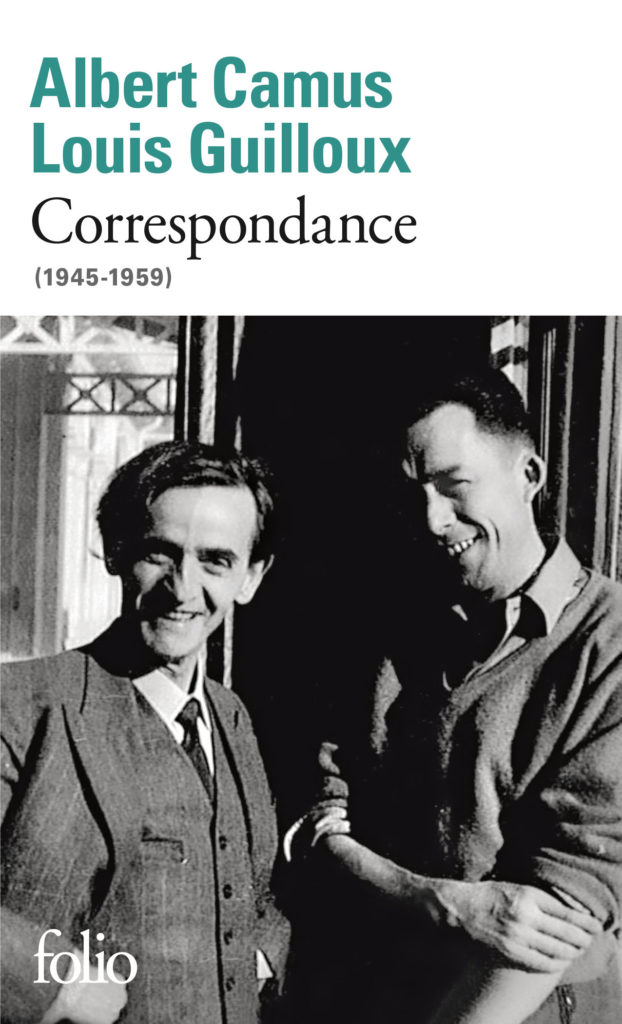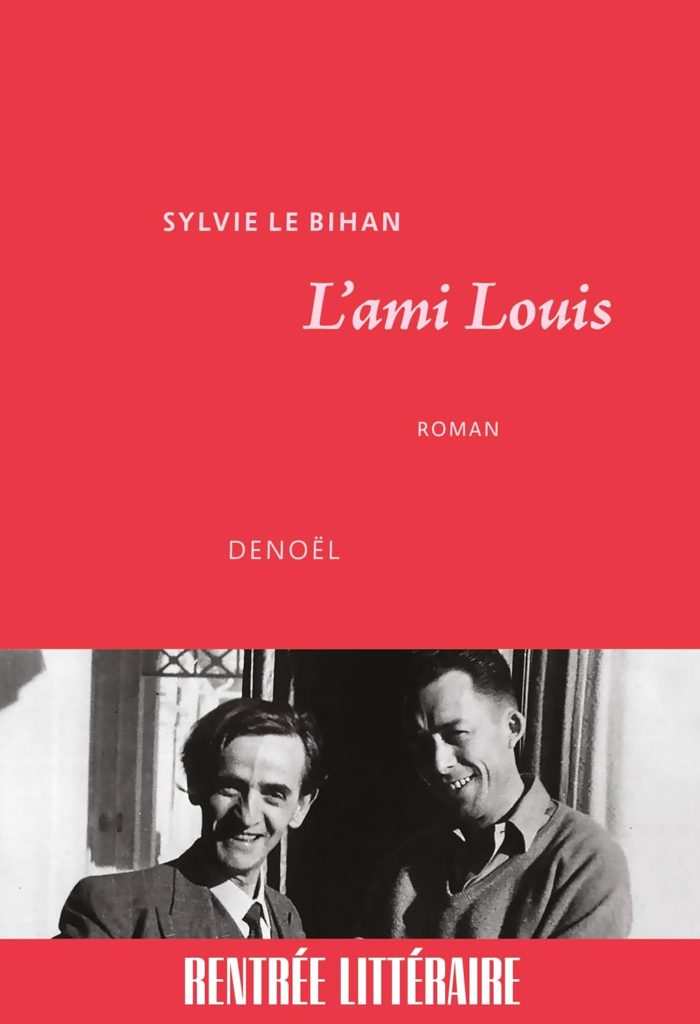
Je viens de lire L’ami Louis de Sylvie Le Bihan, Denoël, 2025. Le roman est assez décevant, mais son intérêt est de nous permettre de nous replonger dans l’oeuvre d’un des grands romanciers français du XXe siècle : Louis Guilloux (1899-1980).
Je renvoie à la recension de Gilles Cervera de cette nouveauté de ” la rentrée littéraire ” dans La Cause Littéraire :
https://www.lacauselitteraire.fr/sylvie-le-bihan-l-ami-louis-par-gilles-cervera
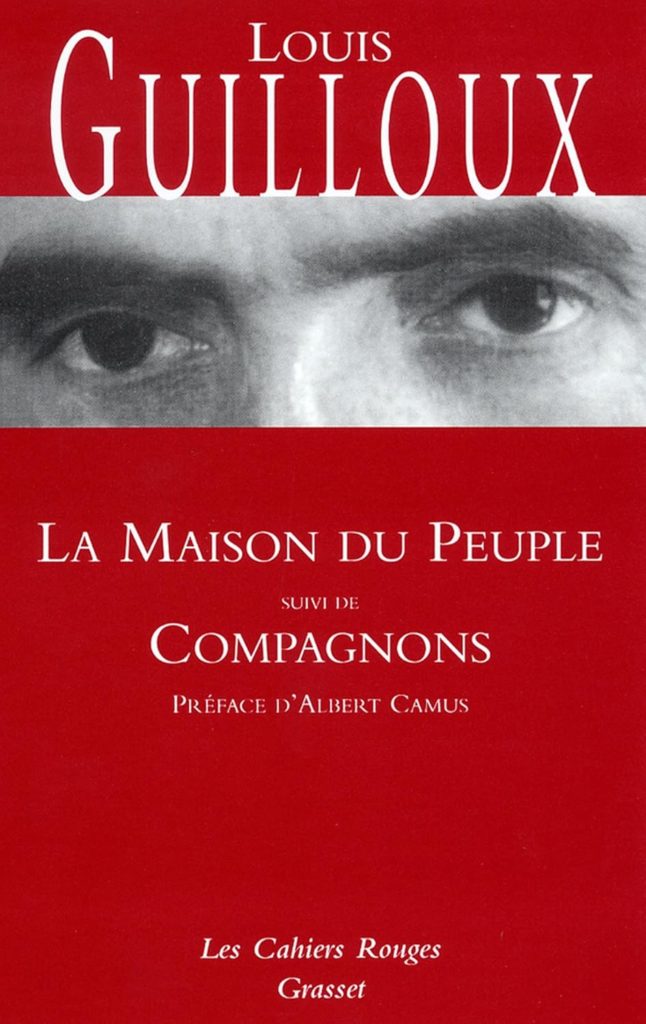
L’amitié entre Albert Camus et Louis Guilloux a été essentielle pour les deux auteurs. Le prix Nobel 1957 a fait une belle préface à La Maison du peuple, premier roman de son ami breton dont la première édition date de 1927.
Préface d’Albert Camus à La Maison du Peuple de Louis Guilloux. Caliban n°13, janvier 1948. Grasset, 1953. Les cahiers rouges, 2004.
Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd’hui parler au nom du prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés. Ce n’est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance, et je ne trouve cela ni bien ni mal. Je me borne à signaler au sociologue une anomalie et un objet d’études. On peut d’ailleurs essayer d’expliquer ce paradoxe en soutenant, avec un sage de mes amis, que parler de ce qu’on ignore finit par vous l’apprendre.
Il reste qu’on peut avoir ses préférences. Et, pour moi, j’ai toujours préféré qu’on témoignât, si j’ose dire, après avoir été égorgé. La pauvreté, par exemple, laisse à ceux qui l’ont vécue une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause. Dans les périodiques et les livres rédigés par les spécialistes du progrès, on traite souvent du prolétariat comme d’une tribu aux étranges coutumes et on en parle alors d’une manière qui donnerait aux prolétaires la nausée si seulement ils avaient le temps de lire les spécialistes pour s’informer de la bonne marche du progrès. De la flatterie dégoûtante au mépris ingénu, il est difficile de savoir ce qui, dans ces homélies, est le plus insultant. Ne peut-on vraiment se priver d’utiliser et de dégrader ce qu’on prétend vouloir défendre ? Faut-il que la misère toujours soit volée deux fois ? Je ne le pense pas. Quelques hommes au moins, avec Vallès et Dabit, ont su trouver le seul langage qui convenait. Voilà pourquoi j’admire et j’aime l’oeuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui lui restitue la seule grandeur qu’on ne puisse lui arracher, celle de la vérité.
Ce grand écrivain, parce qu’il a fait ses classes à l’école de la nécessité, a appris à juger sans embarras de ce qu’est un homme. Il y a gagné du même coup une sorte de pudeur qui semble mal partagée dans le monde où nous vivons et qui l’empêchera toujours d’accepter que la misère d’autrui puisse être un marchepied, ni qu’elle puisse offrir un sujet de pittoresque pour lequel seul l’artiste n’aurait pas à payer. D.H.Lawrence rapportait souvent à sa naissance dans une famille de mineurs ce qu’il y avait de meilleur en lui-même et dans son oeuvre. Mais Lawrence et ceux qui lui ressemblent savent que, si l’on peut prêter une grandeur à la pauvreté, l’asservissement qui l’accompagne presque toujours ne se justifiera jamais. Par dessus eux-mêmes, leurs oeuvres portent condamnation, et les livres de Guilloux ne se soustraient pas à ce grand devoir. De La Maison du Peuple, son premier livre au Pain des rêves et au Jeu de Patience, ils témoignent tous d’une fidélité. L’enfance pauvre, avec ses rêves et ses révoltes, lui a fourni l’inspiration de son premier et de ses derniers livres. Rien n’est plus dangereux qu’un tel sujet qui prête au réalisme facile et à la sentimentalité. Mais la grandeur d’un artiste se mesure aux tentations qu’il a vaincues. Et Guilloux, qui n’idéalise rien, qui peint toujours avec les couleurs les plus justes et les moins crues, sans jamais rechercher l’amertume pour elle-même, a su donner au style les pudeurs de son sujet. Ce ton un et pur, cette voix un peu sourde qui est celle du souvenir témoigne pour celui qui raconte, vertus de style qui sont aussi celles de l’homme.
On mesure mieux encore la tentation vaincue en voyant Guilloux prendre pour sujet unique de Compagnons la mort d’un ouvrier. La pauvreté et la mort font ensemble un ménage si désespéré qu’il semblerait qu’on ne puisse en parler sans être Keats, si sensible, a-t-on dit, qu’il aurait pu toucher de ses mains la douleur elle-même. Il n’empêche que dans ce petit livre, qui a le ton des grandes nouvelles de Tolstoï (Ivan Ilitch, ici, est devenu maçon), Guilloux ne cesse de se maintenir à la hauteur exacte de son modèle, et surtout, oui, surtout, sans le majorer. Pas une seule fois le ton ne s’élève. Je défie pourtant qu’on lise ce récit sans le terminer la gorge serrée. Guilloux sait comme tous qu’il y a un tarif de la mort dans nos belles entreprises municipales et que mourir est devenu un luxe qu’on ne peut vraiment plus se permettre. Mais ce n’est pas de cela qu’il parle ; on ne relèvera pas une plainte dans Compagnons. Jean Kernevel, au contraire, semble mourir heureux. Simplement, devant cette joie inexplicable qui lui vient quelques instants avant sa fin, il n’exprime qu’une sorte de gauche surprise, comme si cette joie n’était pas dans l’ordre. « Qu’est-ce que j’ai, dit-il alors, qu’est-ce que j’ai. » Pourquoi dire plus, en effet ? Le bonheur demande une disposition à laquelle la pauvreté prépare moins bien qu’à la mort silencieuse.
Ceci dit, je trahirais Guilloux si je laissais croire qu’il est seulement le romancier de la pauvreté. Un jour que nous parlions de la justice et de la condamnation : « La seule clé, me disait-il, c’est la douleur. C’est par elle que le plus affreux des criminels garde un rapport avec l’humain. » Et il me citait un mot de Lénine, pendant le siège de Leningrad, alors qu’il voulait faire partciper au combat des prisonniers de droit commun : « Non, protestait un de ses compagnons, pas avec eux. – Pas avec eux, répondit Lénine, mais pour eux. » un autre jour Guilloux observait, à propos de l’humeur railleuse d’un de nos amis, que le sarcasme n’était pas forcément un signe de méchanceté. Je répondais qu’il ne pouvait passer, cependant, pour le signe de la bonté : « Non, dit Guilloux, mais de la douleur à quoi on ne songe jamais chez les autres. » J’ai retenu ces mots qui peignent bien leur auteur. Car Guilloux songe presque toujours à la douleur chez les autres, et c’est pourquoi il est avant tout, le romancier de la douleur. Les plus misérables créatures du Sang noir, aux yeux de leur auteur, ont une excuse dans la souffrance de vivre. On sent bien pourtant que douleur ne veut pas dire ici désespoir. Le Sang noir portait une bande désespérée : « La vérité de cette vie, ce n’est pas qu’on meurt, c’est qu’on meurt volé. » Et cependant ce livre tendu et déchirant, qui mêle à des fantoches misérables des créatures d’exil et de défaite, se situe au-delà du désespoir ou de l’espoir. Nous sommes avec lui au coeur de ces terres inconnues que les grands romanciers russes ont tenté d’explorer. En vérité est-il un seul grand artiste qui n’y ait abordé au moins une fois ? Les êtres y courent à leur fin, à la fois solitaires et confondus, identiques et irremplaçables. Placés au-delà de la justification, ils se détachent alors avec la puissance de la vie, assez semblables à nous pour que nous les reconnaissions, mais portés au-dessus de nous, agrandis par la souffrance qui fixe leurs attitudes dans leur mémoire et les rend, pour finir, exemplaires : ce sont les grandes images de la compassion. Voilà le grand art de Guilloux qui n’utilise la misère de tous les jours que pour mieux éclairer la douleur du monde. Il pousse ses personnages jusqu’au type universel, mais en les faisant d’abord passer par la réalité la plus humble. Je ne connais pas d’autre définition de l’art, et si tant d’écrivains aujourd’hui font mine de s’en écarter, c’est qu’il est plus facile d’étonner que de convaincre. Guilloux s’est privé de cette facilité. Son goût presque désordonné pour les êtres, la longue confrontation qu’il poursuit avec un monde intérieur grouillant de personnages l’ont porté comme naturellement à l’art le plus difficile. Pour moi, qui vient de reprendre tous ses livres, il ne fait aucun doute que cette œuvre ne se compare à aucune autre.
Mais je n’ai pas encore parlé de La Maison du peuple, le premier livre de Guilloux. Je n’ai jamais pu le lire sans un serrement de coeur : je le lis avec des souvenirs. Il me parle sans arrêt d’une vérité dont je sais, malgré les professeurs de philosophie et de tactique, qu’elle passe les empires et les jours : celle de l’homme seul en proie à une pauvreté aussi nue que la mort : « Il savait, en écoutant le sifflet des locomotives, si le temps serait à la pluie. » J’ai si souvent relu ce livre que ce sont des phrases comme celle-là qui m’accompagnent, maintenant quand je l’ai refermé. Elles m’éclairent le personnage du père dont je connais par coeur les silences et les révoltes. Lui, si retranché, je le sens alors accordé au monde, comme au temps de sa jeunesse où il allait se baigner avec son meilleur ami. Cet ami lui-même a pris dans ma mémoire une place apparemment disproportionnée. Mais il vit en moi par son absence, et seulement parce qu’en une phrase Guilloux note que son père l’a perdu de vue après le régiment, sans que nous puissions savoir si cela a été dur ou non. Bel exemple de l’art indirect avec lequel Guilloux fait sentir combien la misère ôte de leurs forces aux passions qui lui sont étrangères.Un excès de pauvreté raccourcit la mémoire, détend l’élan des amitiés et des amours. Quinze mille francs par mois, la vie d’atelier, et Tristan n’a plus rien à dire à Yseult. L’amour aussi est luxe, voilà la condamnation.
Mais je ne veux pas refaire à gros traits ce qui est constamment suggéré par ce livre. Je voulais seulement dire que j’entretiens un long commerce avec lui et qu’il est de ceux qui se transforment dans le souvenir sans jamais s’épuiser. Voici plus de vingt ans, en tout cas, qu’il poursuit sa vie dans quelques coeurs, et qu’il y fait du bien, loin de son auteur qui ne le sait pas assez. De combien de livres, aujourd’hui, pourrais-je écrire ceci sans mentir, et lesquelles de nos œuvres donneront jamais une si pure occasion d’admirer leur art et d’aimer leur auteur ?