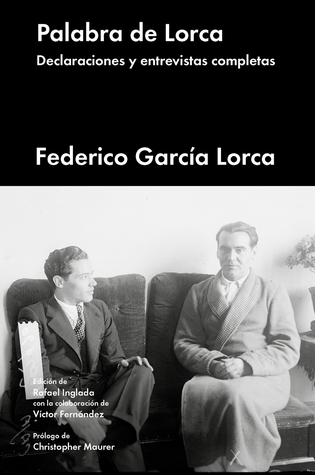Il y avait hier dans le journal El País un article sur le Parc naturel de Cabo de Gata-Níjar : Por los cortijos de Cabo de Gata en busca de rincones. C’est un endroit fragile et assez fascinant où je suis allé deux fois, en 1999 et 2005.
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2022/07/15/actualidad/1657874975_508225.html
El Cortijo del Fraile a été construit par les Dominicains au XVIII ème siècle. Il est passé dans les mains de l’état en 1836 (Loi de désamortissement du ministre Juan Álvarez Mendizábal), puis a été vendu à des intérêts privés. Les ruines du bâtiment et ses 730 hectares sont aujourd’hui la propriété de l’entreprise de Murcia, Agrícola La Misión, S. L. La ferme est située au sud-est de Níjar (Almería). Les touristes curieux ne trouvent pas le lieu facilement. Les communes les plus proches proches sont Los Albaricoques y Rodalquilar, célèbre pour ses anciennes mines d’or.
El Cortijo del Fraile est connu pour plusieurs raisons. La première pour le crime (Crimen de Níjar) qui eut lieu le 22 juillet 1928. Francisca Cañada Morales (1907 ou 1908-1987) en fut la protagoniste. Paca la Coja (c’était son surnom) avait 20 ans et allait se marier avec Casimiro Pérez Pino. Francisca et son cousin, Francisco Montes Cañada, dix ans plus âgé (Leonardo dans l’oeuvre de García Lorca alors que tous les autres personnages ne portent pas de nom) s’enfuirent sur une mule avant la cérémonie de mariage. Le frère de Casimiro, José, pour venger l’honneur de la famille, les surprit et tua Francisco de trois coups de fusil à quelques kilomètres du Cortijo del Fraile. Paca la Coja que l’on avait essayé d’étrangler vécut célibataire toute sa vie dans les environs. Ce fait divers fut beaucoup commenté par la presse de l’époque. Il inspira le roman Puñal de Claveles (1931) de Carmen de Burgos (1867-1932) et surtout la pièce de théâtre de Federico García Lorca, Bodas de sangre (Noces de sang, écrite en 1931, représentée à Madrid au Théâtre Beatriz le 8 mars 1933 par la Compagnie de Josefina Díaz et Manuel Collado).
La ferme et ses environs apparaissent aussi dans les westerns spaghetti de Sergio Leone Pour quelques dollars de plus (1965) Le bon, la brute et le truand (1966) Il était une fois la révolution (1971) (1966) ou de Damiano Damiani, El Chuncho (1966)
Bien que le site soit un Bien de Interés Cultural, les murs s’écroulent, le clocher de l’église penche dangereusement et la végétation envahit les bâtiments.

” La Novia
¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con angustia). Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua fría y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo bien! ; Yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos!”
” La Fiancée
Je suis partie avec l’autre. Je suis partie (avec angoisse) Toi aussi tu l’aurais suivie ! J’étais brûlée, couverte de plaies en dedans et en dehors. Ton fils était l’eau fraîche dont j’attendais des enfants, la santé. Mais l’autre était un fleuve obscur sous la ramée. Il apportait vers moi la rumeur de ses joncs, sa chanson murmurante. Je courais avec ton fils qui, lui, était tout froid comme un petit enfant de l’eau. Et l’autre par centaine m’envoyait des oiseaux qui m’empêchaient de marcher et qui laissaient du givre sur mes blessures de pauvre femme flétrie, de jeune fille caressée par le feu. Je ne voulais pas, entends moi bien , je ne voulais pas. Ton fils était mon salut et je ne l’ai pas trompé, mais le bras de l’autre m’a entraînée comme un paquet de mer, comme vous pousse le coup de tête d’un mulet. Et même si j’avais été une vieille femme avec tous les enfants nés de ton fils accrochés à mes cheveux, il m’aurait emportée.” (Traduction Marcelle Auclair)