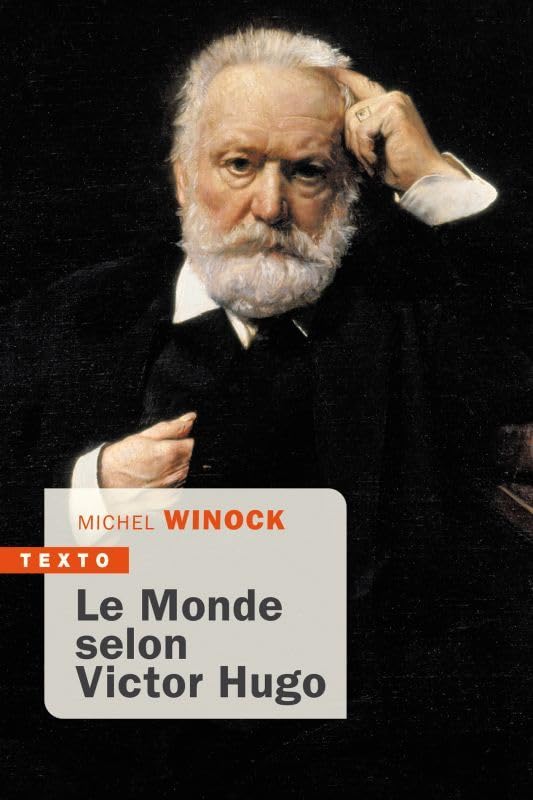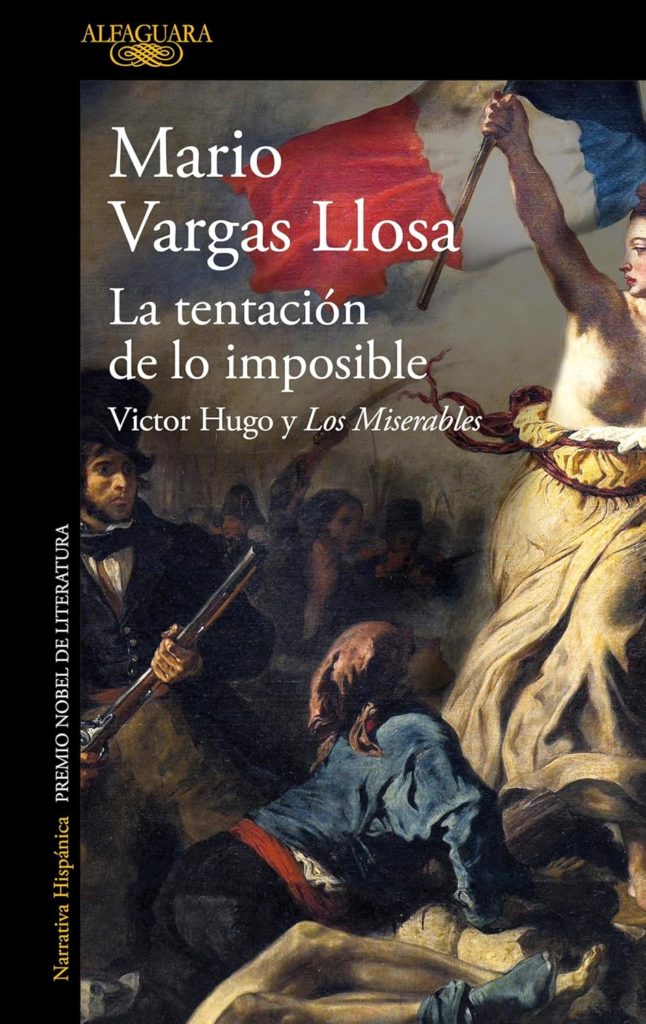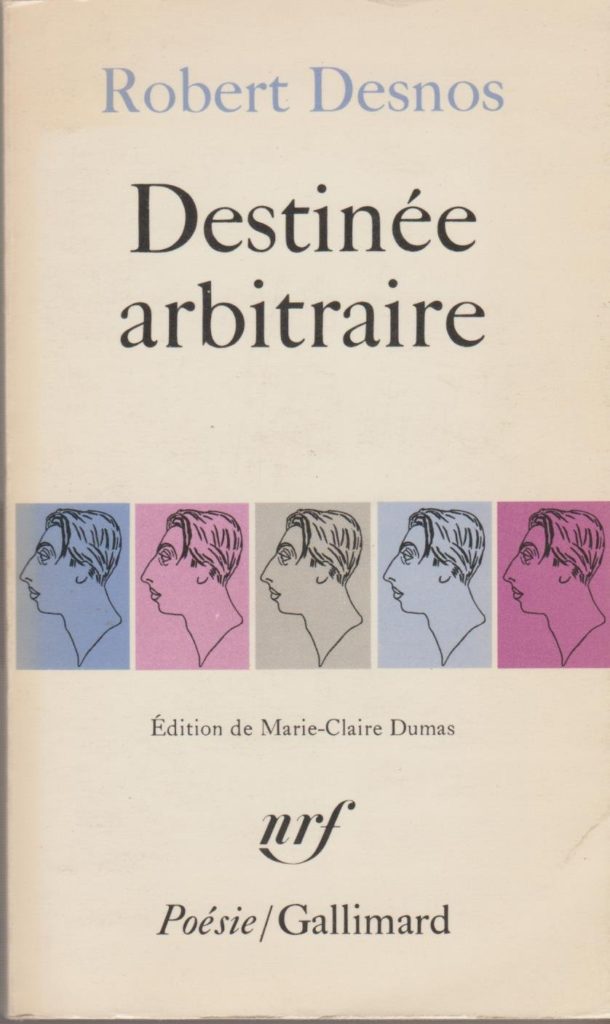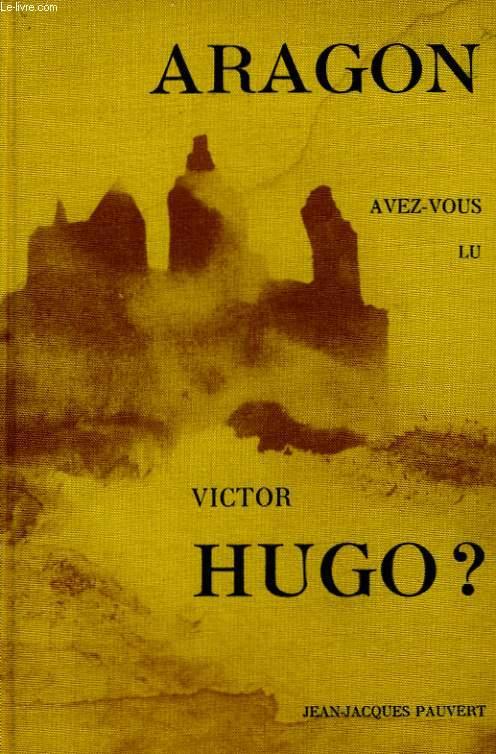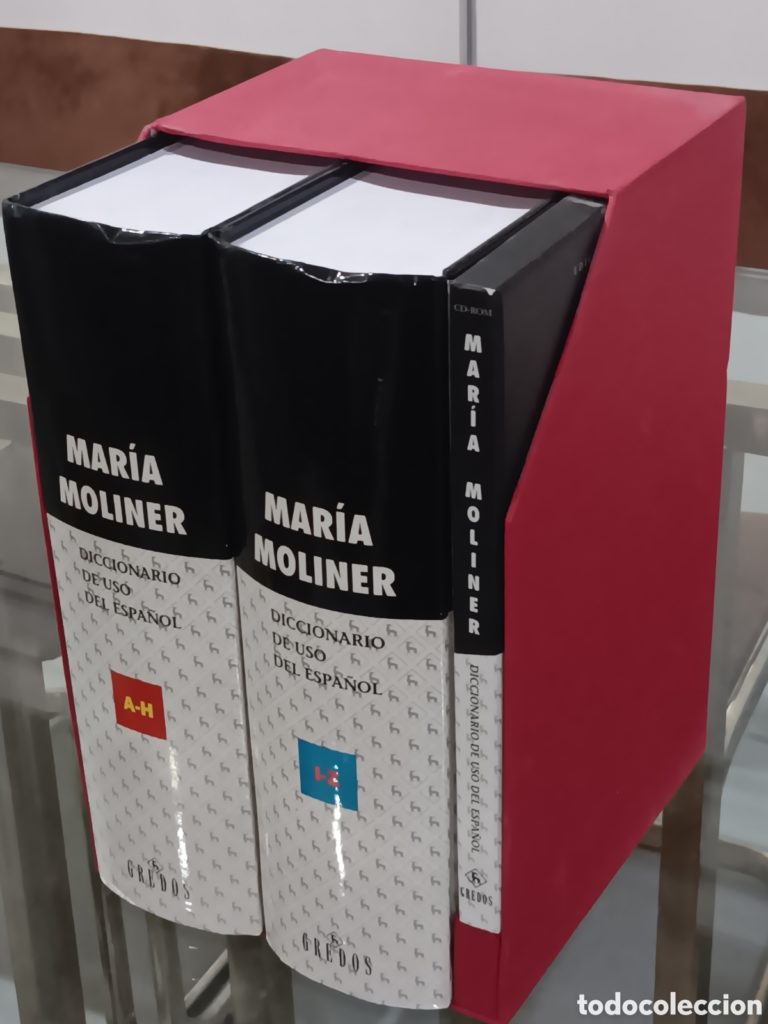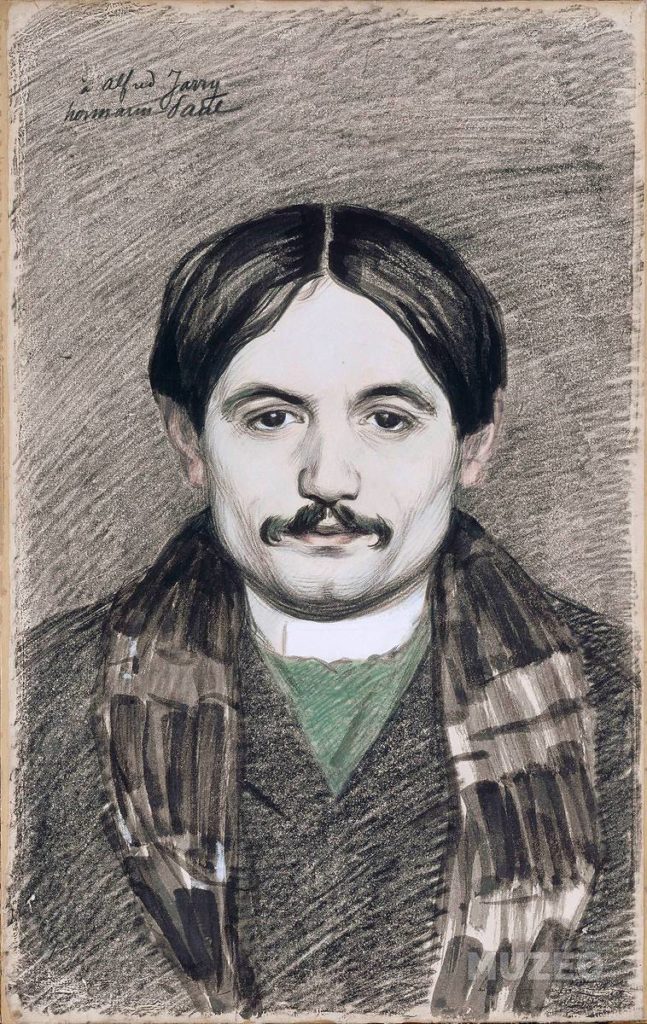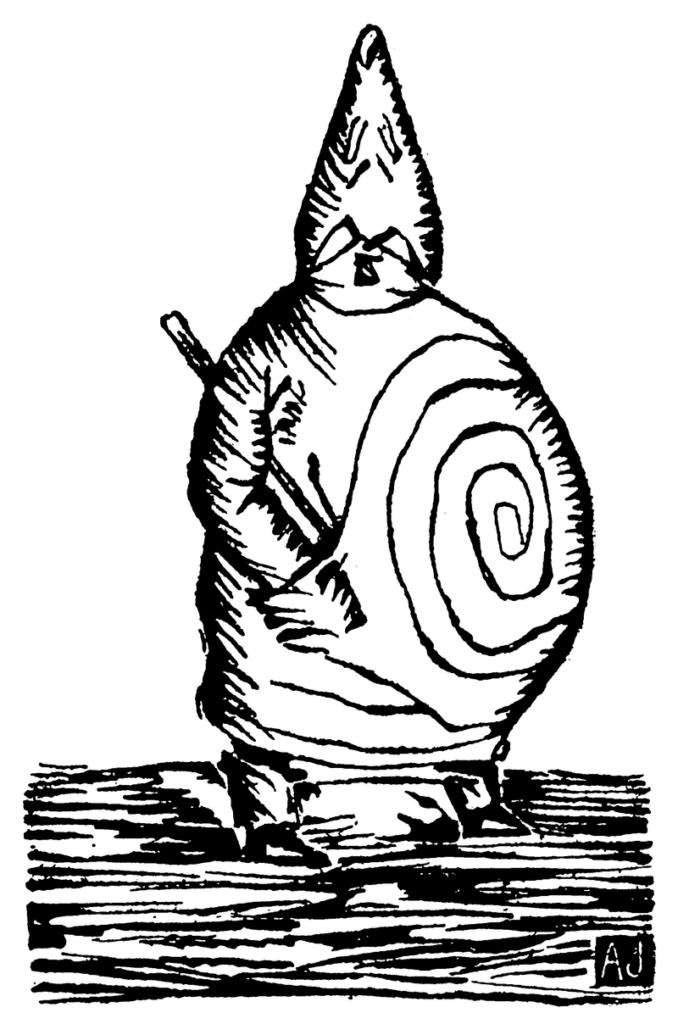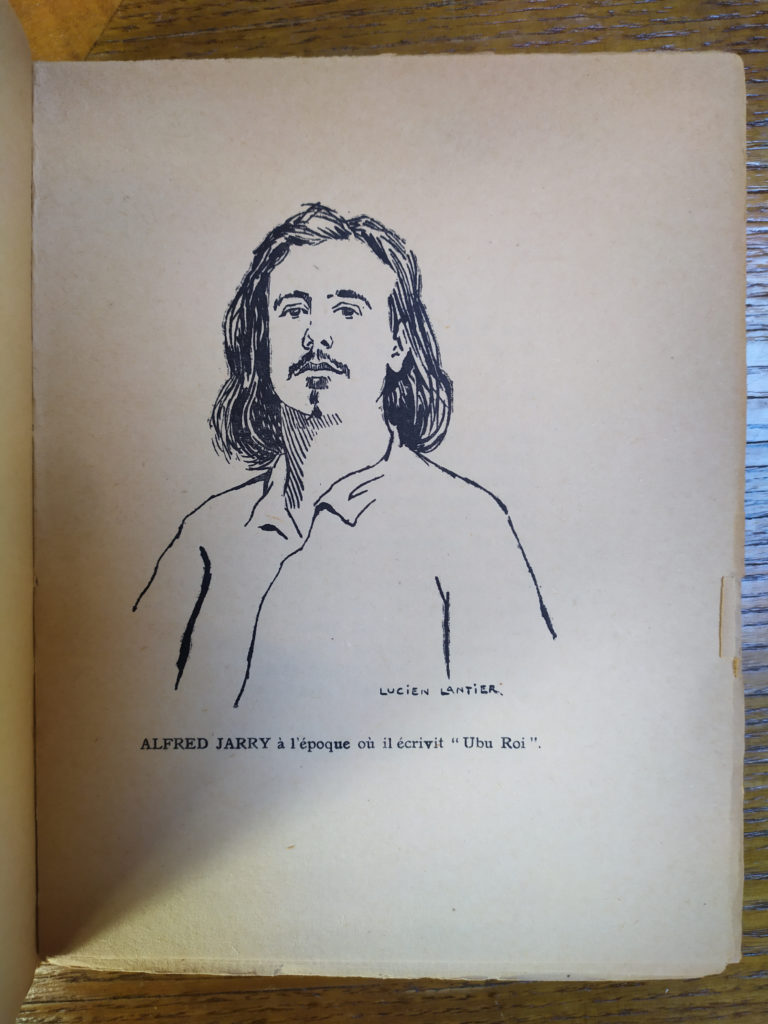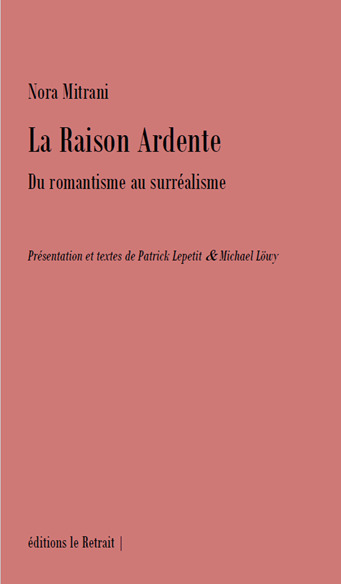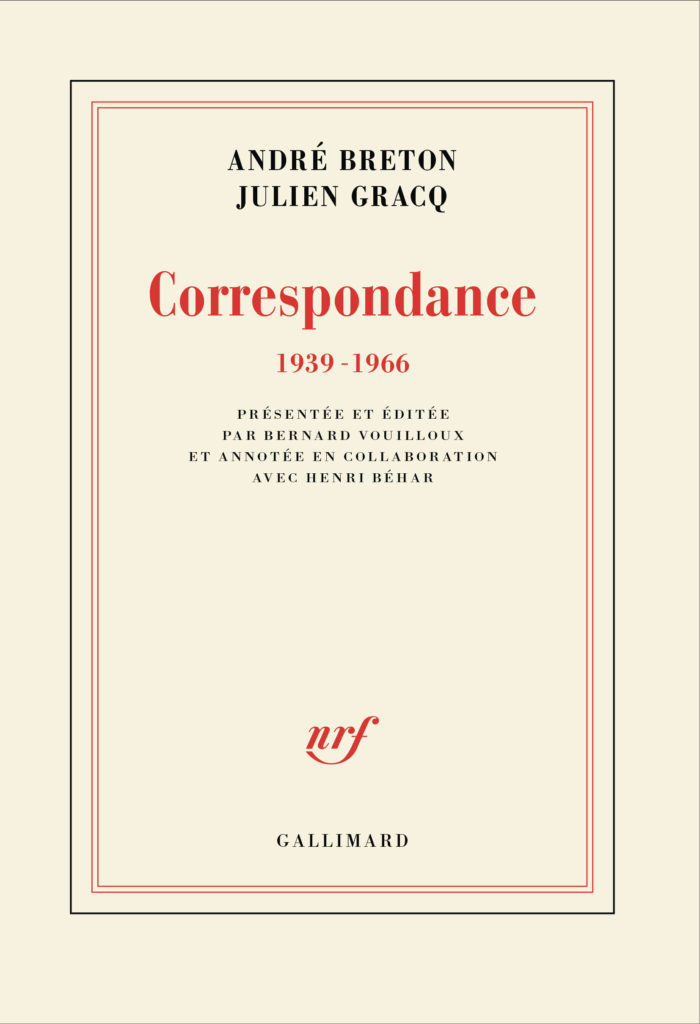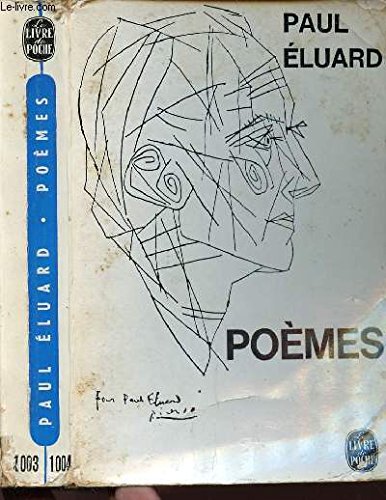Les relations entre ces deux grands poètes français du XIX siècle ont varié selon les époques. Adolescent, Baudelaire se passionne pour Hugo et pour son théâtre. Il lui écrit une longue lettre le 25 février 1840 après avoir vu Marion de Lorme au théâtre de la Porte Saint-Martin.
« Pourtant, si vous saviez combien notre amour, à nous autres jeunes gens, est sincère et vrai – il me semble (peut-être est-ce bien de l’orgueil) que je comprends tous vos ouvrages. Je vous aime comme j’aime vos livres ; (…) je vous aime comme on aime un héros, un livre, comme on aime purement et sans intérêt toute belle chose. »
Plus tard, il se montre plutôt critique envers son aîné :
« M. Victor Hugo, dont je ne veux certainement pas diminuer la noblesse et la majesté, est un ouvrier beaucoup plus adroit qu’inventif, un travailleur bien plus correct que créateur. Delacroix est quelquefois maladroit, mais essentiellement créateur. M. Victor Hugo laisse voir dans tous ses tableaux, lyriques et dramatiques, un système d’alignement et de contrastes uniformes. L’excentricité elle-même prend chez lui des formes symétriques. Il possède à fond et emploie froidement tous les tons de la rime, toutes les ressources de l’antithèse, toutes les tricheries de l’apposition. C’est un compositeur de décadence ou de transition, qui se sert de ses outils avec une dextérité véritablement admirable et curieuse. M. Hugo était naturellement académicien avant que de naître, et si nous étions encore au temps des merveilles fabuleuses, je croirais volontiers que les lions verts de l’Institut, quand il passait devant le sanctuaire courroucé, lui ont souvent murmuré d’une voix prophétique : « Tu seras de l’Académie ! » (Salon de 1846)

« – Hugo pense souvent à Prométhée. Il s’applique un vautour imaginaire sur une poitrine qui n’est lancinée que par les moxas de la vanité. Puis, l’hallucination se compliquant, se variant, mais suivant la marche progressive décrite par les médecins, il croit que, par un fiat de la Providence, Sainte-Hélène a pris la place de Jersey.
————————————————————
Cet homme est si peu élégiaque, si peu éthéré, qu’il ferait horreur même à un notaire.
————————————————————
Hugo-Sacerdoce, a toujours le front penché ; — trop penché pour rien voir, excepté son nombril. »
(Fusées. 22 feuillets parus en 1887 dans les Oeuvres posthumes ; écrits, semble-t-il, entre 1855 et 1862.

Le 25 juin 1857, le recueil Les Fleurs du Mal est mis en vente. Le 20 août 1857 dans la matinée, se tient devant la sixième chambre correctionnelle de la Seine le procès du poète et de ses éditeurs. Le réquisitoire est prononcé par le substitut Ernest Pinard qui a déjà requis contre Madame Bovary le 29 janvier précédent. Le recueil est condamné pour ” délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs “, en raison de ” passages ou expressions obscènes et immorales “. Les éditeurs devront payer 100 francs d’amende et Baudelaire 300 francs. Le tribunal ordonne la suppression de six poèmes ayant plus particulièrement porté atteinte à la morale publique
Victor Hugo envoie très rapidement une belle lettre de solidarité à Baudelaire.
Lettre à Charles Baudelaire
Hauteville House, dimanche 30 août 1857
J’ai reçu, Monsieur, votre noble lettre et votre beau livre. L’art est comme l’azur, c’est le champ infini. Vous venez de le prouver. Vos Fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Continuez. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu’il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu’il appelle sa morale. C’est là une couronne de plus.
Je vous serre la main, poëte.
Victor Hugo
Baudelaire lui dédie ensuite trois poèmes (Le Cygne, Les Sept Vieillards, Les Petites Vieilles) qui figurent dans la section Tableaux parisiens de la seconde édition des Fleurs du Mal, mise en vente au début de février 1861.
En juin 1861, Baudelaire publie dans la Revue fantaisiste, sous le titre Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, neuf notices littéraires destinées à l’anthologie Les Poètes français (1861-1862) d’Eugène Crépet (1827-1892). La première présente l’oeuvre de Victor Hugo : « L’excessif, l’immense sont le domaine naturel de Hugo ; il s’y meut dans son atmosphère natale. » Il évoque La légende des siècles où l’auteur « a créé le seul poème épique qui pût être créé par un homme de son temps pour des lecteurs de son temps ».
En octobre 1859, il obtient avec un peu de flatterie que Victor Hugo écrive une lettre-préface à sa plaquette sur Théophile Gautier. ” J’ai besoin de vous. J’ai besoin d’une voix plus haute que la mienne et que celle de Théophile Gautier, – de votre voix dictatoriale. “
L’agressivité de Baudelaire réapparaît dans les dernières années, après la publication des Misérables (1862). Il multiplie lettres, sarcasmes et attaques contre le livre et la personne de Hugo, jugé bête et sot. Il ne supporte pas son humanitarisme républicain. Ce grand reproche apparaît clairement dans une lettre à son ami, le peintre Édouard Manet en 1865.

« Et Victor Hugo ! Il ne peut pas se passer de moi, dites-vous. Il m’a un peu fait la cour. Mais il fait sa cour à tout le monde et traite de poète le dernier ou premier venu. Mon cher ami, il y a dans votre phrase un peu de la correspondance Stevens ; trois espions du genre humain qui font concurrence à la correspondance Havas.
[Hugo avait écrit sur le volume : à Charles Baudelaire, junc/anius dextras.] Cela, je crois, ne veut pas dire seulement : donnons-nous une mutuelle poignée de main. Je connais les sous-entendus du latin de Victor Hugo. Cela veut dire aussi : unissons nos mains, POUR SAUVER LE GENRE HUMAIN. Mais je me fous du genre humain, et il ne s’en est pas aperçu. (Lettre du 28 octobre 1865)
Baudelaire meurt le 31 août 1867 à 11 heures du matin. A son ami fidèle, Charles Asselineau (1820-1874), Victor Hugo écrit en 1869 :
Hauteville-House, mars 1869.
Mon cher et cordial confrère,
Votre étude sur Charles Baudelaire est un livre, un vrai livre. L’homme y est ; et non seulement l’homme, mais vous. J’ai rencontré plutôt que connu Baudelaire. Il m’a souvent choqué et j’ai dû le heurter souvent ; j’en voudrais causer avec vous. Je pense tous vos éloges, avec quelques réserves. Le jour où je le vis pour la dernière fois, en octobre 1865, il m’apporta un article écrit par lui sur la Légende des Siècles, imprimé en 1859, que vous retrouverez aisément, et où il me semble adhérer profondément à l’idéal qui est une conscience littéraire, comme le progrès est une conscience politique. Il me dit en me remettant ces pages : Vous reconnaîtrez que je suis avec vous. Je partais. Nous nous sommes quittés, je ne l’ai plus revu. C’est un des hommes que je regrette. Votre livre sur lui est cet exquis travail d’embaumement. Heureuse une mémoire qui est en vos mains ! La profonde fraternité du poëte est dans tout ce que vous écrivez. De là le charme. Vous êtes un cœur qui a beaucoup d’esprit. Merci pour ce précieux et bon livre, et recevez mon serrement de main.
Victor Hugo