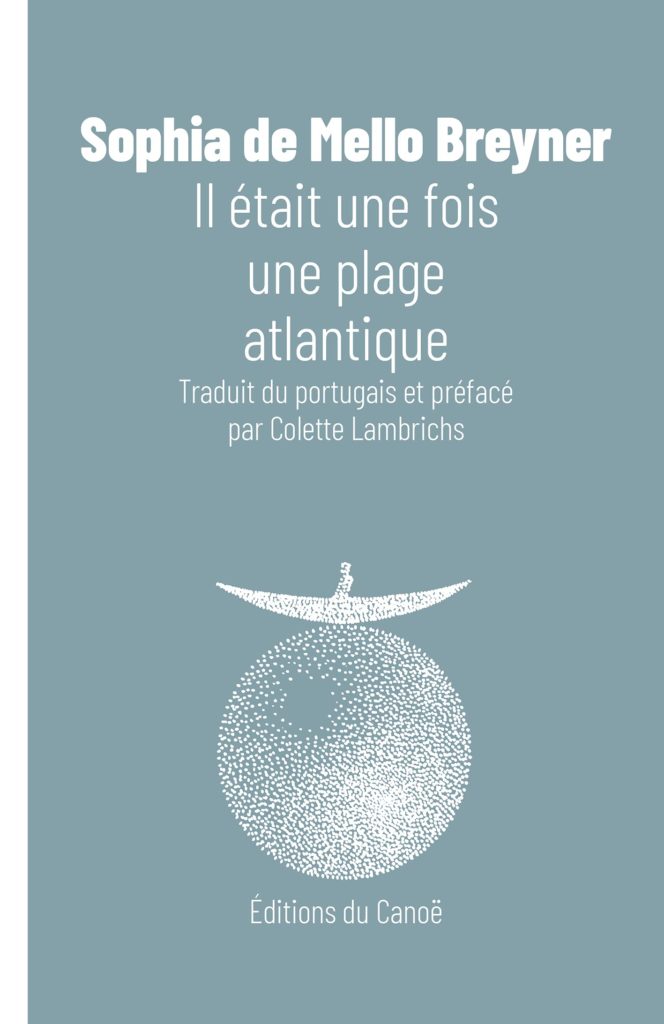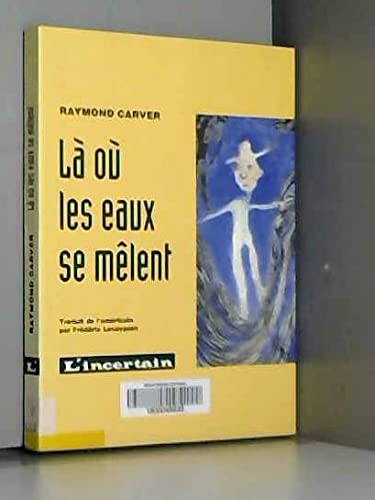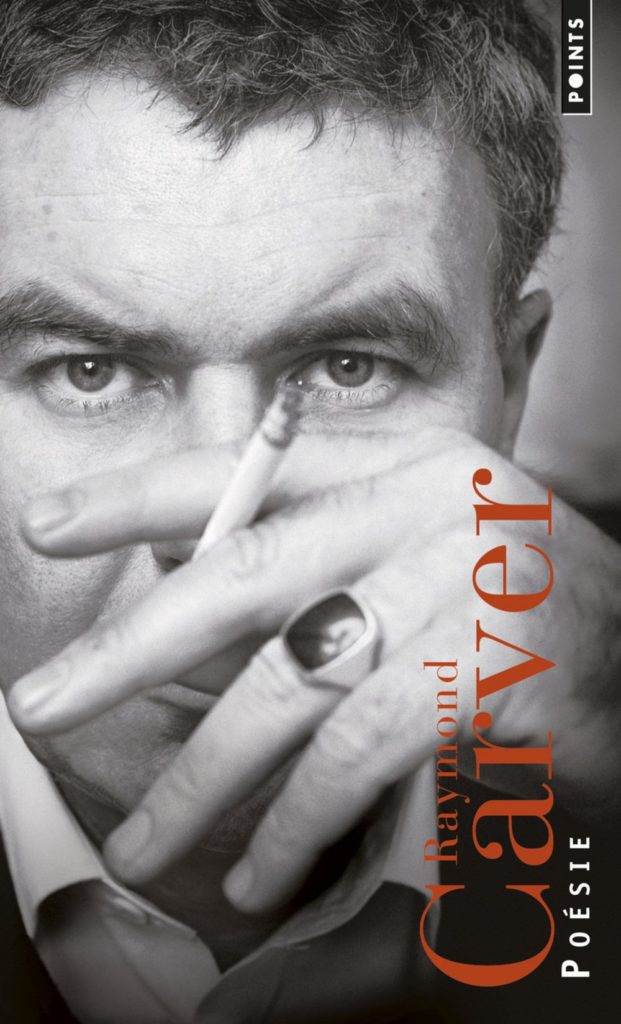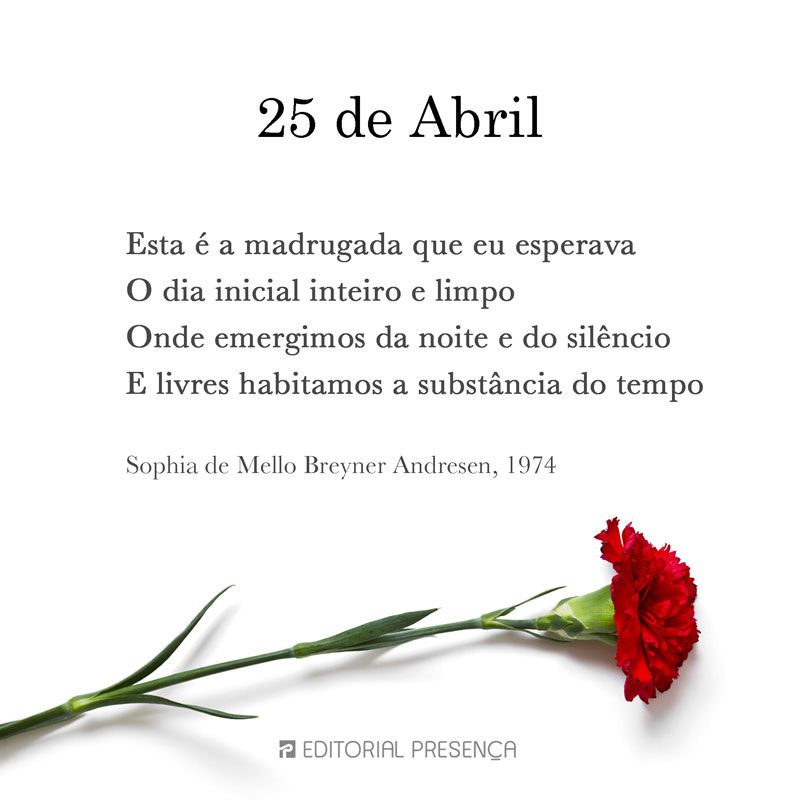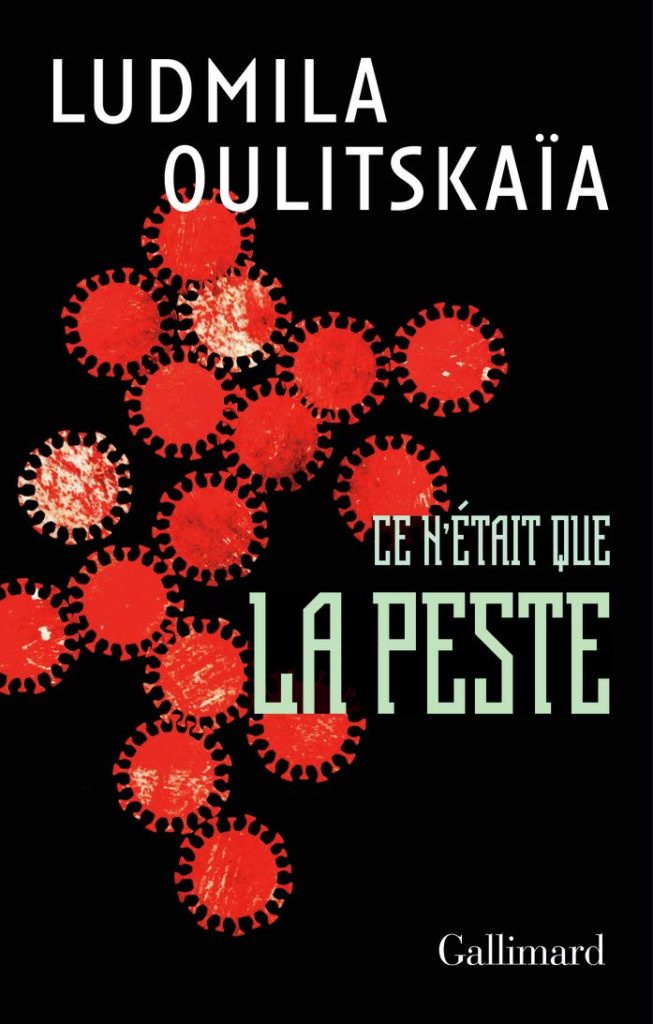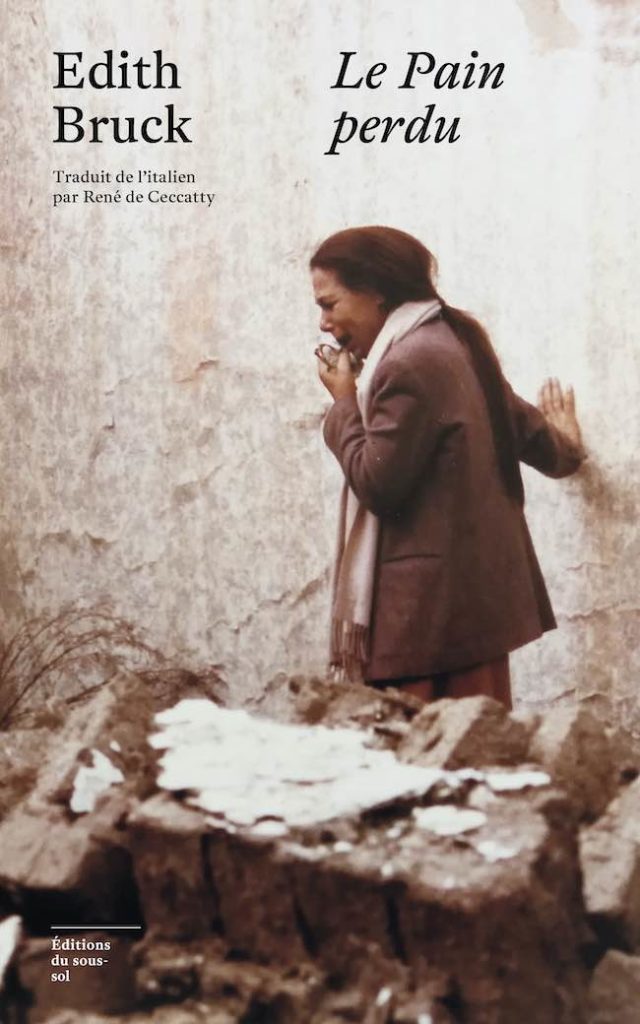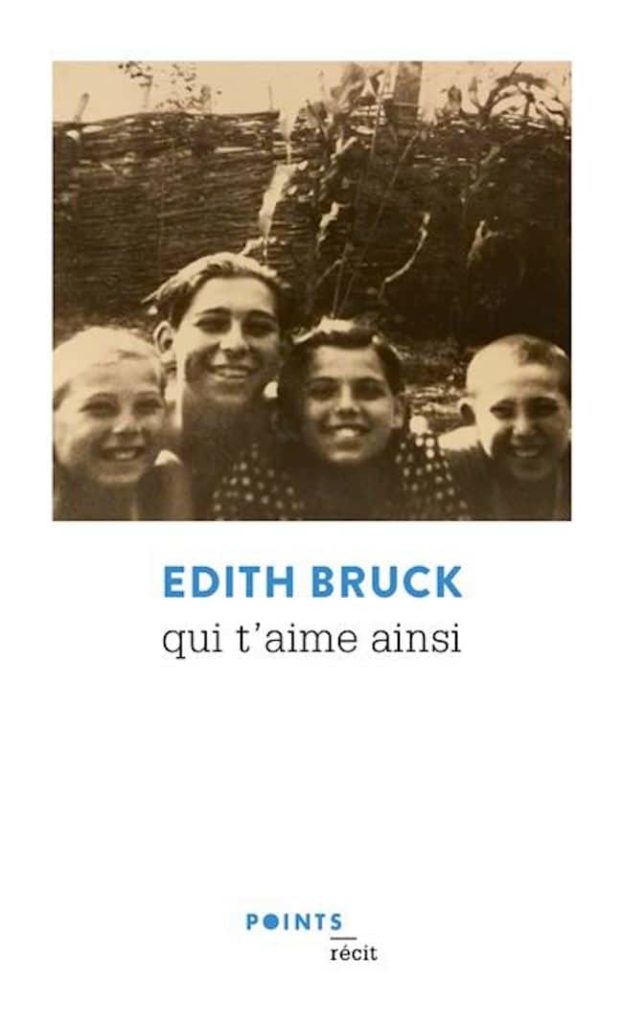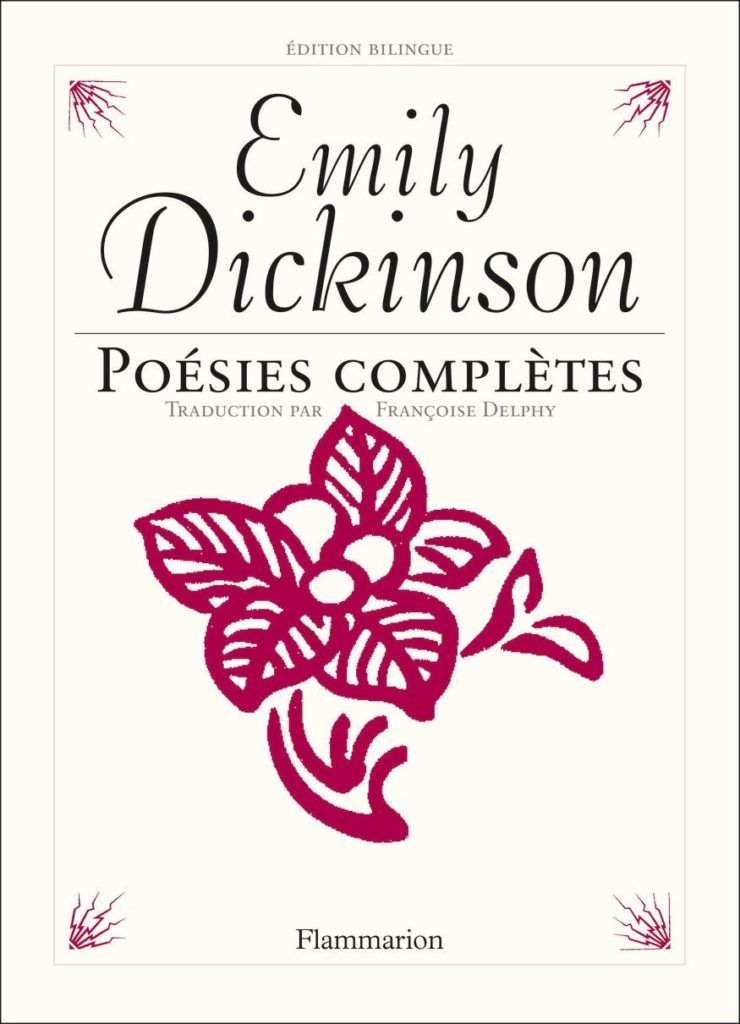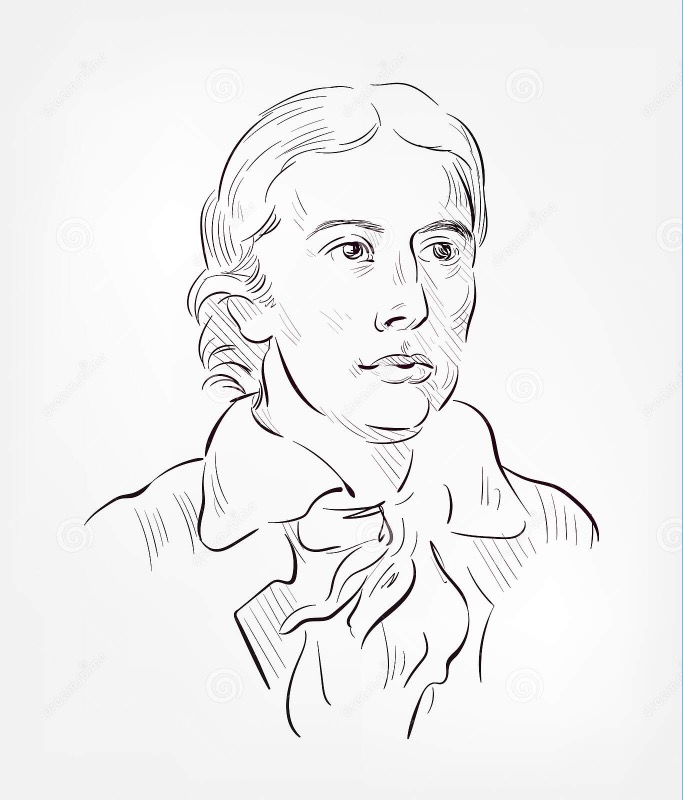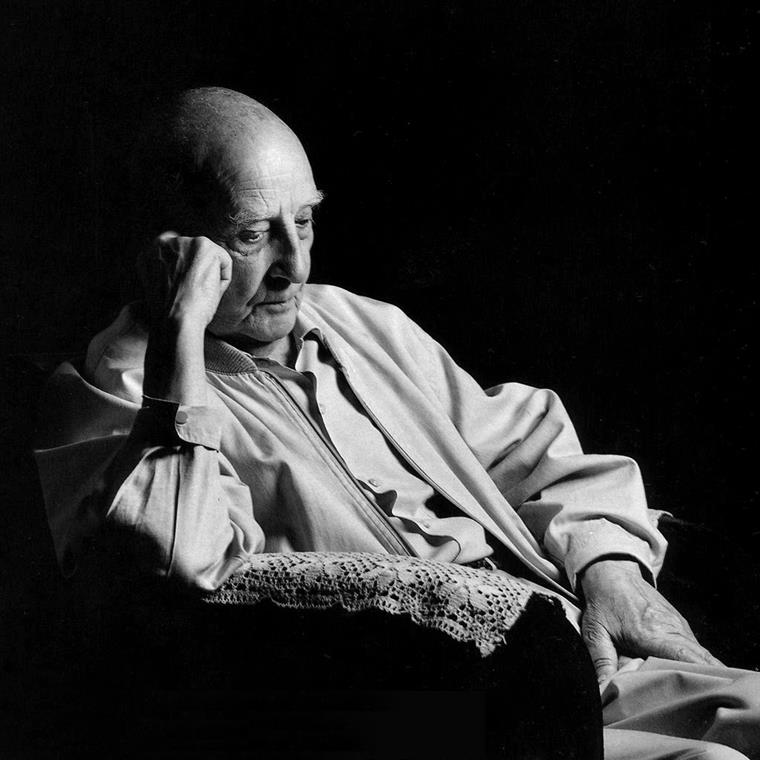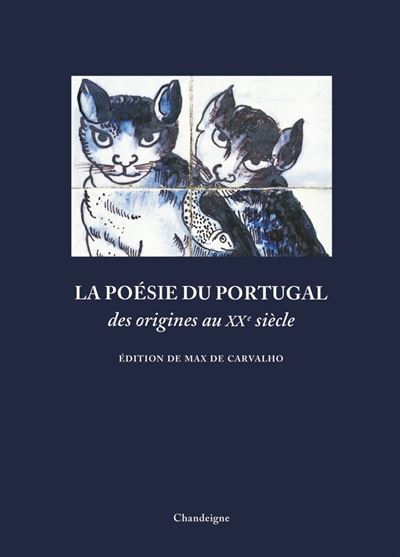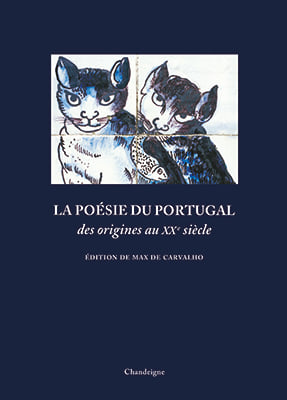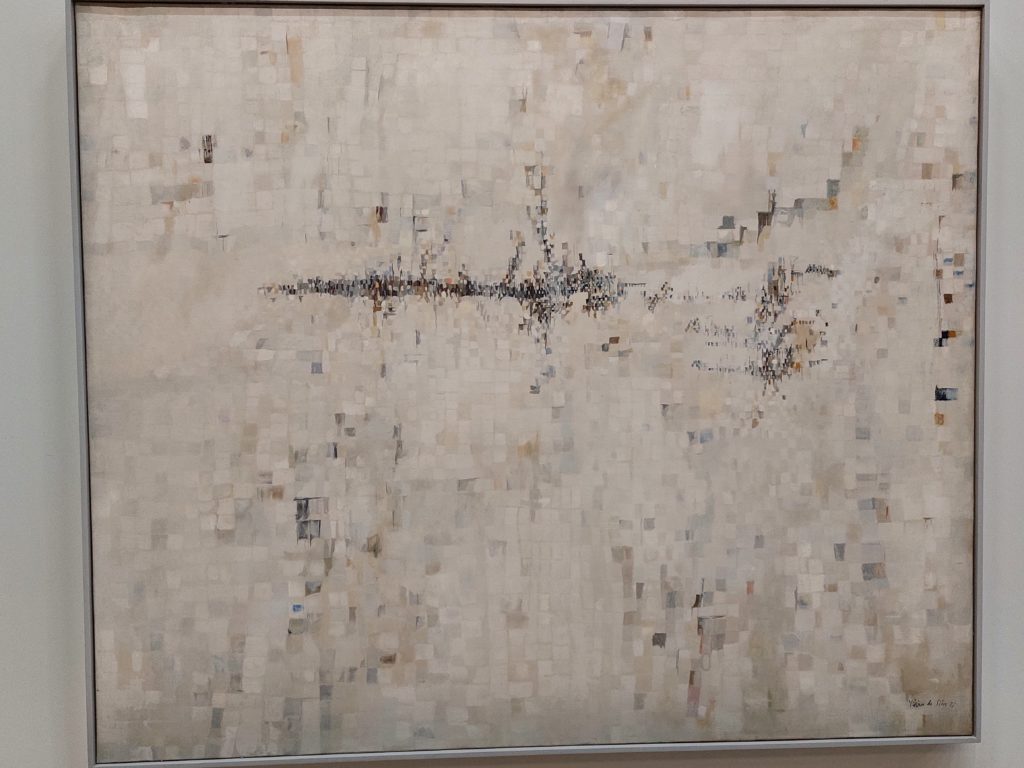Au milieu du chemin de notre vie
je me retrouvai par un forêt obscure
car la voie droite était perdue.
Ah dire ce qu’elle était est chose dure
cette forêt féroce et âpre et forte
qui ranime la peur dans la pensée !
Elle est si amère que mort l’est à peine plus ;
mais pour parler du bien que j’y trouvai,
je dirai des autres choses que j’y ai vues.
Je ne sais pas bien redire comment j’y entrai,
tant j’étais plein de sommeil en ce point
où j’abandonnai la voie vraie.
Mais quand je fus venu au pied d’une colline
où finissait cette vallée
qui m’avait pénétré le cœur de peur,
Je regardai en haut et je vis ses épaules
vêtues déjà par les rayons de la planète
qui mène chacun droit par tous sentiers.
Alors la peur se tint un peu tranquille,
qui dans le lac du cœur m’avait duré
la nuit que je passai si plein de peine.
Et comme celui qui hors d’haleine,
sorti de la mer au rivage,
se retourne vers l’eau périlleuse et regarde,
Ainsi mon âme, qui fuyait encore,
se retourna pour regarder le pas
qui ne laissa jamais personne en vie.
La Divine comédie: L’Enfer, Chant I. Flammarion, 1985. Traduction Jacqueline Risset.
Nel mezzo del commin di nostra vita
mi retrovai per una selva oscura
chè la diritta vía era smarrita
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,
guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta
che nel lago del cor m’era durata
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.
E come quei che con lena affannata
uscito fuor del pelago a la riva
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.
Divina Commedia, 1321. Inferno.
(déjà publié sur ce blog le 11 juillet 2019. Merci à M.L. Weekend poetry. https://www.lesvraisvoyageurs.com/2019/07/11/dante-alighieri/
Le séjour de Dante à Paris est rempli de mystère. Dans La Divine Comédie, quelques passages évoquent des personnes ou des lieux qu’il aurait fréquentés. Selon les historiens, il est probable qu’il s’est rendu à Paris entre août 1313 et juin 1314, probablement pour y étudier la philosophie naturelle et la théologie. D’où la relation avec la Sorbonne et la présence de la statue de Dante par Jean-Paul Aubé, dans le square Michel Foucault, juste devant le Collège de France.
Jean-Paul Aubé (1837-1916) avait fait le voyage d’Italie en 1866. Il représente Dante repoussant du pied droit la tête d’un damné figurant les forces du mal, personnifié par la tête de Bocca degli Abati, le traître de la bataille de Montaperti (1260), en Toscane. Le poète est représenté avec ses attributs traditionnels : le grand manteau, le chaperon tombant et la couronne de laurier.
La Ville de Paris achète à l’artiste ce modèle en plâtre, le 14 juin 1879, et fait réaliser par le fondeur H. Molz une statue en bronze, placée en 1882, place Marcelin-Berthelot. La statue est aussi présentée aux Expositions universelles de Vienne, en 1882, et de Paris, en 1889 et 1900. Le modèle en plâtre se trouve au Petit Palais (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris).