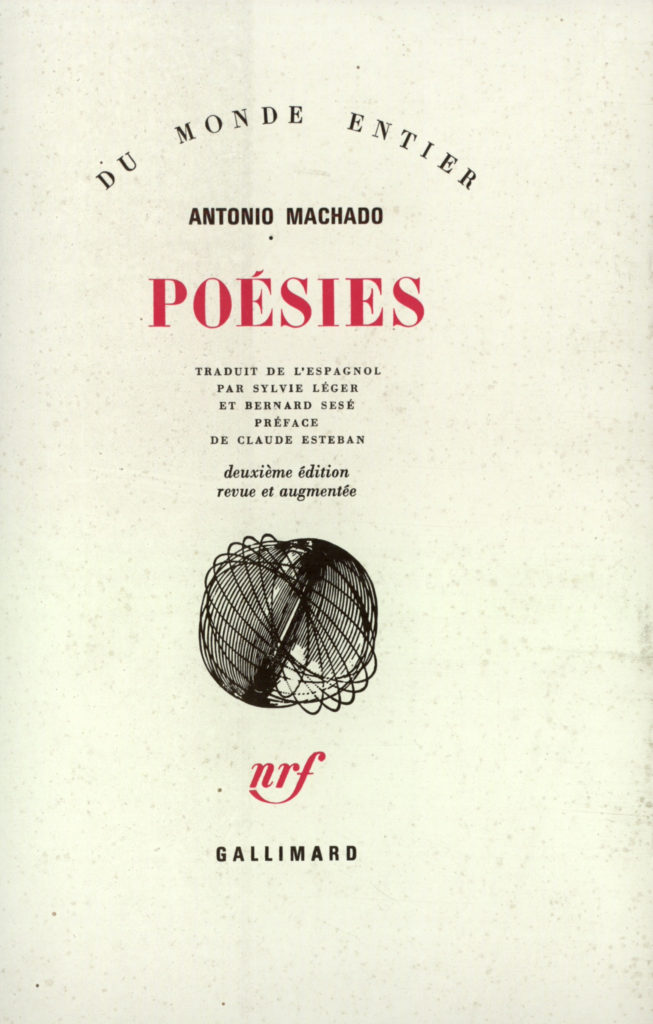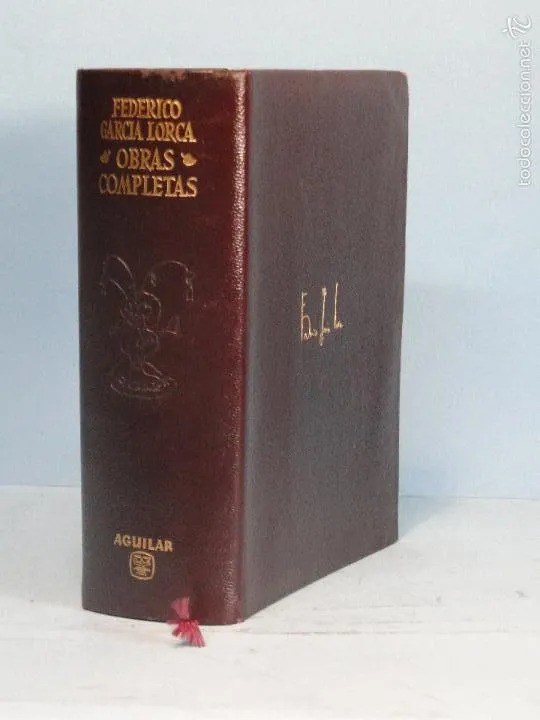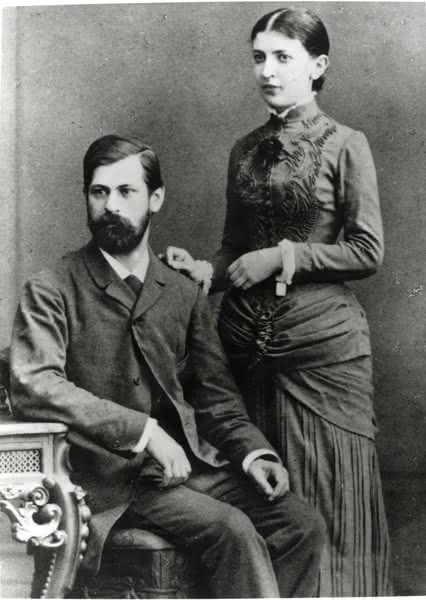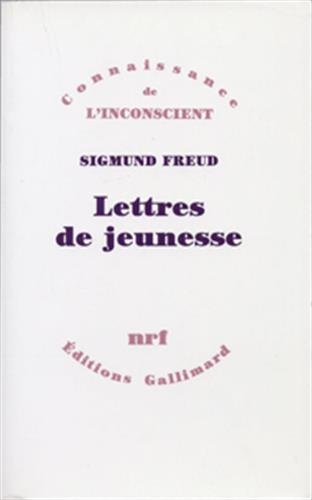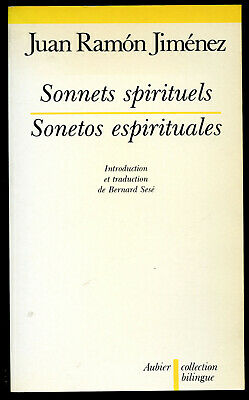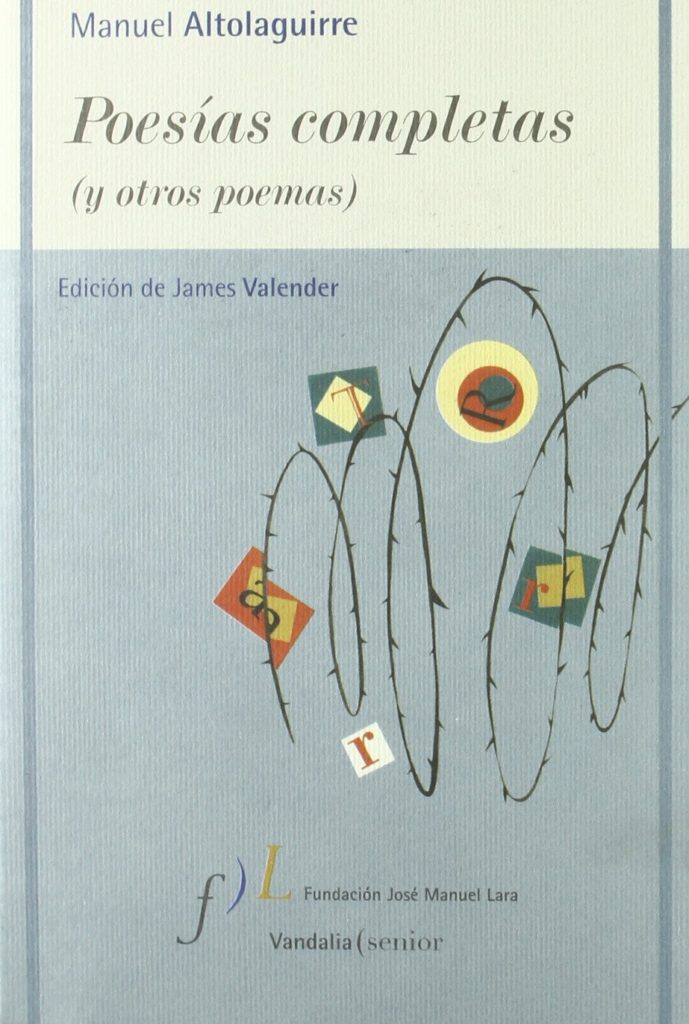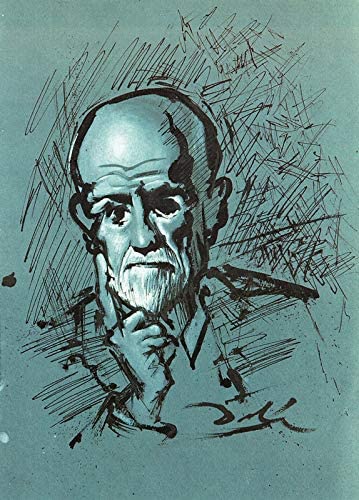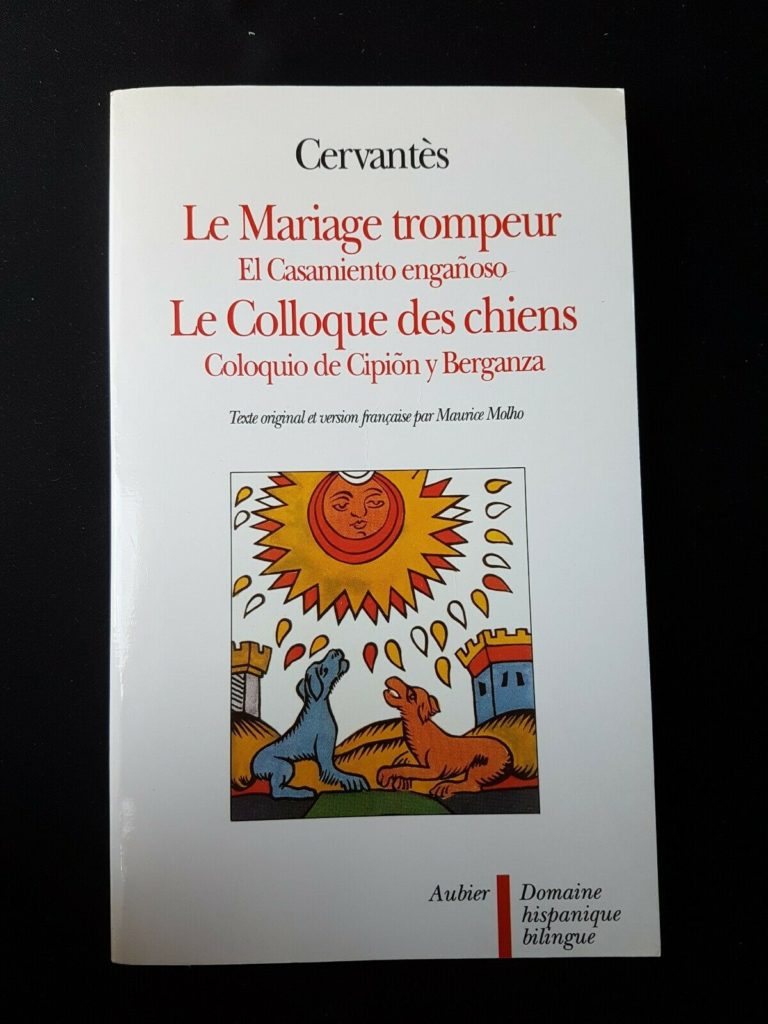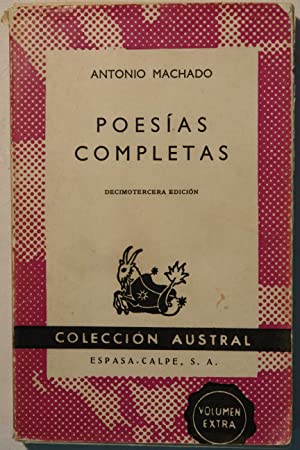La spéculation immobilière menace les paysages qui entourent Soria et qu’ ont immortalisés les poètes Antonio Machado et Gustavo Adolfo Bécquer. Voir la pétition lancée par notre amie Carmen Heras Uriel.

Julio Llamazares a publié dans le journal El País hier un bel article qui rappelle l’importance de la préservation de cet endroit magnifique: Paisaje y memoria.
https://elpais.com/opinion/2021-02-05/paisaje-y-memoria.html
“Decía alguien que los paisajes no existen hasta que los colonizan los escritores o los pintores y esa curva de ballesta que el río Duero traza a los pies de Soria es el ejemplo más claro de que es así. La mirada de Antonio Machado compuso ese lugar para nosotros y ya siempre será como él lo cantó en sus versos, impregnado el paisaje de la emoción que a él le produjo y que es ya patrimonio de todos independientemente de su propiedad real. El paisaje es memoria y como tal nos pertenece a todos, y más en el caso de que constituya un patrimonio cultural y estético, como es el de Soria para su suerte.
Hasta el Romanticismo el paisaje era el decorado del teatro de la vida de los hombres, el telón el fondo del escenario que para nada o muy poco influía en la obra, pero hoy ya sabemos que el paisaje es algo más y lo sabemos por personas como Machado, gente que entendió muy pronto que el paisaje es el alma de las personas, el espejo que refleja sus emociones y sus deseos y que los guarda cuando desaparecen.” (Julio Llamazares)
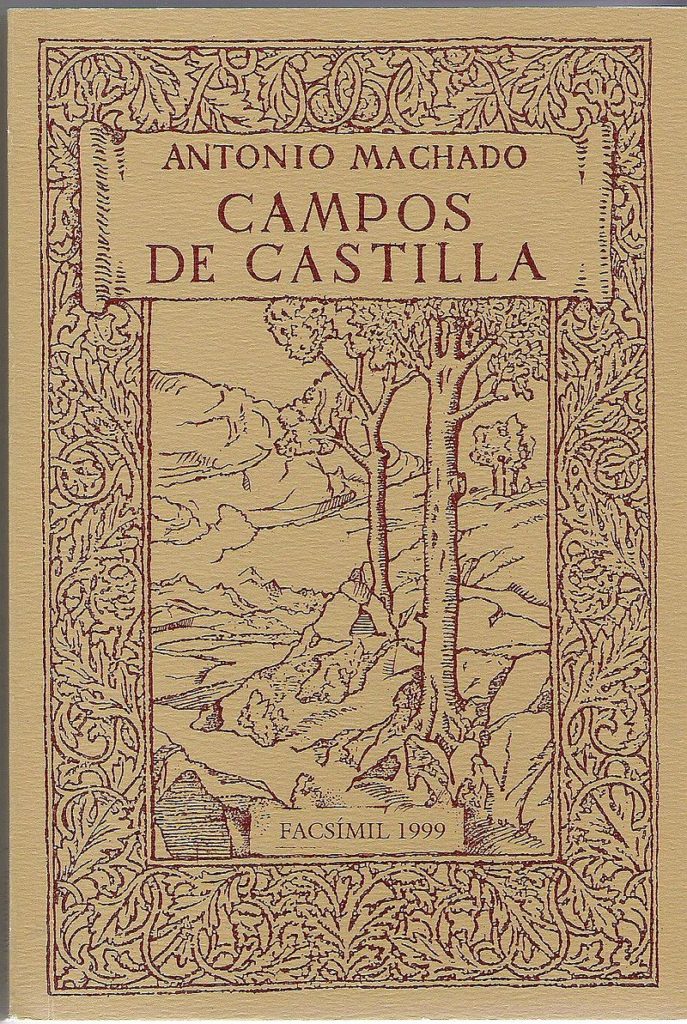
Campos de Soria (Antonio Machado)
IEs la tierra de Soria, árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas,
verdes pradillos, cerros cenicientos,
la primavera pasa
dejando entre las hierbes olorosas
sus diminutas margaritas blancas.
La tierra no revive, el campo sueña.
Al empezar abril está nevada
la espalda del Moncayo;
el caminante lleva en su bufanda
envueltos cuello y boca, y los pastores
pasan cubiertos con sus luengas capas.
IILas tierras labrantías,
como retazos de estameñas pardas,
el huertecillo, el abejar, los trozos
de verde oscuro en que el merino pasta,
entre plomizos peñascales, siembran
el sueño alegre de infantil Arcadia.
En los chopos lejanos del camino,
parecen humear las yertas ramas
como un glauco vapor -las nuevas hojas-
y en las quiebras de valles y barrancas
blanquean los zarzales florecidos,
y brotan las violetas perfumadas.
IIIEs el campo ondulado, y los caminos
ya ocultan los viajeros que cabalgan
en pardos borriquillos,
ya al fondo de la tarde arrebolada
elevan las plebeyas figurillas,
que el lienzo de oro del ocaso manchan.
Mas si trepáis a un cerro y veis el campo
desde los picos donde habita el águila,
son tornasoles de carmín y acero,
llanos plomizos, lomas plateadas,
circuídos por montes de violeta,
con las cumbre de nieve sonrosada.
IV¡ Las figuras del campo sobre el cielo !
Dos lentos bueyes aran
en un alcor, cuando el otoño empieza,
y entre las negras testas doblegadas
bajo el pesado yugo,
pende un cesto de juncos y retama,
que es la cuna de un niño;
y tras la yunta marcha
un hombre que se inclina hacia la tierra,
y una mujer que en las abiertas zanjas
arroja la semilla.
Bajo una nube de carmín y llama,
en el oro fluido y verdinoso
del poniente, las sombras se agigantan.
VLa nieve. En el mesón al campo abierto
se ve el hogar donde la leña humea
y la olla al hervir borbollonea.
El cierzo corre por el campo yerto,
alborotando en blancos torbellinos
la nieve silenciosa.
La nieve sobre el campo y los caminos
cayendo está como sobre una fosa.
Un viejo acurrucado tiembla y tose
cerca del fuego; su mechón de lana
la vieja hila, y una niña cose
verde ribete a su estameña grana.
Padres los viejos son de un arriero
que caminó sobre la blanca tierra
y una noche perdió ruta y sendero,
y se enterró en las nieves de la sierra.
En torno al fuego hay un lugar vacío,
y en la frente del viejo, de hosco ceño,
como un tachón sombrío
– tal el golpe de un hacha sobre un leño -.
La vieja mira al campo, cual si oyera
pasos sobre la nieve. Nadie pasa.
Desierta la vecina carretera,
desierto el campo en torno de la casa.
La niña piensa que en los verdes prados
ha de correr con otras doncellitas
en los días azules y dorados,
cuando crecen las blancas margaritas.
VI¡ Soria fría, Soria pura,
cabeza de Extremadura,
con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas !
¡ Muerta ciudad de señores,
soldados o cazadores;
de portales con escudos
de cien linajes hidalgos,
y de famélicos galgos,
de galgos flacos y agudos,
que pululan
por las sórdidas callejas,
y a la medianoche ululan,
cuando graznan las cornejas !
¡ Soria fría ! La campana
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana
¡ tan bella ! bajo la luna.
VII¡ Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, oscuros encinares,
ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río,
tardes de Soria, mística y guerrera,
hoy siento por vosotros, en el fondo
del corazón, tristeza,
tristeza que es amor ! ¡ Campos de Soria
donde parece que las rocas sueñan,
conmigo vais ! ¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas !…
VIIIHe vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria – barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra -.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡ Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo váis, mi corazón os lleva !
IX¡ Oh, sí ! Conmigo vais, campos de Soria,
tardes tranquilas, montes de violeta,
alamedas del río, verde sueño
del suelo gris y de la parda tierra,
agria melancolía
de la ciudad decrépita,
me habéis llegado al alma,
¿o acaso estabais en el fondo de ella ?
¡ Gente del alto llano numantino
que a Dios guardáis como cristianas viejas,
que el sol de España os llene
de alegría, de luz y de riqueza !
Campos de Castilla. 1912.
Terres de Soria
I
La terre de Soria est aride et froide.
Sur les collines et les sierras pelées
sur les vertes prairies, sur les coteaux de cendre,
le printemps passe
laissant entre les herbes odorantes
ses minuscules pâquerettes blanches.
La terre ne revit pas, la campagne songe.
Quand arrive avril, le flanc du Moncayo
de neige est recouvert ;
le voyageur a le cou et la bouche
enveloppés dans son écharpe et les bergers
passent revêtus de leurs longues capes.
II
Les terres de labour
comme des morceaux d’étamine brune,
le potager, la ruche, les carrés
de vert sombre où paissent les moutons
au milieu de rochers de plomb sèment
un rêve joyeux d’enfantine Arcadie.
Sur les peupliers éloignés du chemin
des branches raides semblent s’élever
comme une vapeur glauque – les feuilles nouvelles –
et dans les fentes des vallées et des ravins
les ronceraies en fleur sont toutes blanches
et poussent les violettes parfumées.
III
Dans les champs ondulés, les chemins
tantôt cachent les voyageurs
montant de petits ânes gris,
tantôt sur le fond du soir rougeoyant
élèvent des silhouettes plébéiennes
qui sur la toile d’or du couchant se détachent.
Mais si vous grimpez sur une colline et que du haut
des pics où habite l’aigle vous regardez les champs,
tout n’est que chatoiement de carmin et d’acier,
plaines couleur de plomb, mamelons argentés,
cernés de montagnes violettes,
aux cimes enneigées de rose.
IV
Les silhouettes des champs sur le ciel !
Deux bœufs labourent lentement
sur un coteau, quand commence l’automne.
Entre les deux têtes noires
penchées sur le joug pesant
pend un panier de jonc et de genêt
qui est le berceau d’un enfant ;
et derrière l’attelage marchent
un homme incliné vers le sol
et une femme qui dans les sillons ouverts
jettent la semence.
Sous un nuage de carmin et de flamme,
dans l’or fluide et verdoyant
du couchant, les ombres grandissent démesurément.
V
La neige. Dans l’auberge sur la campagne ouverte
on voit l’âtre où fument les bûches
et où la marmite bouillonne.
La bise court sur les champs gelés,
soulevant en blancs tourbillons
la neige silencieuse.
Sur les champs et sur les chemins
la neige tombe comme sur une fosse.
Blotti près du feu un vieil homme
tremble et tousse, la vielle file
sa touffe de laine, et une fillette
coud un galon vert à sa bure grenat.
Les vieux sont les parents d’un muletier
qui cheminait sur la terre blanche,
et une nuit perdit la route et le sentier
et s’ensevelit dans les neiges de la sierra.
Près du feu il y a une place vide,
et sur le front renfrogné du vieillard,
comme une tache sombre,
– telle sur un tronc la marque de la hache – .
La vieille regarde la campagne comme si elle entendait
des pas sur la neige. Nul ne passe.
La route voisine, déserte.
Déserte la campagne autour de la maison.
La fillette songe qu’avec ses amies
sur les vertes prairies elle ira courir
dans les jours bleus et dorés,
quand pousseront les blanches marguerites.
VI
Soria du froid, Soria pure,
capitale d’Estrémadure,
avec son château guerrier
tombant en ruine, sur le Douro,
avec ses murailles rongées
et ses maisons toutes noircies !
Morte cité de grands seigneurs,
soldats ou bien chasseurs;
aux porches ornés d’écussons
de cent lignées faméliques,
aux lévriers maigres et fins
qui pullulent
le long des ruelles sordides,
et qui à la minuit hululent,
lorsque croassent les corneilles !
Soria du froid ! La cloche sonne
une heure au tribunal.
Soria, cité castillane,
si belle ! Sous la lune.
VII
Collines argentées,
coteaux grisâtres, rocailles violacées
où le Douro dessine
sa courbe d’arbalète
autour de Soria, obscures chênaies,
champs de cailloux, sauvages, sierras pelées,
chemins tout blancs, peupliers du rivage,
soirs de Soria, mystique et guerrière,
aujourd’hui je ressens pour vous au fond du coeur
une tristesse,
une tristesse qui est amour! Champs de Soria
où l’on dirait que rêvent les rochers,
je vous emporte en moi ! Collines argentées,
coteaux de gris, rochers de pourpre !…
VIII
Je suis revenu voir les peupliers dorés,
Peupliers du chemin sur le rivage
du Douro, entre San Polo et San Saturio,
au-delà des vieilles murailles
de Soria – barbacane tournée
vers l’Aragon, en terre castillane.
Ces peupliers de la rivière, qui accompagnent
du bruissement de leurs feuilles sèches
le son de l’eau, quand le vent souffle,
ont sur l’écorce,
gravées, des initiales qui sont des noms
d’amoureux, des chiffres qui sont des dates.
Peupliers de l’amour dont les branches hier
étaient remplies de rossignols;
peupliers qui serez demain les lyres
du vent parfumé au printemps;
peupliers de l’amour près de l’eau
qui coule, passe et songe,
peupliers des berges du Douro,
vous êtes en moi, mon coeur vous emporte !
IX
Oui, vous êtes en moi, campagnes de Soria,
soirs tranquilles, monts de violette,
allées de peupliers le long de la rivière,
Oh ! Verte rêverie du sol gris et de la terre brune
âcre mélancolie
de la ville décrépite,
vous êtes parvenus jusqu’au fond de mon âme
ou bien vous étiez là, peut-être, tout au fond ?
Gens du haut plateau de Numance
qui gardez Dieu ainsi que vieilles chrétiennes,
que le soleil d’Espagne vous emplisse
de joie, de lumière, de richesses !
Poésies. Paris, Gallimard, 1980. Traduction: Sylvie Léger, Bernard Sesé.
(Pour Julia, née le 3 février 2021 à Burgos, et Gabriel, attendu cette semaine à Madrid.)