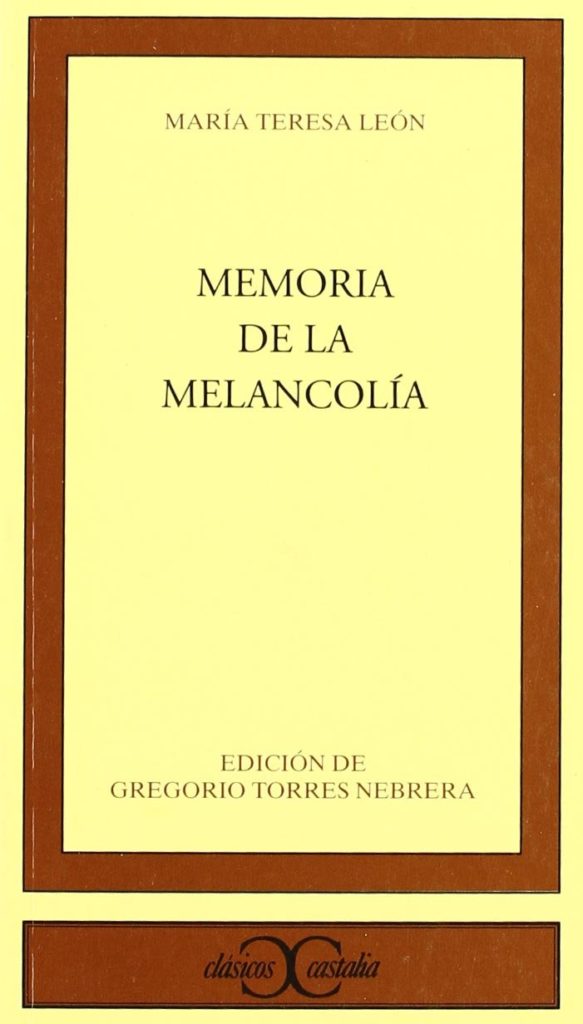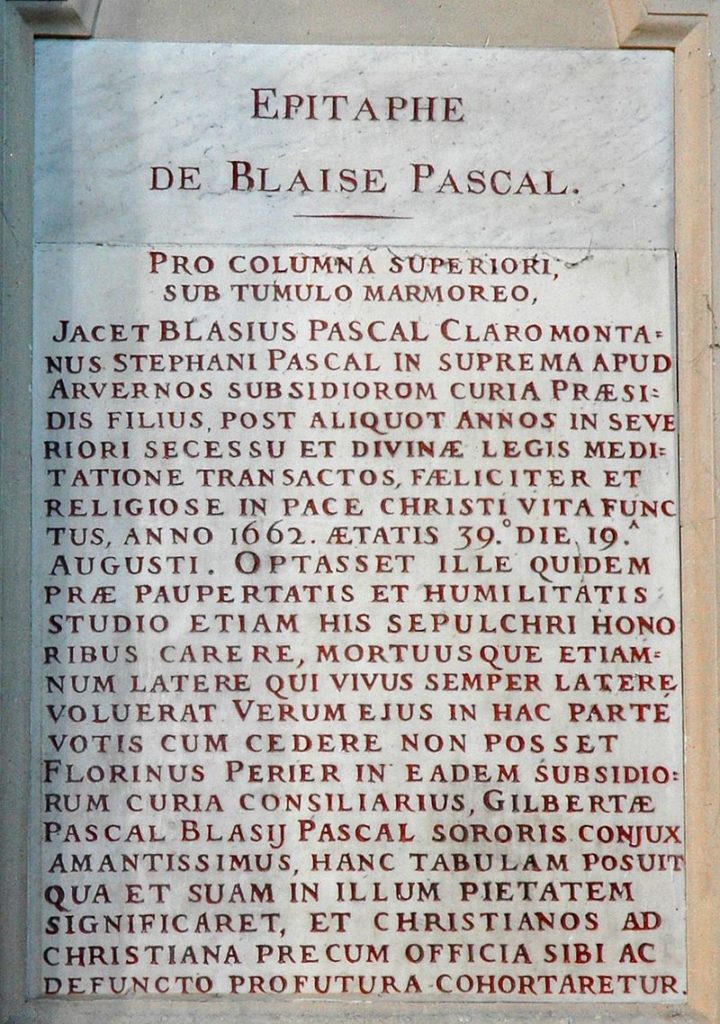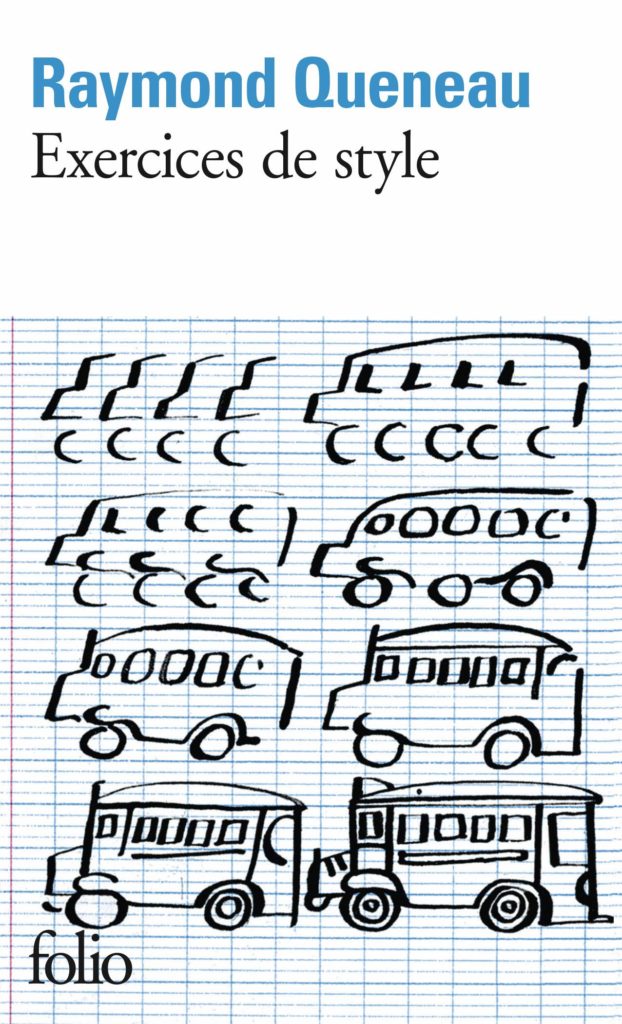María Teresa León est née le 31 octobre 1903 à Logroño. Elle est morte le 13 décembre 1988 (à 85 ans) à Majadahonda, près de Madrid. Elle fut romancière, essayiste, dramaturge et scénariste.
Son père, Ángel León, était colonel. Sa mère, Olivia Goyri, l’envoie étudier à l’Institución Libre de Enseñanza où enseigne María Goyri, sa soeur, une des pemières femmes espagnoles à avoir obtenu un doctorat et épouse du grand philologue Ramón Menéndez Pidal. María Teresa León obtient une licence en Philosophie et en Lettres.
À 16 ans, elle fugue et fait scandale. Un an près en 1920, elle épouse le journaliste et écrivain Gonzalo de Sebastián Alfaro. Elle rencontre le poète Rafael Alberti en 1929 et quitte son mari. Elle sera déchue de ses droits sur ses deux fils (Gonzalo et Enrique) qu’elle ne pourra pas revoir avant des années.
Elle adhère au Parti communiste et épouse en 1932 Alberti. Ensemble, ils voyagent dans plusieurs pays d’Europe. De retour à Madrid, Maria Teresa León crée la revue Octobre, « pour la défense de l’URSS, contre le fascisme ». Quand éclate la révolte des mineurs des Asturies, en 1934, le couple est à Moscou, au premier congrès des écrivains soviétiques. En Espagne, leur maison est fouillée. Pour le Parti communiste, ils partent aux États-Unis, puis au Mexique et à Cuba, afin de multiplier les conférences et articles pour alerter sur la menace fasciste.
La guerre civile les surprend à Ibiza. Dans un premier temps, ils se cachent dans l’île, puis reviennent à Madrid. À la fin du mois de juillet 1936, sous les bombardements, elle fait évacuer de nombreux tableaux des musées madrilènes vers des villes plus sûres. Elle fonde et anime la revue El Mono Azul, crée les Guérillas du théâtre, qui donnent des représentations près des lignes de front auprès des soldats républicains. Secrétaire de l’Alliance des écrivains antifascistes, Marie Teresa León organise les réunions de 1937 qui aboutissent au congrès de Madrid pour la défense de la culture. Il réunit de nombreux écrivains d’Europe et d’Amérique latine.
À la fin de la guerre civile, le couple est hébergé à Paris chez leurs amis, Pablo Picasso et Pablo Neruda. Ils vivent en exil en Argentine de 1940 à 1963, puis à Rome de 1963 à 1977. Maria Teresa León continue d’écrire mais doit faire face à la maladie d’Alzheimer. Elle n’aura conscience ni de la mort de Franco ni de son retour en Espagne en 1977, après trente-huit ans d’exil.
Dans Las simsombrero. Las pensadoras y artistas olvidadas de la Generación del 27 (Espasa, 2016; Booket, 2019), Tània Balló insiste particulièrement sur son œuvre qui est trop méconnue.
Memoria de la melancolía (Editorial Losada, Buenos Aires, 1970; Clásicos Castalia, 1999) est une autobiographie importante qui mérite d’être lue et relue.
« Porque todos los desterrados de España tenemos los ojos abiertos a los sueños. León Felipe aseguró que nos habíamos llevado la canción en los labios secos y fruncidos, callados y tristes. Yo creo que nos hemos llevado la ley que hace al hombre vivir en común, la ley de la vida diaria, hermosa verdad transitoria. Nos la llevamos sin saberlo, prendida en los trajes, en los hombros, entre los dedos de las manos… Somos hombres y mujeres obedientes a otra ley y a otra justicia que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoró de nuestro solar, de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestras ciudades. No sé si se dan cuenta los que quedaron por allá, o nacieron después de quiénes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos la aurora que están esperando.
Un día se asombrarán de que lleguemos, de que nos regresemos con nuestras ideas altas como palmas para el domingo de los ramos alegres. Nosotros, los del paraíso perdido.» (páginas 97-98)
«La memoria puede tener los ojos indulgentes. Ya no llegan a nosotros los ruidos vivos sino los muertos. Memoria del olvido, escribió Emilio Prados, memoria melancólica, a medio apagar, memoria de la melancolía. No sé quién solía decir en mi casa: hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales. Pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y te obliguen a mirarlos y te muerdan y se revuelquen sobre tus entrañas, que es el lugar de la memoria.» (página 130)
«Somos el producto de lo que los otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros. ¡Qué equivocados vamos hacia la muerte! Yo siento que me hice del roce de tanta gente: de la monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que se nos insinuó, del que nos empujó, del que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y sentimos aún la mordedura… Todos, todos. Somos lo que nos han hecho, lentamente, al correr tantos años. Cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos.¡Qué lección de humildad!» (páginas 146-147)
«No sé si podemos elegir sitio para morir; Lo que decididamente no elegimos en nuestro complicado mundo de fronteras y pasaportes es dónde vivir. Dicen que desde hace siglos ocurre esto y, a consuelo de tontos…» (página 209)
« Estas cuartillas que voy escribiendo se me han volado todas dispersándose, jugando a la mala pasada de huirme. Voy hacia ellas, amarillas o verdosas aún. Cómo se han reído siempre delante de mis pasos todos los otoños. Se las lleva el viento, los vientos que nos soplan en los oídos las medias palabras. No sé ya qué me cuentan. Sé que silabean corriendo, juntando puntas de palabras, hasta palabras caminando pequeñas, persuasivas, enhebrando una verdad que jamás comprendemos. Vuelas, vuelas bien, memoria, memoria de la melancolía. Puede que sean los falsos recuerdos, los amores menudos los que hayan decretado que te lo diga en este otoño. Un otoño más. Basta, no quiero números no he sabido jamás qué debo hacer con ellos. Dirán las hojas que me faltan manos para agarrar mi verdadera vida o dientes para morderla. No, no, es que amarilleo también y doblo la cabeza cuando comienzan los otoños. Miro cómo corren hasta los papeles creyéndose pájaros o ese mensaje por el cual se ha pagado más para que llegue como el viento. Papeles en la calle…¿Los habéis visto volar? El mal humor ciudadano levanta su cuerpo leve y vuelan hasta que las ruedas del automóvil los detiene y aplasta con la ley del más fuerte. ¿Así me ocurrirá? En esta poco arrulladora vida, ¿volarán las hojas de mi recuerdo hasta que alguien las aplaste por inútiles?
Hoy todas se me han dispersado con vida propia y no con la que yo les impuse al escribirlas. ¿Cuándo caerán de nuevo? Es la bandada que huye al llegar mordiendo el frío y apenas dice adiós.» (páginas 393-394)