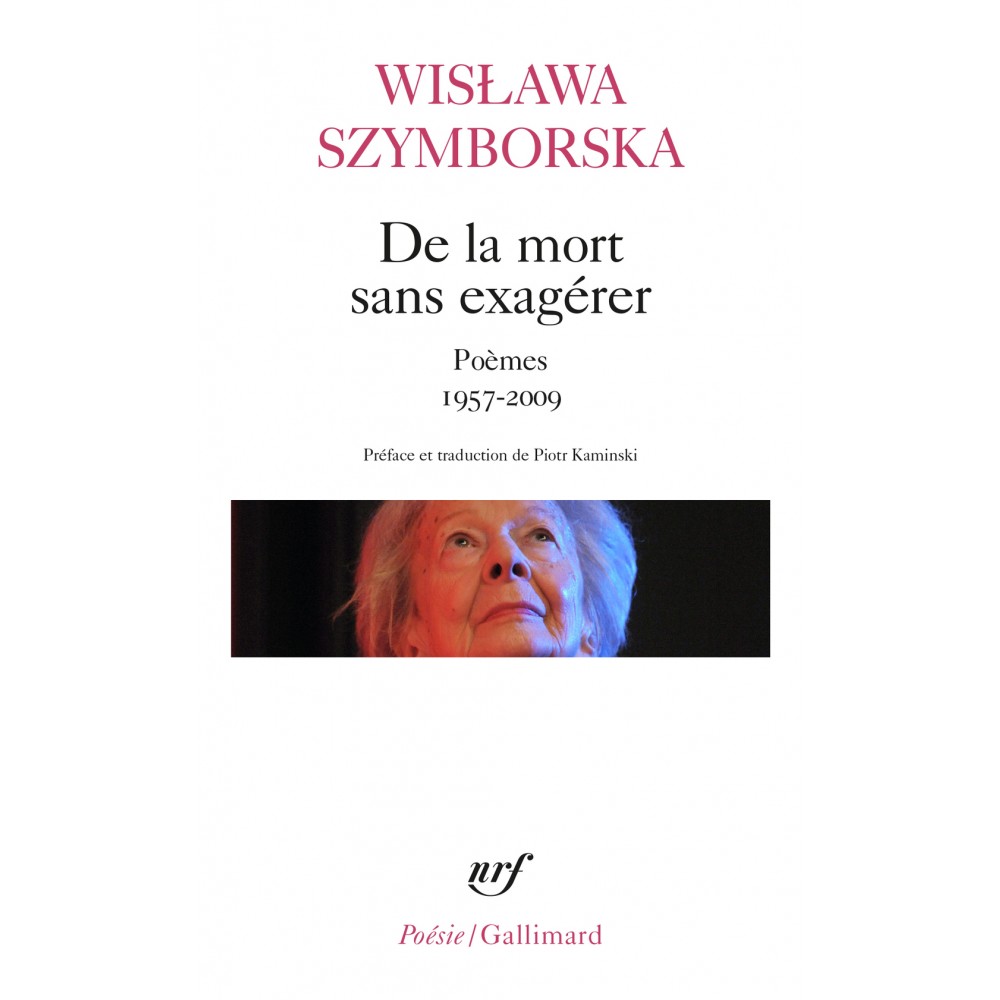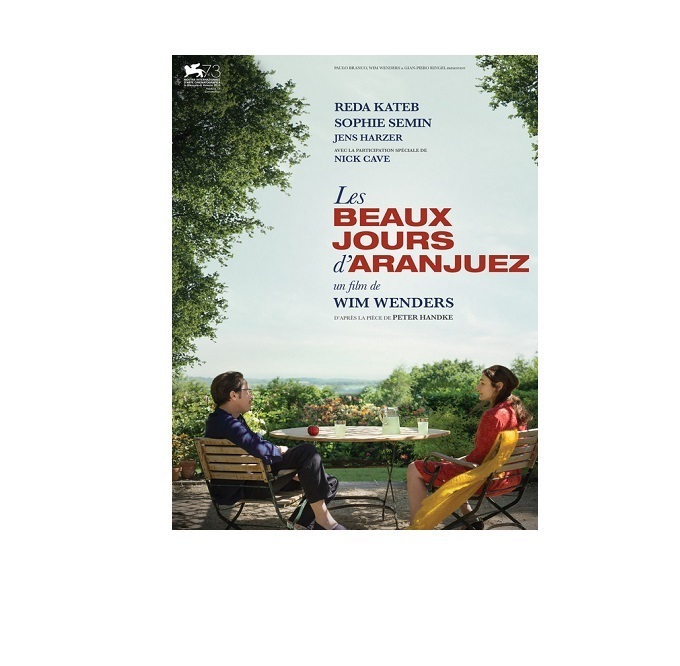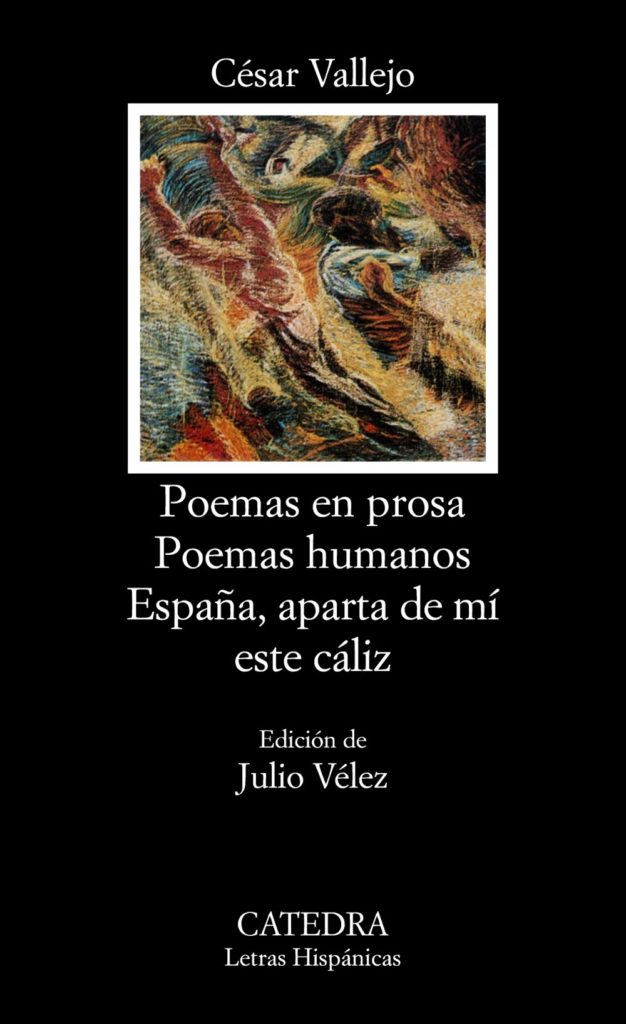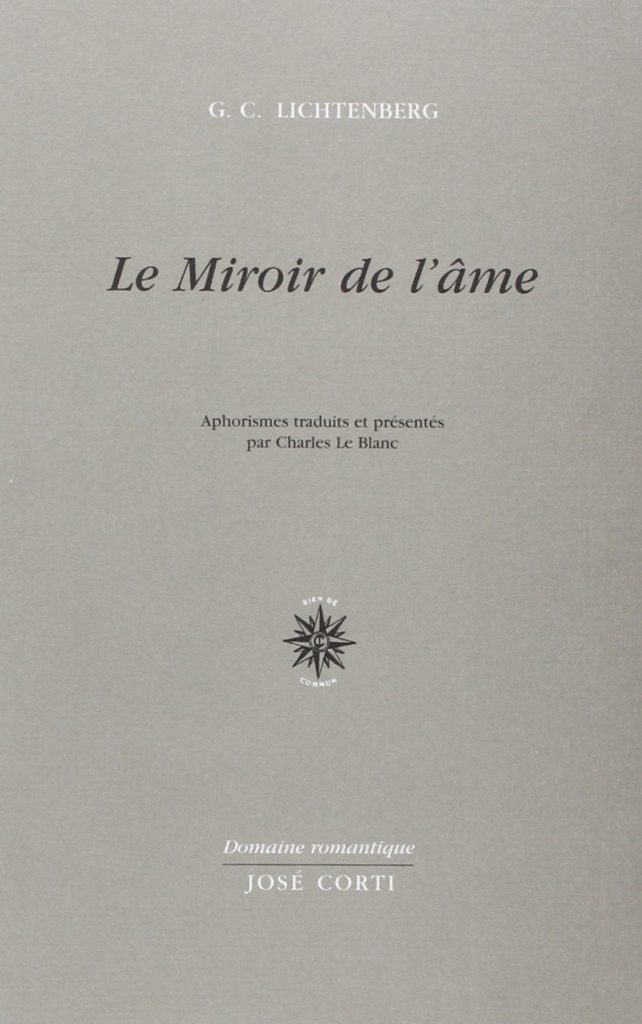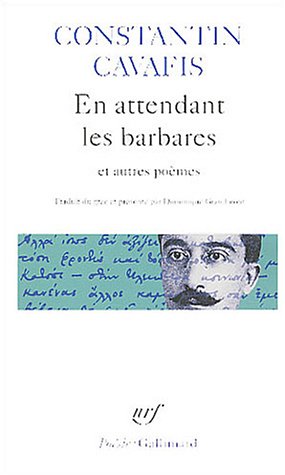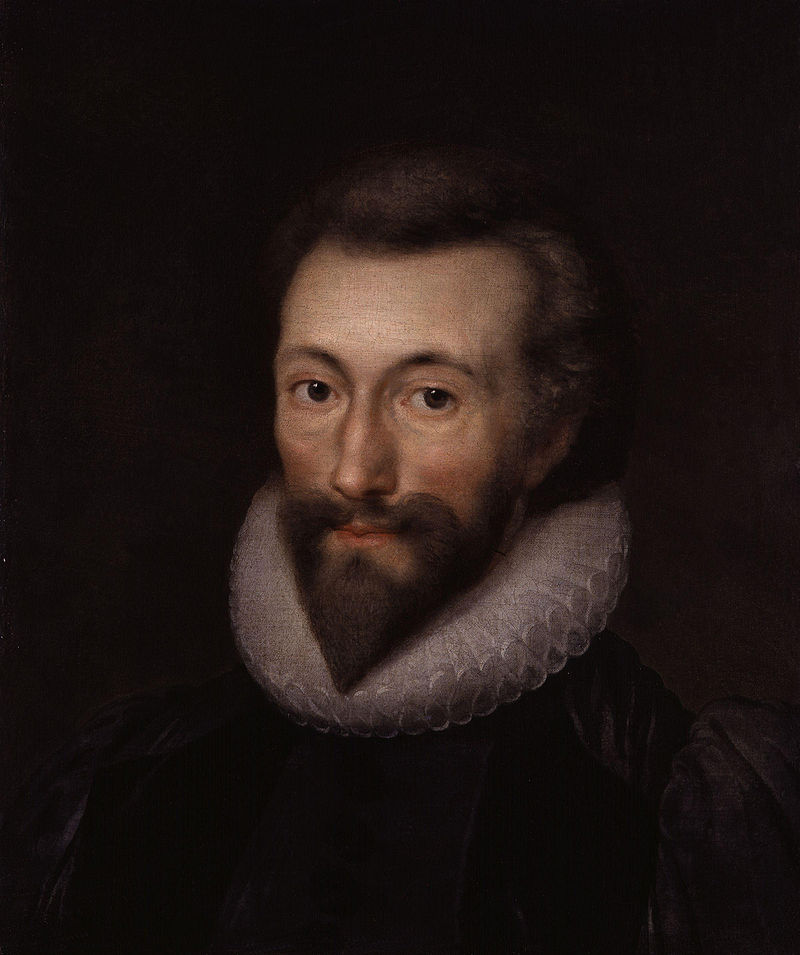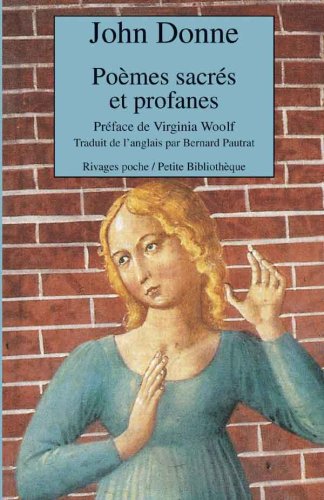Les fleuves
Je m’appuie à un arbre mutilé
abandonné dans cette combe
qui a la langueur
d’un cirque
avant ou après le spectacle
et je regarde
le passage paisible
des nuages sur la lune
Ce matin je me suis étendu
dans l’urne de l’eau
et comme une relique
j’ai reposé
L’Isonzo en coulant
me polissait
comme un de ses galets
J’ai ramassé
mes os
et m’en suis allé
comme un acrobate
sur l’eau
Je me suis accroupi
près de mes habits
sales de guerre
et comme un bédouin
je me suis prosterné pour recevoir
le soleil
Voici l’Isonzo
et mieux ici
je me suis reconnu
fibre docile
de l’univers
Mon supplice
c’est quand
je ne me crois pas
en harmonie
Mais ces occultes
mains
qui me pétrissent
m’offrent
la rare
félicité
J’ai repassé
les époques
de ma vie
Voici
mes fleuves
Celui-ci est le Serchio
c’est à lui qu’ont puisé
deux mille années peut-être
de mon peuple campagnard
et mon père et ma mère
Celui-ci c’est le Nil
qui m’a vu
naître et grandir
et brûler d’ingénuité
dans l’étendue de ses plaines
Celle-là est la Seine
dans ses eaux troubles
s’est refait mon mélange
et je me suis connu
Ceux-là sont mes fleuves
comptés dans l’Isonzo
Et c’est là ma nostalgie
qui dans chaque être
m’apparaît
à cette heure qu’il fait nuit
que ma vie me paraît
une corolle
de ténèbres
Cotici, 16 août 1916
Traduit de l’italien par Jean Lescure. Editions de Minuit, 1954.
«Vie d’un homme. Poésie 1914-1970» Editions Poésie/Gallimard , 1981. Pages 58-60.

I Fiumi
Mi tengo a quest’albero mutilato
Abbandonato in questa dolina
Che ha il languore
Di un circo
Prima o dopo lo spettacolo
E guardo
Il passaggio quieto
Delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
In un’urna d’acqua
E come una reliquia
Ho riposato
L’Isonzo scorrendo
Mi levigava
Come un suo sasso
Ho tirato su
Le mie quattro ossa
E me ne sono andato
Come un acrobata
Sull’acqua
Mi sono accoccolato
Vicino ai miei panni
Sudici di guerra
E come un beduino
Mi sono chinato a ricevere
Il sole
Questo è l’Isonzo
E qui meglio
Mi sono riconosciuto
Una docile fibra
Dell’universo
Il mio supplizio
È quando
Non mi credo
In armonia
Ma quelle occulte
Mani
Che m’intridono
Mi regalano
La rara
Felicità
Ho ripassato
Le epoche
Della mia vita
Questi sono
I miei fiumi
Questo è il Serchio
Al quale hanno attinto
Duemil’anni forse
Di gente mia campagnola
E mio padre e mia madre.
Questo è il Nilo
Che mi ha visto
Nascere e crescere
E ardere d’inconsapevolezza
Nelle distese pianure
Questa è la Senna
E in quel suo torbido
Mi sono rimescolato
E mi sono conosciuto
Questi sono i miei fiumi
Contati nell’Isonzo
Questa è la mia nostalgia
Che in ognuno
Mi traspare
Ora ch’è notte
Che la mia vita mi pare
Una corolla
Di tenebre
Cotici il 16 agosto 1916
Vita d’un uomo. Tutte le poesie. Mondadori editore, Milano, 1969.
Vittorio Gassman lit Les fleuves de Giuseppe Ungaretti: