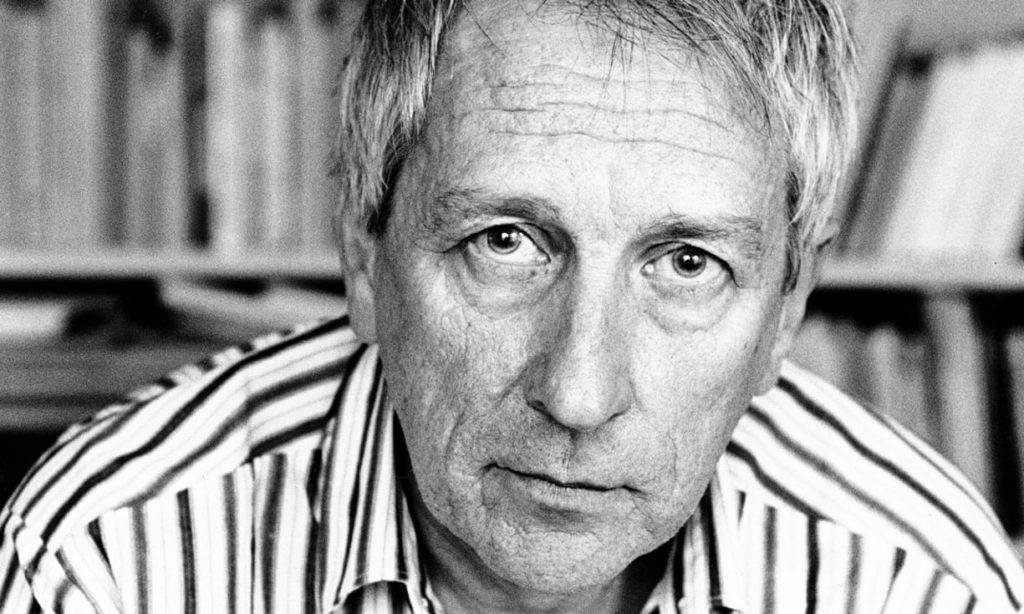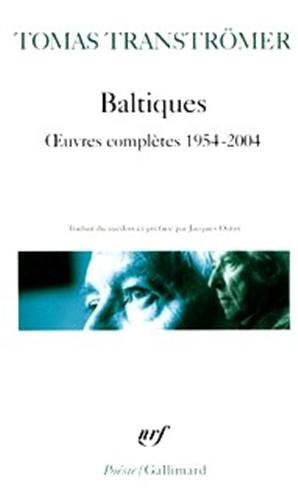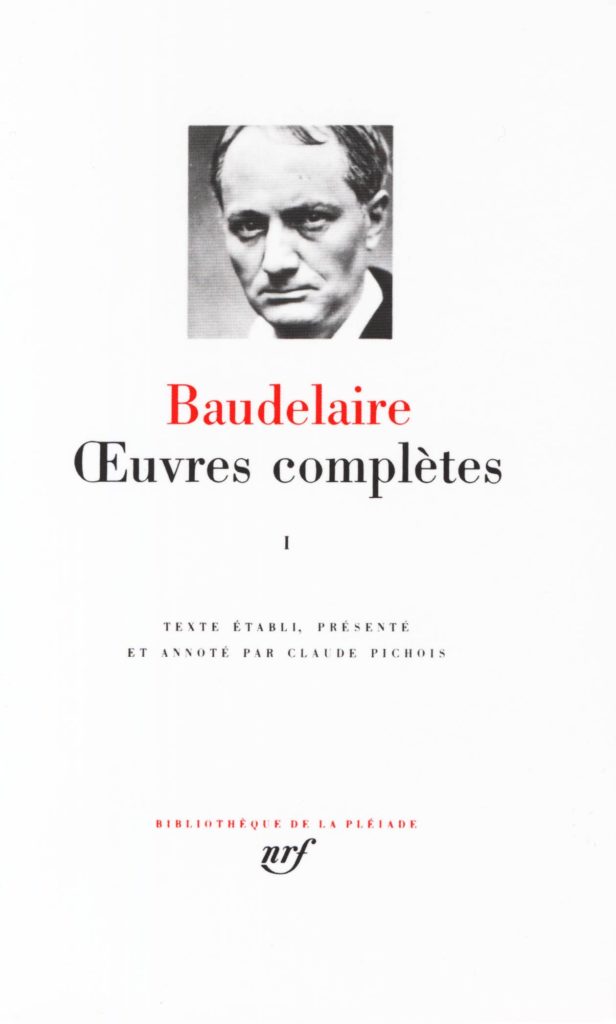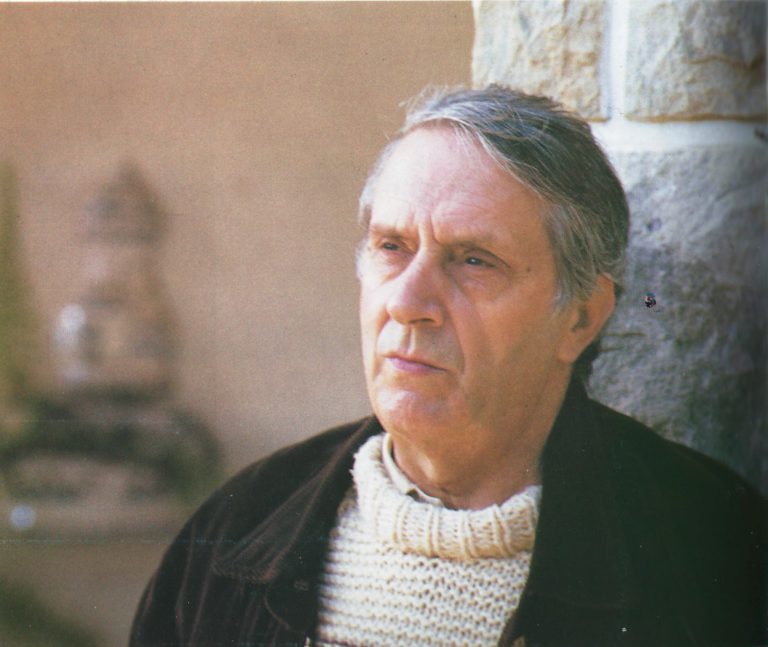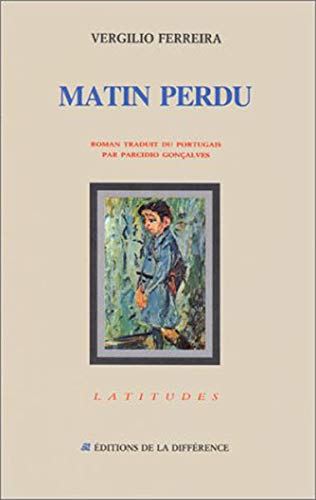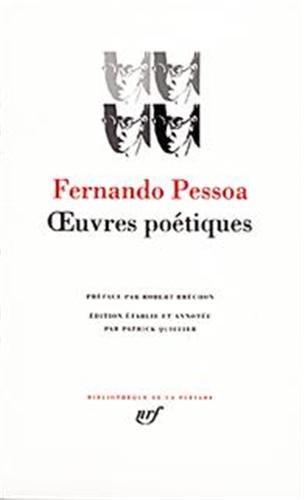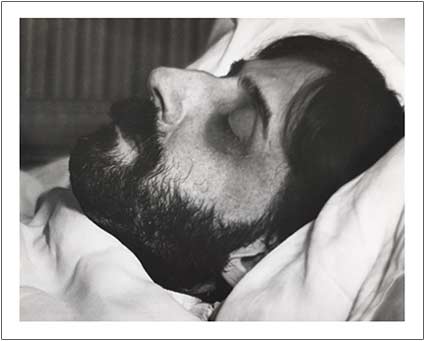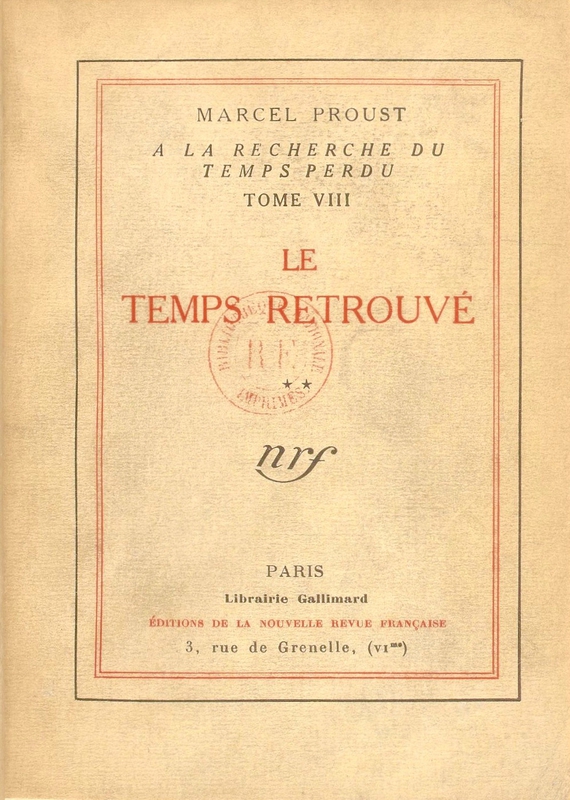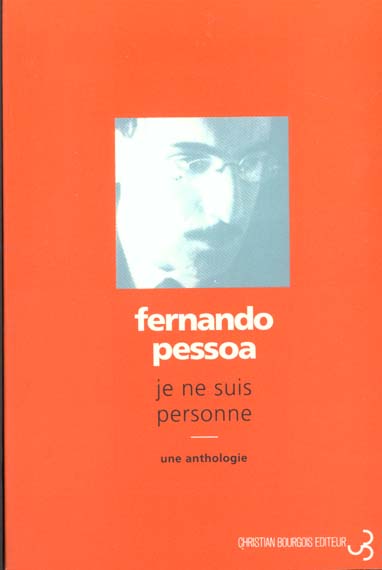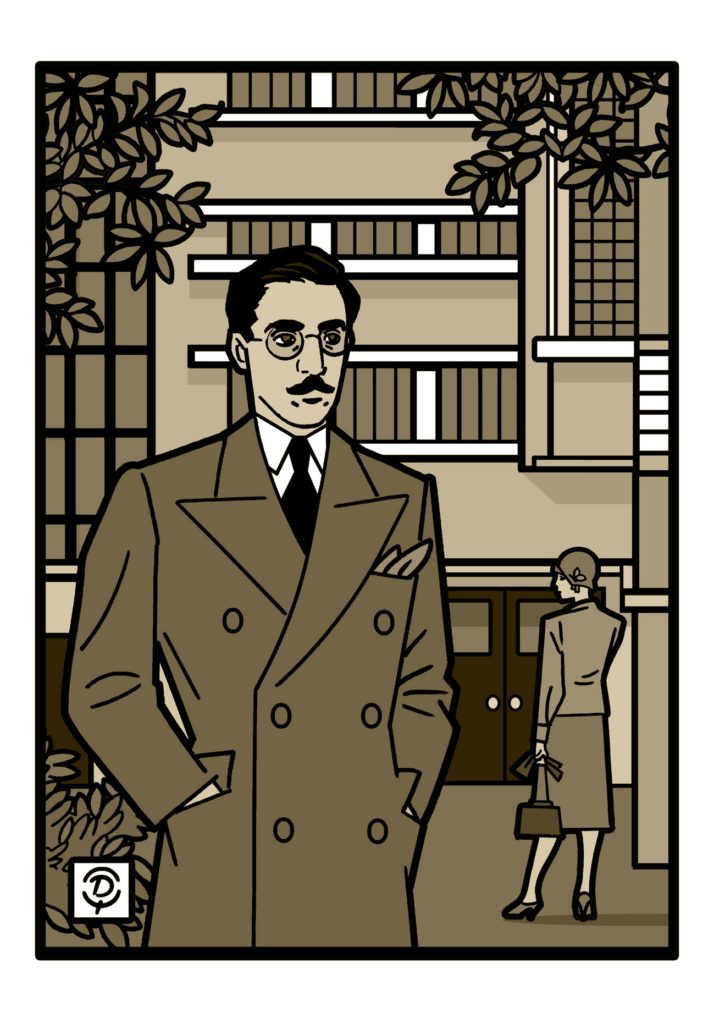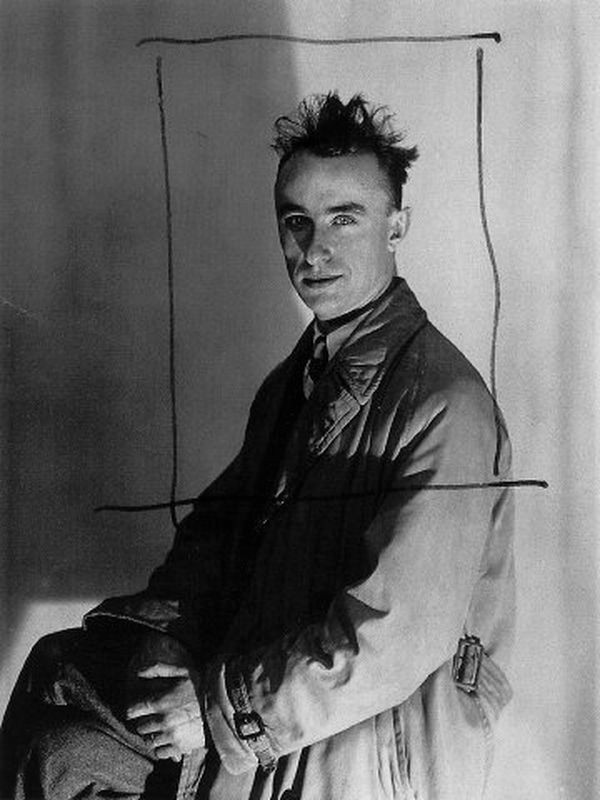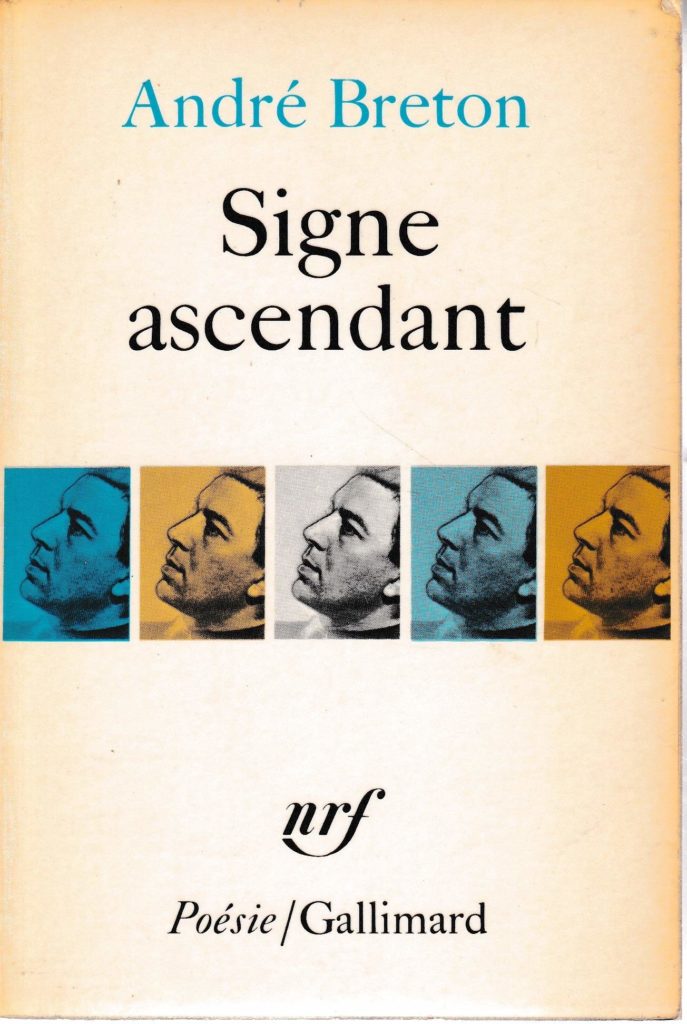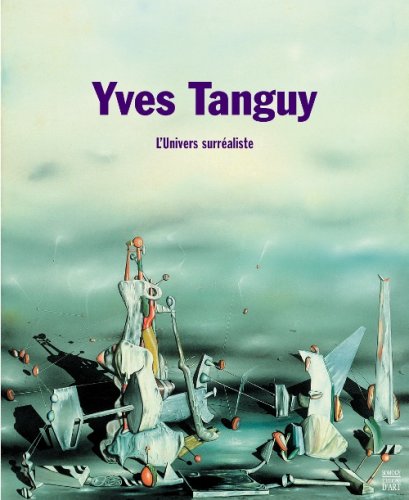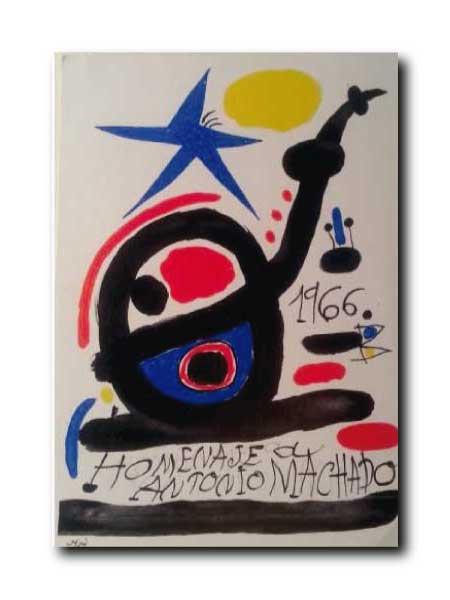
Une nuit d’insomnie m’a fait relire ces deux poèmes de Machado et de García Lorca.
Inventario galante
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano,
negras noches sin luna,
orilla al mar salado,
y el chispear de estrellas
del cielo negro y bajo.
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano.
Y tu morena carne,
los trigos requemados,
y el suspirar de fuego
de los maduros campos.
Tu hermana es clara y débil
como los juncos lánguidos,
como los sauces tristes,
como los linos glaucos.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano…
Y es alba y aura fría
sobre los pobres álamos
que en las orillas tiemblan
del río humilde y manso.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano.
De tu morena gracia
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Me embriagaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,
una canción que deje
cenizas en los labios…
De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Para tu linda hermana
arrancaré los ramos
de florecillas nuevas
a los almendros blancos
en un tranquilo y triste
alborear de marzo.
Los regaré con agua
de los arroyos claros,
los ataré con verdes
junquillos del remanso…
Para tu linda hermana
yo haré un ramito blanco.
Canciones, 1899-1907.
Inventaire galant
Tes yeux me rappellent
les nuits d’été,
nuits noires sans lune,
sur le bord de la mer salée,
et le scintillement des étoiles
dans le ciel noir et bas.
Tes yeux me rappellent
les nuits d’été.
Et ta chair brune,
les blés brûlés,
et le soupir de feu
des champs mûrs.
Ta soeur est claire et faible
comme les joncs languides,
comme les saules tristes,
comme les lins glauques.
Ta soeur est une étoile
dans l’azur lointain…
Une aube, une brise froide
sur les pauvres peupliers
qui tremblent sur la rive
de l’humble et douce rivière.
Ta soeur est une étoile
dans l’azur lointain.
De ta grâce brune,
de ton songe gitan,
de ton regard d’ombre
je veux emplir mon verre.
Je m’enivrerai une nuit
de ciel noir et bas,
pour chanter avec toi,
au bord de la mer salée,
une chanson qui laissera
des cendres sur les lèvres…
De ton regard d’ombre
je veux emplir mon verre.
Pour ta soeur jolie
j’arracherai les branches
pleines de fleurs nouvelles
des blancs amandiers,
en une aube tranquille
et triste de mars.
Je les arroserai de l’eau
des clairs ruisseaux,
je les enlacerai des joncs
verts qui poussent dans l’eau…
Pour ta soeur jolie
Je ferai un bouquet tout blanc.
Champs de Castille précédé de Solitudes, Galeries et autres poèmes et suivi de Poésies de la guerre. Collection Poésie/Gallimard n° 144, Traduction: Sylvie Léger et Bernard Sesé.
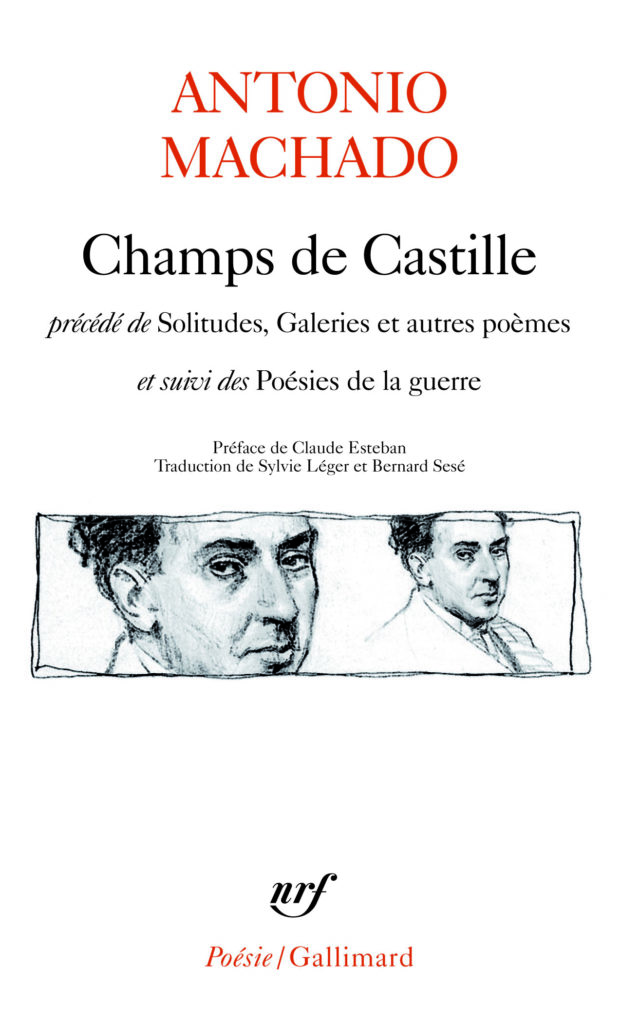
Rafael Alberti, 88 ans et Paco Ibáñez. Récital de poesie et de chansons 21, 22 et 23 mai 1991. Teatro Alcalá Palace de Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=8zPboATGzwQ
El poeta dice la verdad
Quiero llorar mi pena y te lo digo
para que tú me quieras y me llores
en un anochecer de ruiseñores,
con un puñal, con besos y contigo.
Quiero matar al único testigo
para el asesinato de mis flores
y convertir mi llanto y mis sudores
en eterno montón de duro trigo.
Que no se acabe nunca la madeja
del te quiero me quieres, siempre ardida
con decrépito sol y luna vieja.
Que lo que me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida.
Sonetos del amor oscuro
Le poète dit la vérité
Je veux pleurer ma peine et te le dire
pour que tu m’aimes et pour que tu me pleures
par un long crépuscule de rossignols
où poignard et baisers pour toi délirent.
Je veux tuer le seul témoin, l’unique,
qui a pu voir assassiner mes fleurs,
et transformer ma plainte et mes sueurs
en éternel monceau de durs épis.
Fais que jamais ne s’achève la tresse
du je t’aime tu m’aimes toujours ardente
de jours, de cris, de sel, de lune ancienne,
car tes refus rendus à mes silences
se perdront tous dans la mort qui ne laisse
pas même une ombre à la chair frémissante.
Poésies, Tome IV. Collection Poésie/Gallimard n° 185, Traduction: André Belamich.
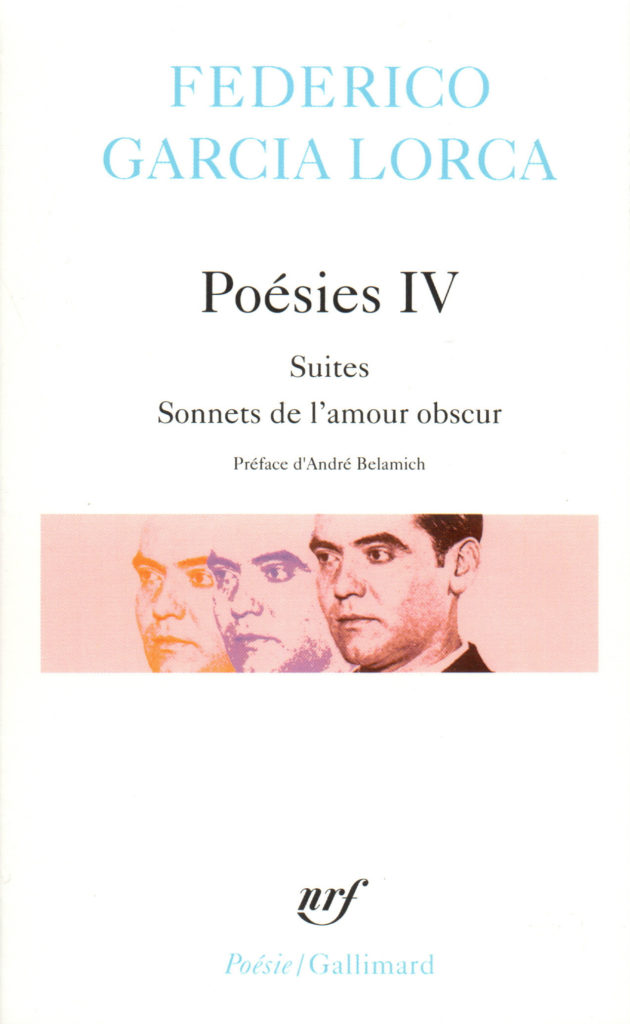
(Merci à Laura Rambla)