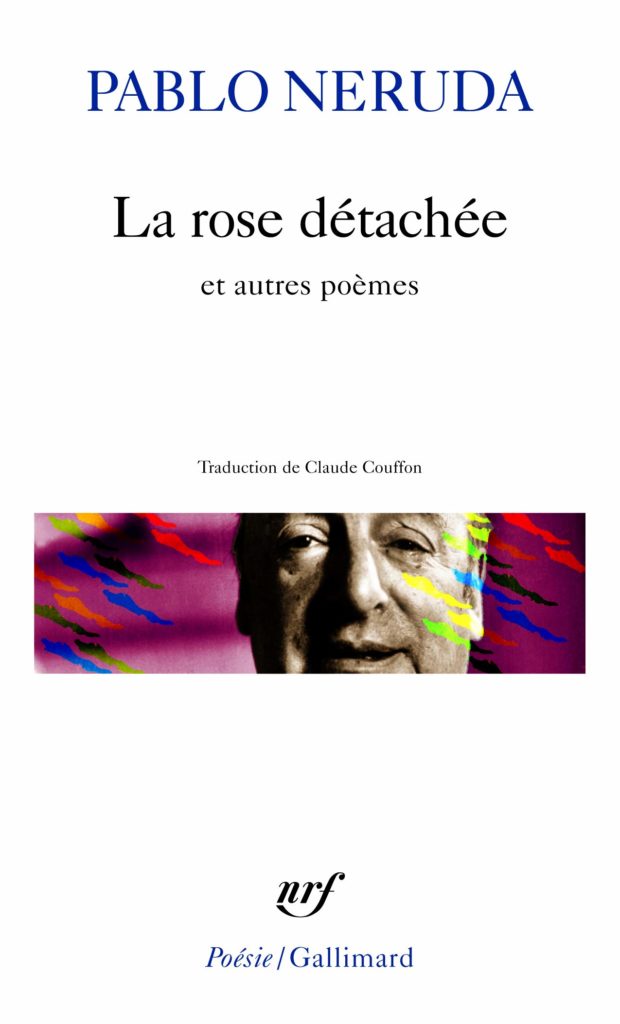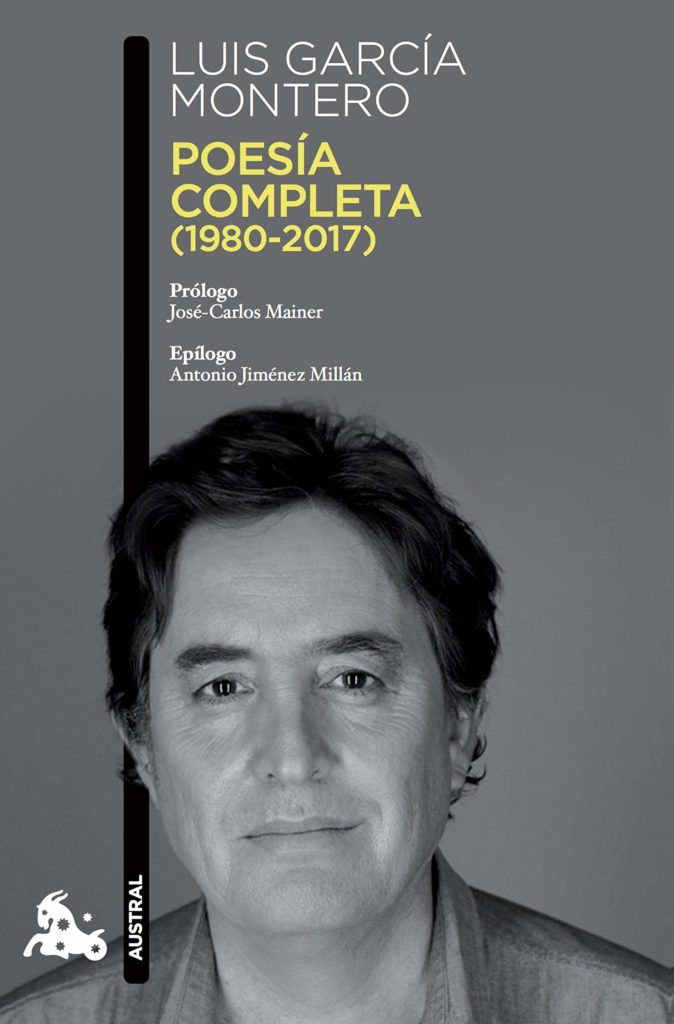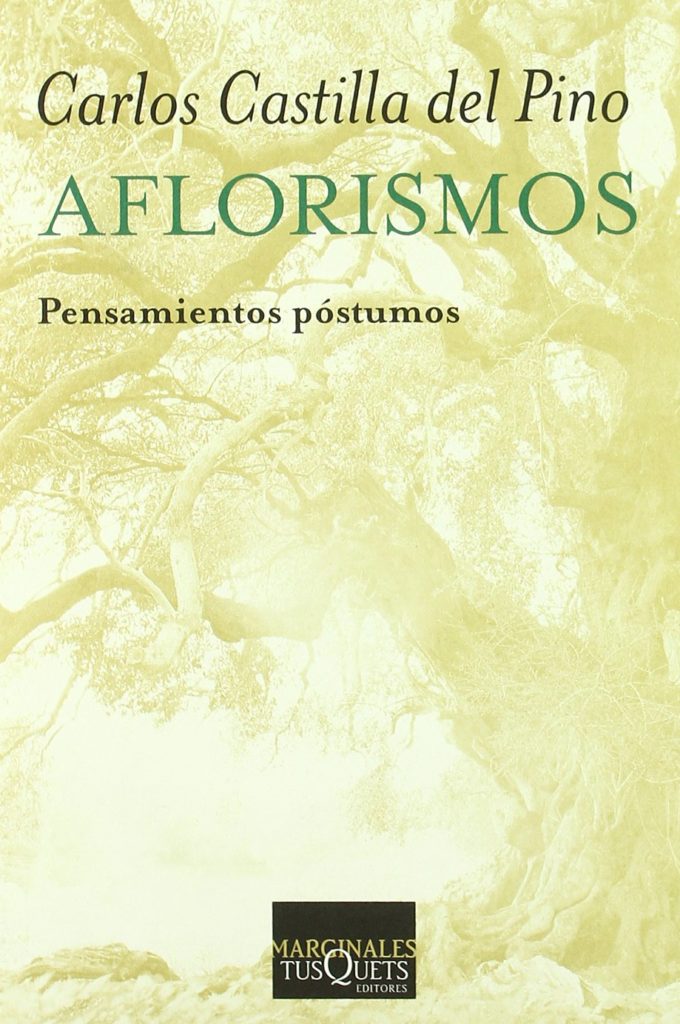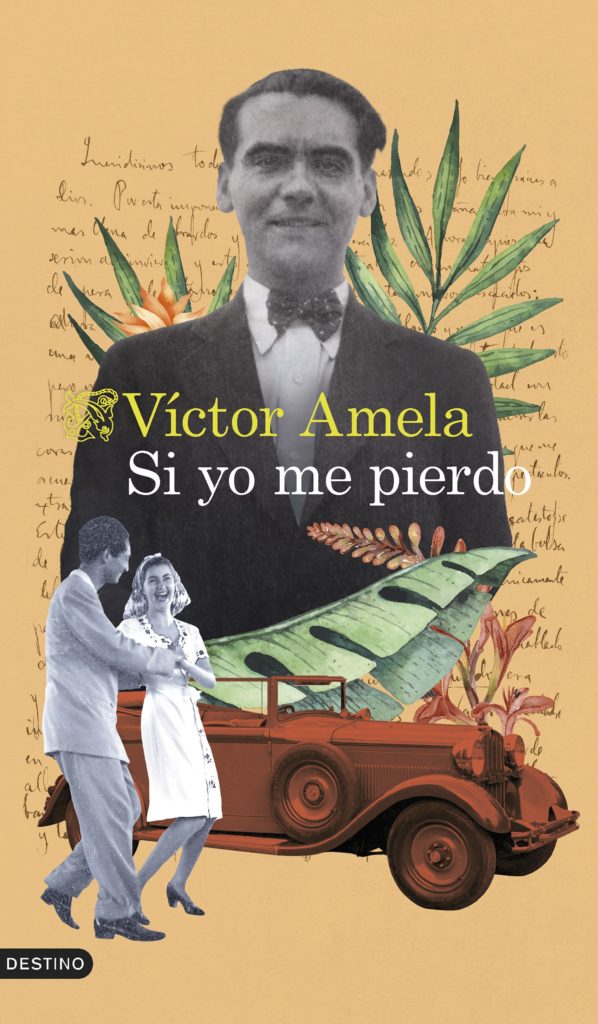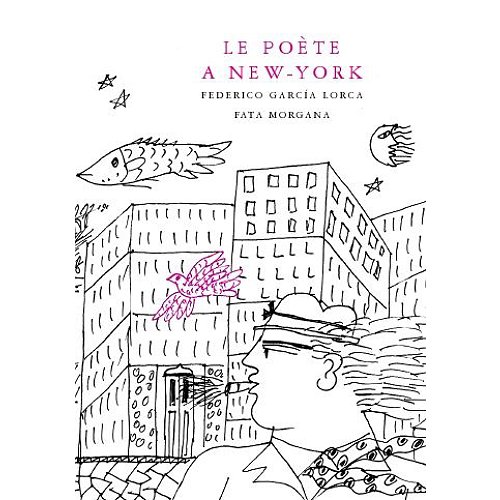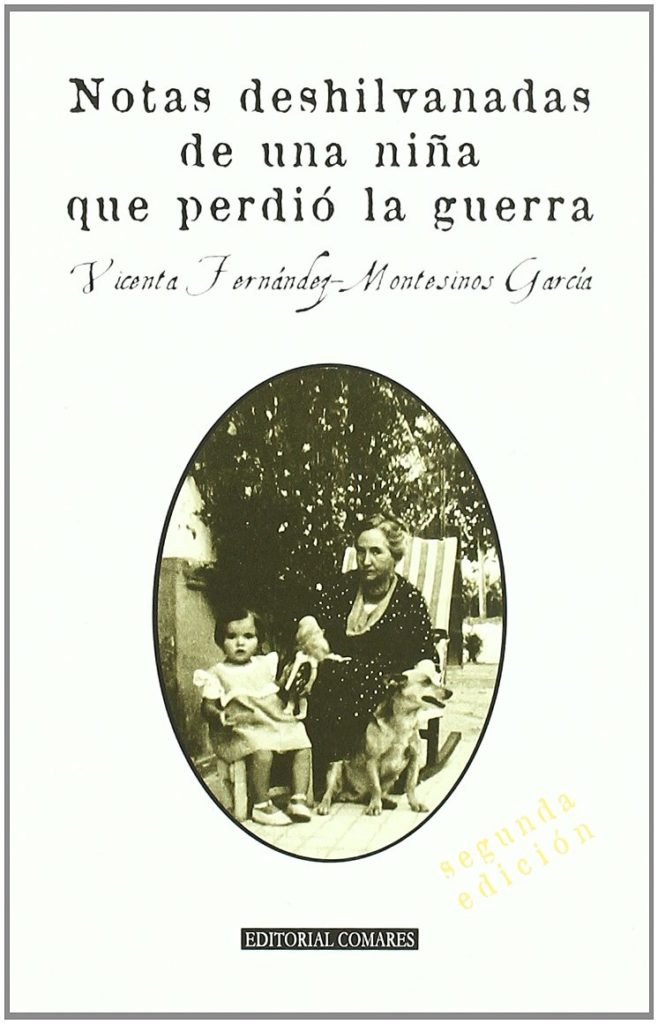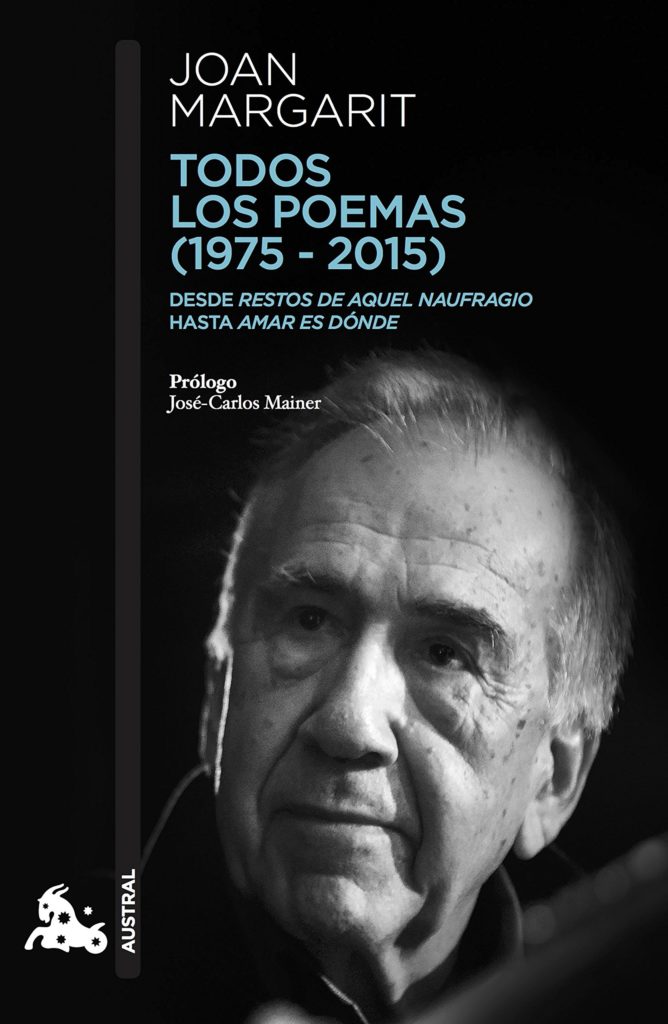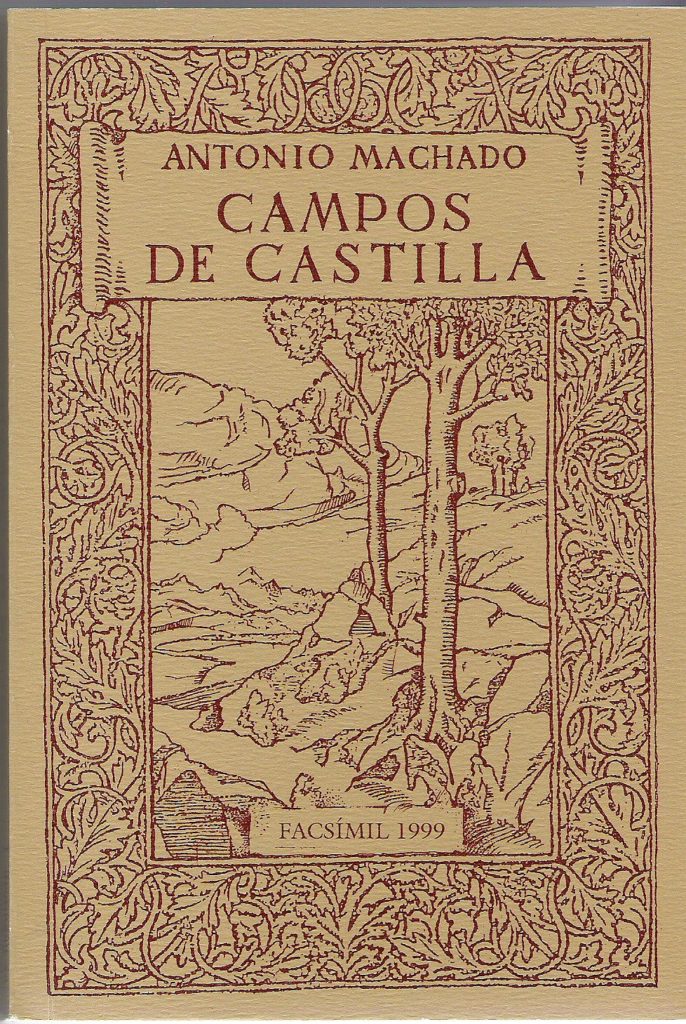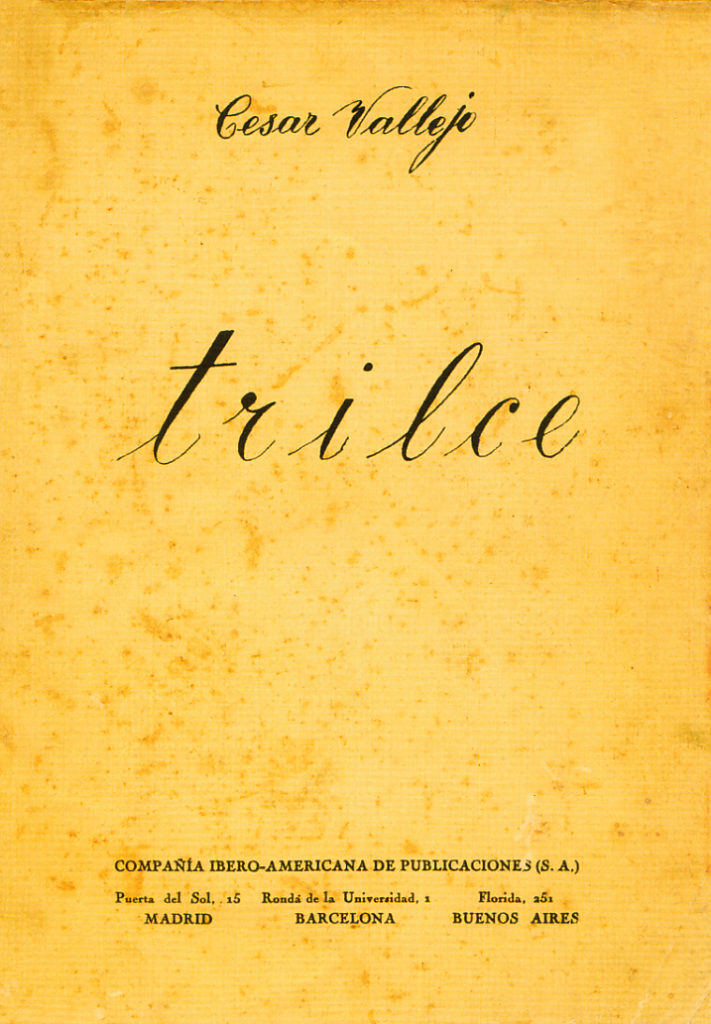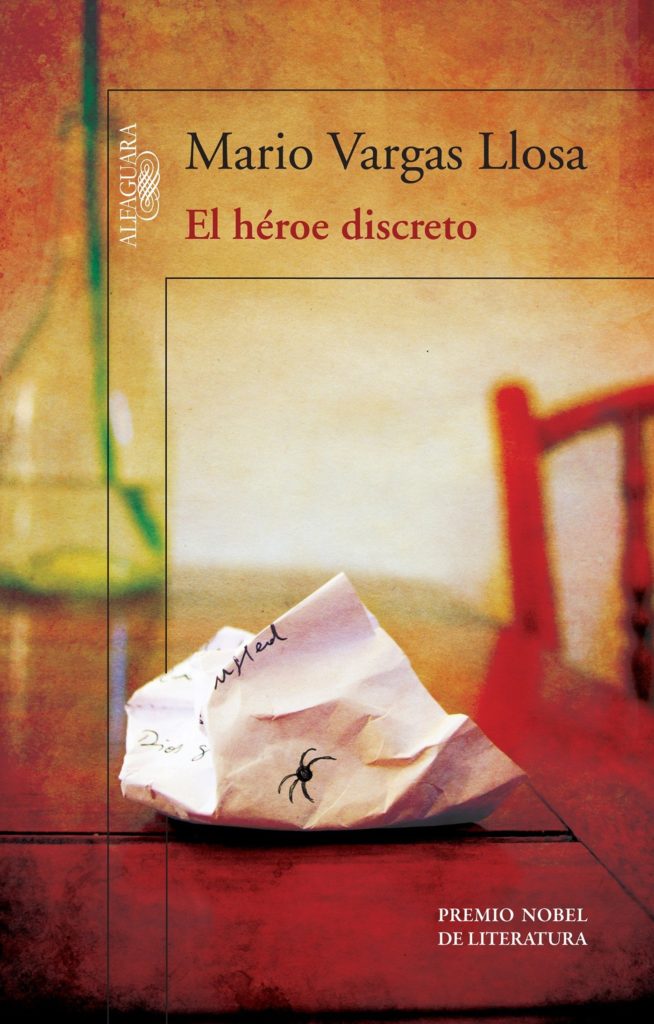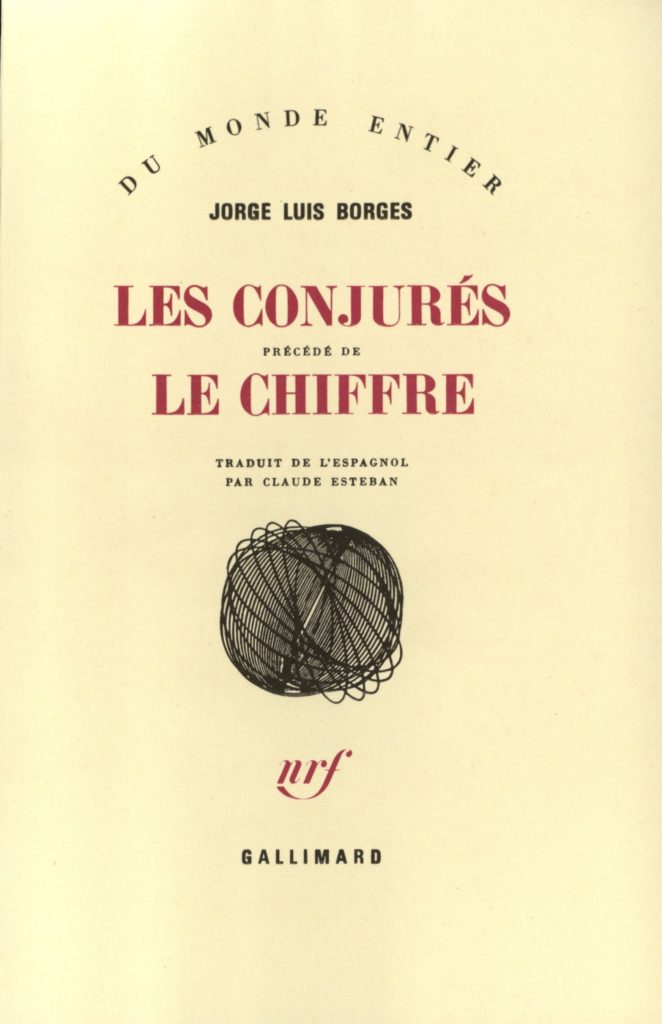Agustina González López, “la Zapatera” est née le 3 avril 1891 à Grenade dans le quartier de l’Albaicin, l’ancien quartier arabe. Cette écrivaine et activiste politique fit ses études au Real Colegio de Santo Domingo de la ville. Elle s’intéressait particulièrement à l’astronomie et à la médecine. Quand sa mère devint veuve, elle tomba à 13 ans sous le contrôle de ses frères aînés et de ses oncles paternels. Le conseil de famille lui permit la lecture, mais elle était strictement surveillée. Pour échapper à ce contrôle, elle commença à s’habiller en homme. On la considéra rapidement comme folle et hystérique. Elle voyageait seule et entrait dans les cafés et restaurants de la conservatrice et bourgeoise Grenade : “la peor burguesía de España” disait Federico García Lorca.
Elle publia en 1916 un essai Idearium Futurismo où elle prônait une simplification de l’orthographe et la suppresion de 7 lettres : y, c, h, q, v, x, z. « El sistema futurista de eskribir resuelbe las dificultades ortográfikas por lo mismo ke simplifika la ortografía. Este libro ba todo esckrito en futurismo… » (prologue)
En 1919, il y eut des manifestations contre les pratiques des caciques conservateurs locaux auxquelles participèrent Fernando de los Ríos, avocat et futur député socialiste, mais aussi deux groupes féministes la Juventud Universitaria Femenina (Milagro Almenara, pharmacienne fusillée le 2 novembre 1936 elle aussi entre Viznar et Alfacar) et la Agrupación Feminista Socialista (présidée par Agustina González López). Cette association regroupait 200 membres.
Á cette époque, Agustina González López fit la connaissance de Federico García Lorca qui vivait à 100 mètres de chez elle. Elle lui aurait inspiré le personnage de La zapatera prodigiosa (1930) et aussi par certains traits celui d’Amelia dans La casa de Bernarda Alba (1936). Agustina González utilisait le prénom Amelia pour signer certains de ses écrits.
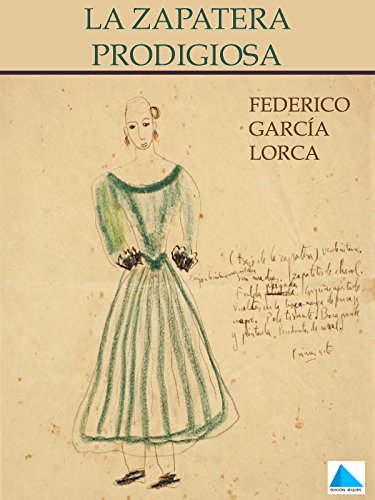
En 1927 et 1928, elle publia deux autres essais Justificación et Las Leyes secretas. Membre de la franc-maçonnerie, elle exprimait sa liberté de pensée, sa conception théosophique de la vie et de la mort, ses idées féministes et progressistes. Elle publiait ses livres à compte d’auteur et les vendait dans son magasin de chaussures, calle de Mesones n°6.
Elle écrivit aussi deux pièces de théâtre Cuando la vida calla et Los prisioneros del espacio.
Elle souhaitait supprimer les frontières, créer une monnaie universelle et en finir avec les famines. Elle créa le Partido Entero Humanista et se présenta aux élections législatives de 1933. Elle obtint seulement 15 voix.
Après le coup d’état franquiste, elle fut emprisonnée, puis transférée à Viznar et fusillée avec deux autres femmes en août 1936. On ne connaît pas exactement la date de sa mort. La légende populaire affirme qu’elle mourut en contemplant les étoiles qu’elle avait tant étudiées. Le fasciste Juan Luis Trescastro Medina (1877 -1954), avocat et membre de la CEDA, se vantait après-guerre dans les bars de Grenade d’avoir tué Federico García Lorca (« le metí dos tiros en el culo, por maricón ») et d’avoir exécuté Agustina González (« por puta »). Elle fut condamnée a posteriori ( juillet 1941) par la justice franquiste et sa famille dut payer une amende de 8 000 pesetas.
Sources :
Enriqueta Barranco Castillo. Agustina González López (1891-1936). Espiritista, teósofa, escritora y política, Editorial Universidad de Granada. 2019.
Javier Arroyo. Kedan suprimidas por konpleto siete konsonantes del kastellano. El País, 17/12/2019.
Juan I. Pérez. Agustina González López, La Zapatera, fusilada por romper moldes. Blog Foro de la Memoria. El Independiente de Granada, 7/09/2019.
Marta Sánchez Gento. La Zapatera, una granaína cruelmente asesinada que inventó el lenguaje del chat en los años 20. La Voz del sur, 15/11/2021.