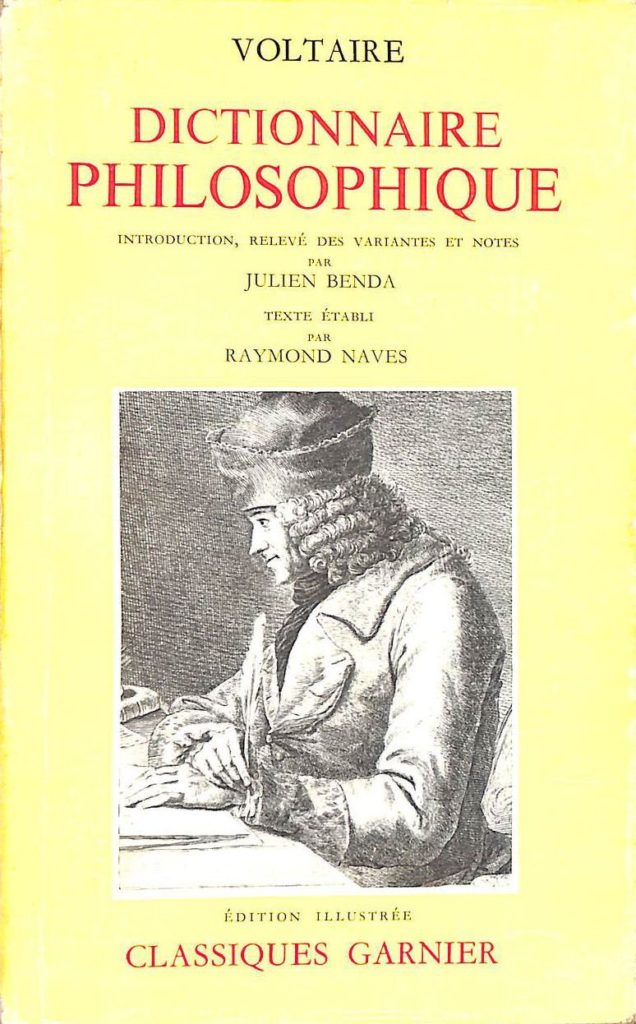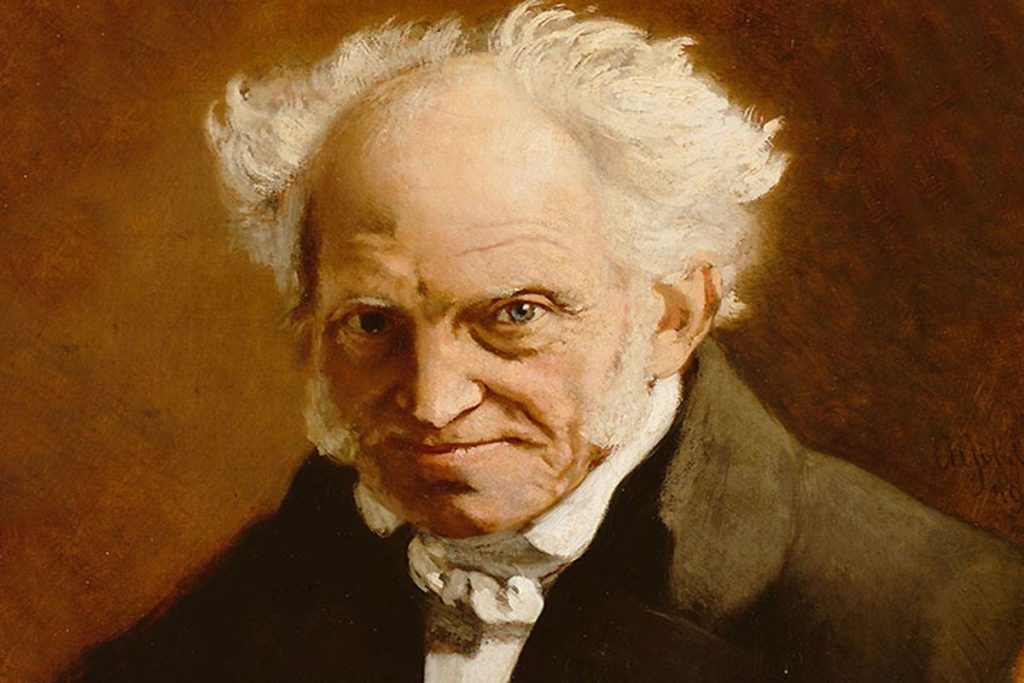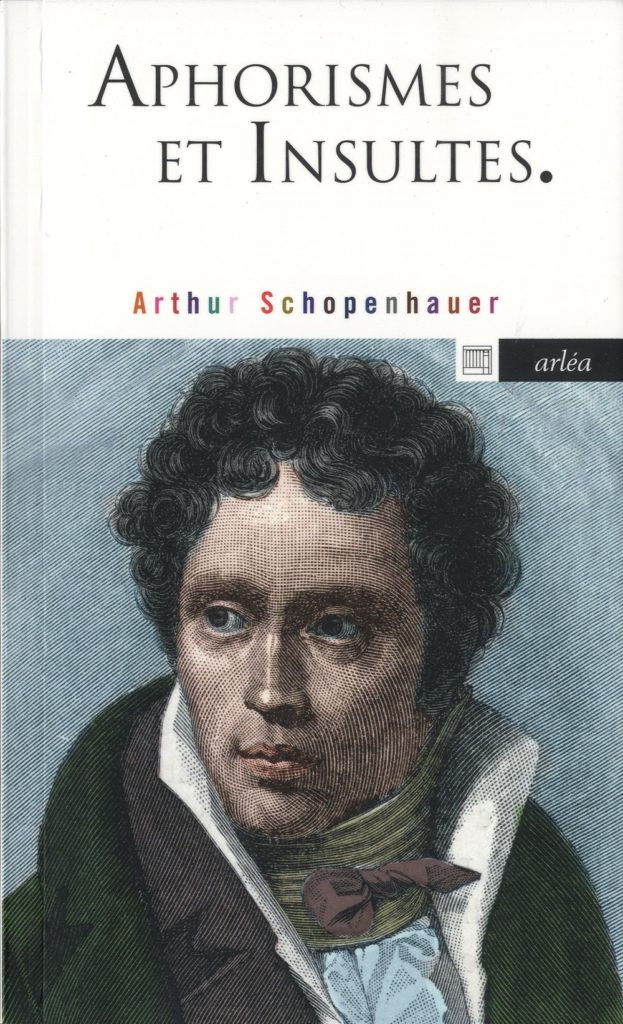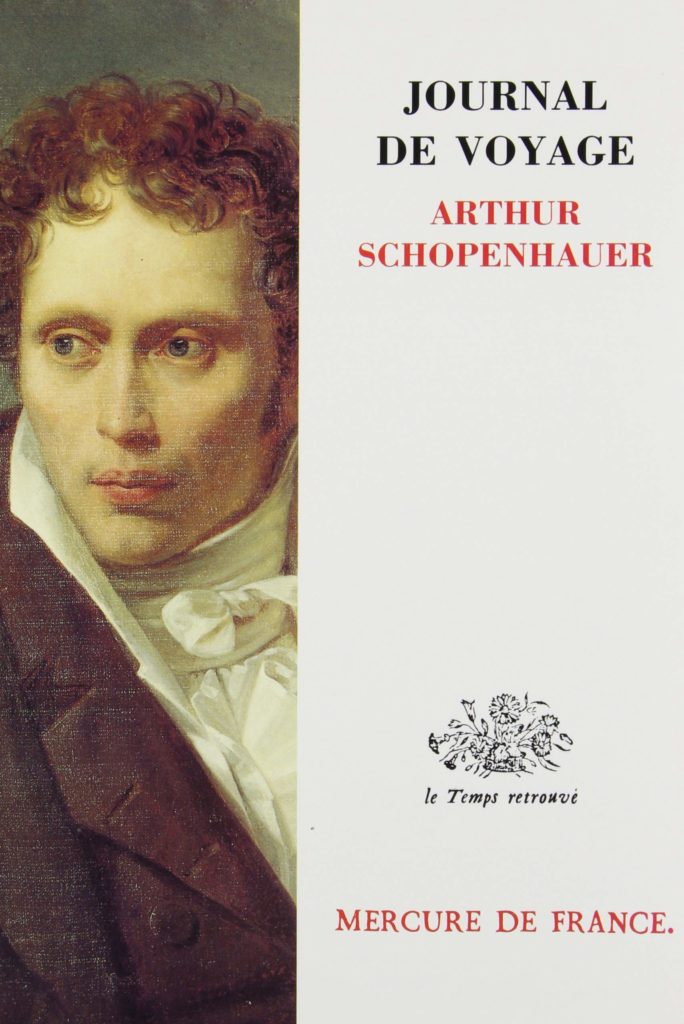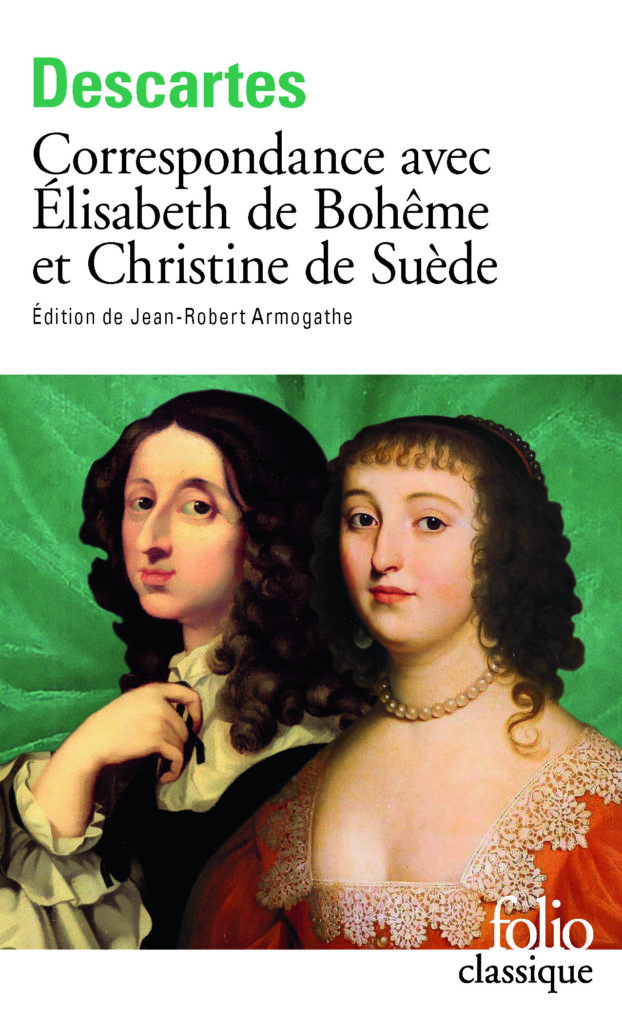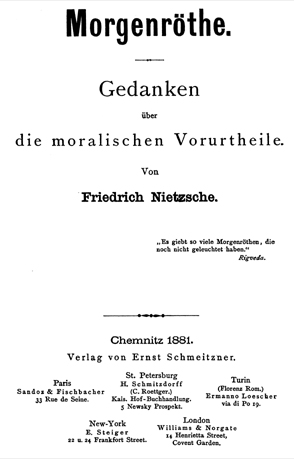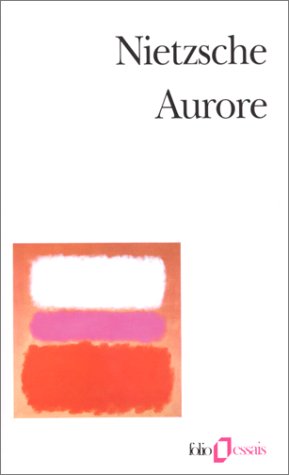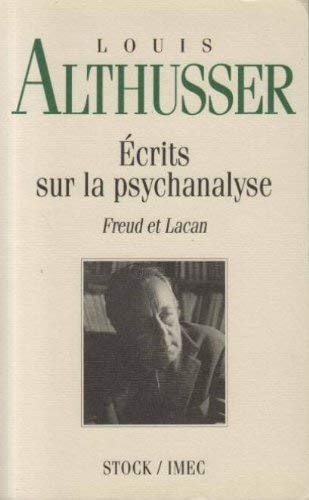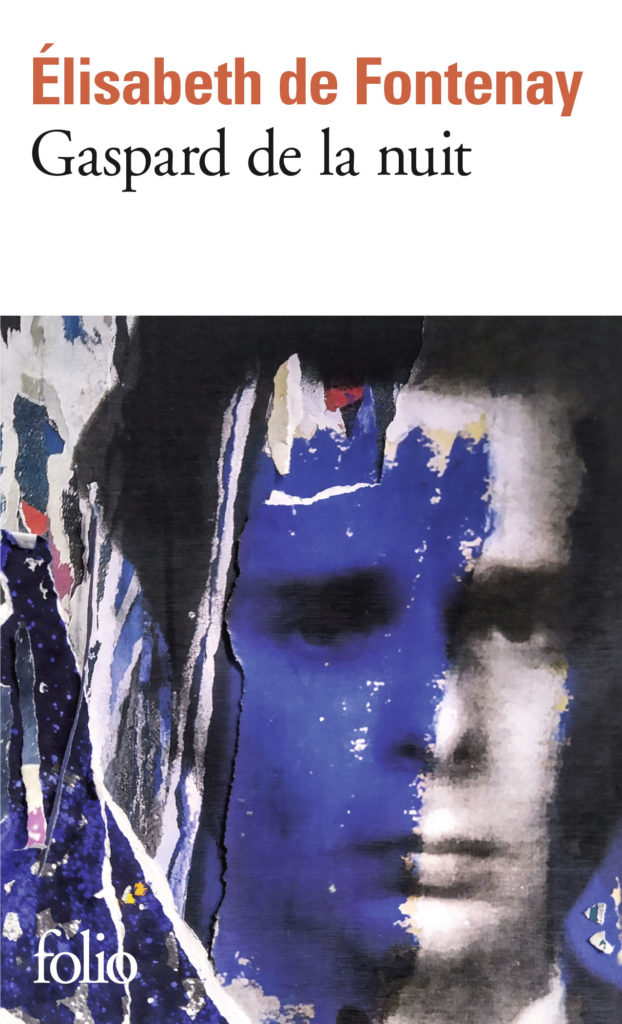Dictionnaire philosophique portatif, 1764.
«Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend ses songes pour des réalités, et ses imaginations pour des prophéties, est un fanatique novice qui donne de grandes espérances; il pourra bientôt tuer pour l’amour de Dieu.
Barthélemy Diaz fut un fanatique profès. Il avait à Nuremberg un frère, Jean Diaz, qui n’était encore qu’enthousiaste luthérien, vivement convaincu que le pape est l’Antéchrist, ayant le signe de la bête. Barthélemy, encore plus vivement persuadé que le pape est Dieu en terre, part de Rome pour aller convertir ou tuer son frère: il l’assassine; voilà du parfait: et nous avons ailleurs rendu justice à ce Diaz.
Polyeucte, qui va au temple, dans un jour de solennité, renverser et casser les statues et les ornements, est un fanatique moins horrible que Diaz, mais non moins sot. Les assassins du duc François de Guise, de Guillaume prince d’Orange, du roi Henri III, du roi Henri IV, et de tant d’autres, étaient des énergumènes malades de la même rage que Diaz.
Le plus grand exemple de fanatisme est celui des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces, la nuit de la Saint-Barthélemy, leurs concitoyens qui n’allaient point à la messe. Guyon, Patouillet, Chaudon, Nonotte, l’ex-jésuite Paulian, ne sont que des fanatiques du coin de la rue, des misérables à qui on ne prend pas garde: mais un jour de Saint-Barthélemy ils feraient de grandes choses.
Il y a des fanatiques de sang-froid: ce sont les juges qui condamnent à la mort ceux qui n’ont d’autre crime que de ne pas penser comme eux; et ces juges-là sont d’autant plus coupables, d’autant plus dignes de l’exécration du genre humain, que, n’étant pas dans un accès de fureur comme les Clément, les Chastel, les Ravaillac, les Damiens, il semble qu’ils pourraient écouter la raison.
Il n’est d’autre remède à cette maladie épidémique que l’esprit philosophique, qui, répandu de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes, et qui prévient les accès du mal; car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir et attendre que l’air soit purifié. Les lois et la religion ne suffisent pas contre la peste des âmes; la religion, loin d’être pour elles un aliment salutaire, se tourne en poison dans les cerveaux infectés. Ces misérables ont sans cesse présent à l’esprit l’exemple d’Aod qui assassine le roi Églon; de Judith qui coupe la tête d’Holopherne en couchant avec lui; de Samuel qui hache en morceaux le roi Agag; du prêtre Joad qui assassine sa reine à la porte aux chevaux, etc. Ils ne voient pas que ces exemples, qui sont respectables dans l’Antiquité, sont abominables dans le temps présent: ils puisent leurs fureurs dans la religion même qui les condamne.
Les lois sont encore très impuissantes contre ces accès de rage: c’est comme si vous lisiez un arrêt du conseil à un frénétique. Ces gens-là sont persuadés que l’esprit saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi qu’ils doivent entendre.
Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant?
Lorsqu’une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable. J’ai vu des convulsionnaires qui, en parlant des miracles de saint Pâris, s’échauffaient par degrés parmi eux: leurs yeux s’enflammaient, tout leur corps tremblait, la fureur défigurait leur visage, et ils auraient tué quiconque les eût contredits.
Oui, je les ai vus ces convulsionnaires, je les ai vus tendre leurs membres et écumer. Ils criaient: « Il faut du sang.» Ils sont parvenus à faire assassiner leur roi par un laquais, et ils ont fini par ne crier que contre les philosophes.
Ce sont presque toujours les fripons qui conduisent les fanatiques, et qui mettent le poignard entre leurs mains ; ils ressemblent à ce Vieux de la montagne qui faisait, dit-on, goûter les joies du paradis à des imbéciles, et qui leur promettait une éternité de ces plaisirs dont il leur avait donné un avant-goût, à condition qu’ils iraient assassiner tous ceux qu’il leur nommerait. Il n’y a eu qu’une seule religion dans le monde qui n’ait pas été souillée par le fanatisme, c’est celle des lettrés de la Chine. Les sectes des philosophes étaient non seulement exemptes de cette peste, mais elles en étaient le remède ; car l’effet de la philosophie est de rendre l’âme tranquille, et le fanatisme est incompatible avec la tranquillité. Si notre sainte religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c’est à la folie des hommes qu’il faut s’en prendre.»