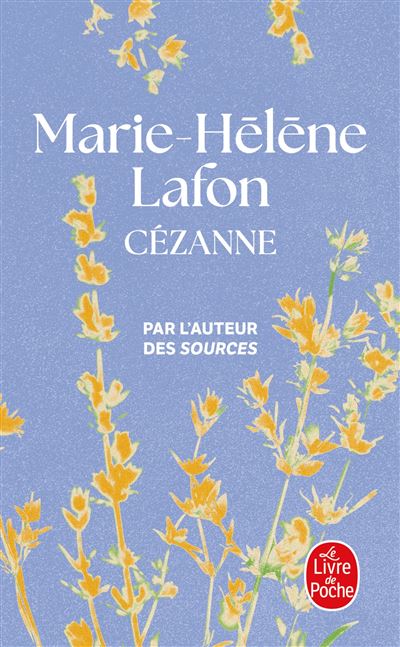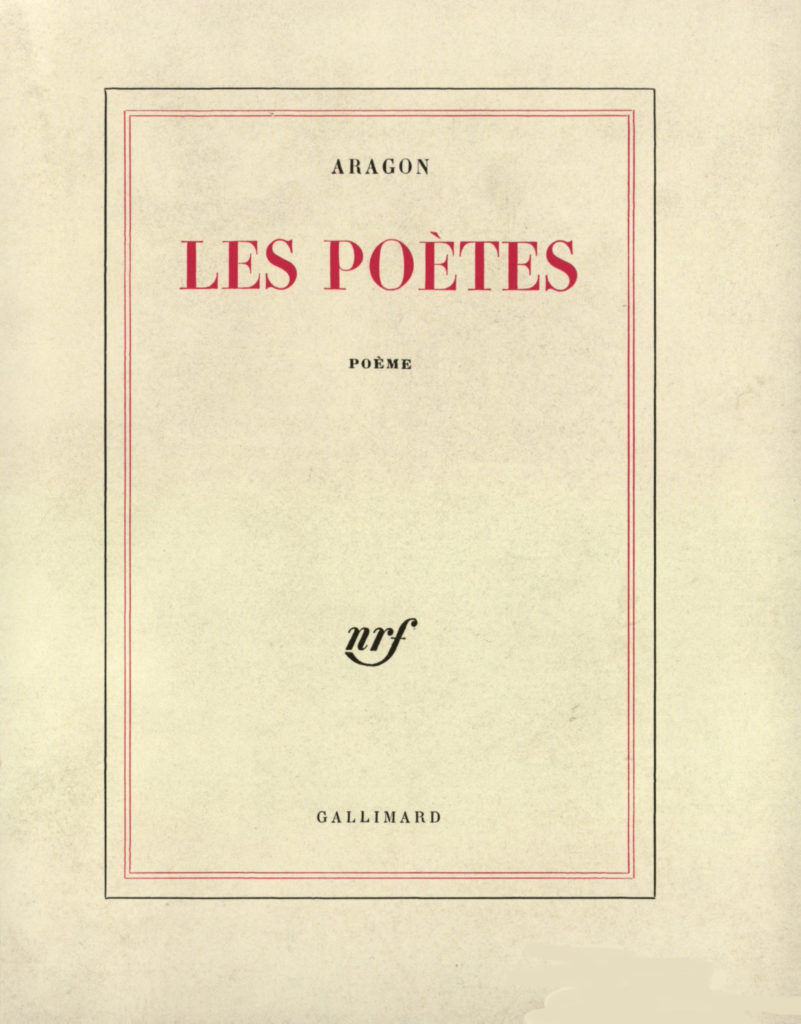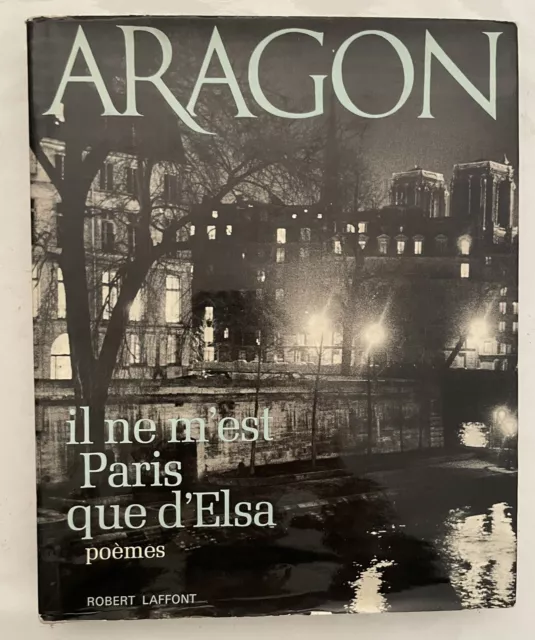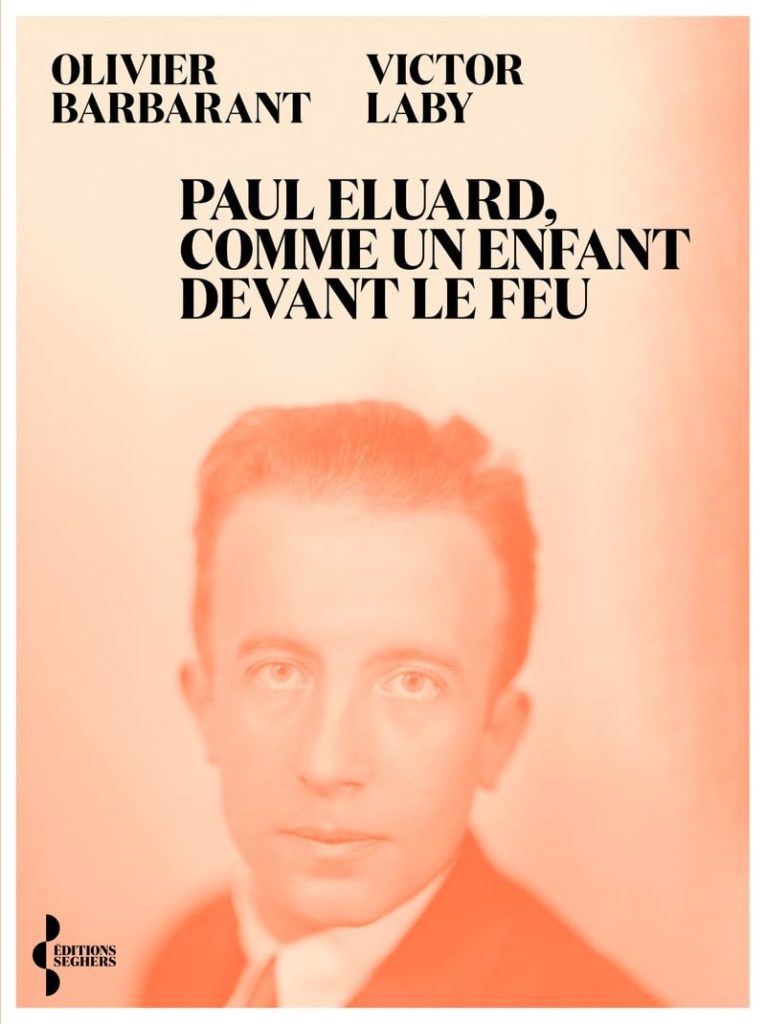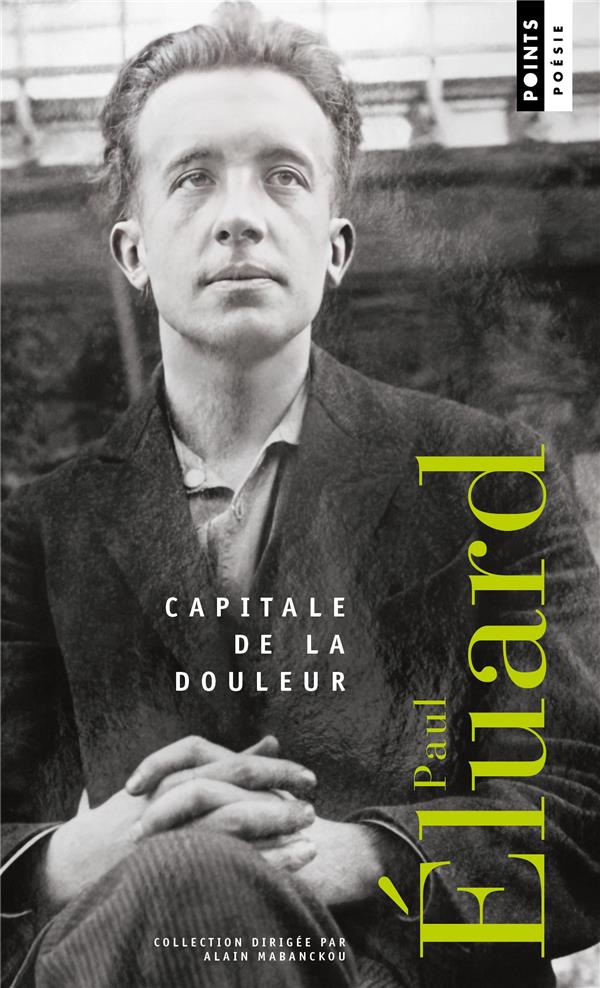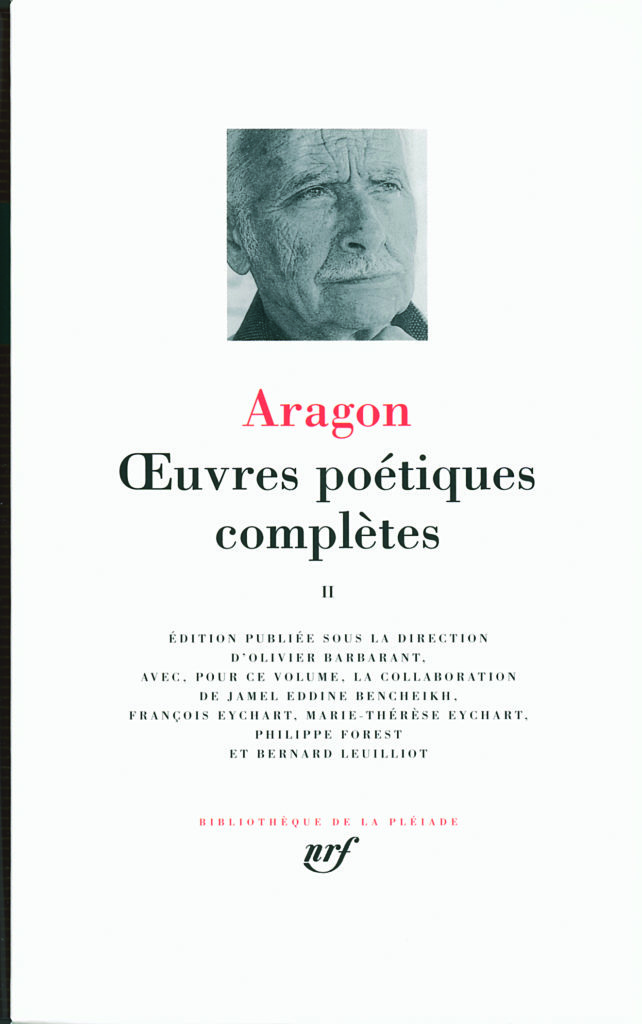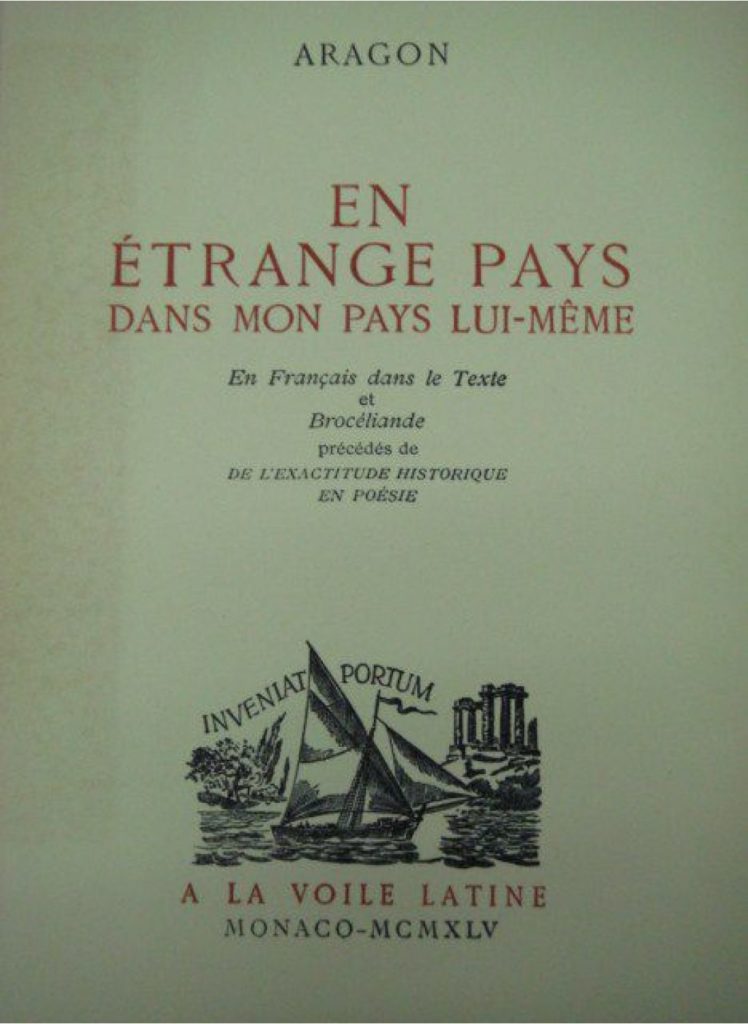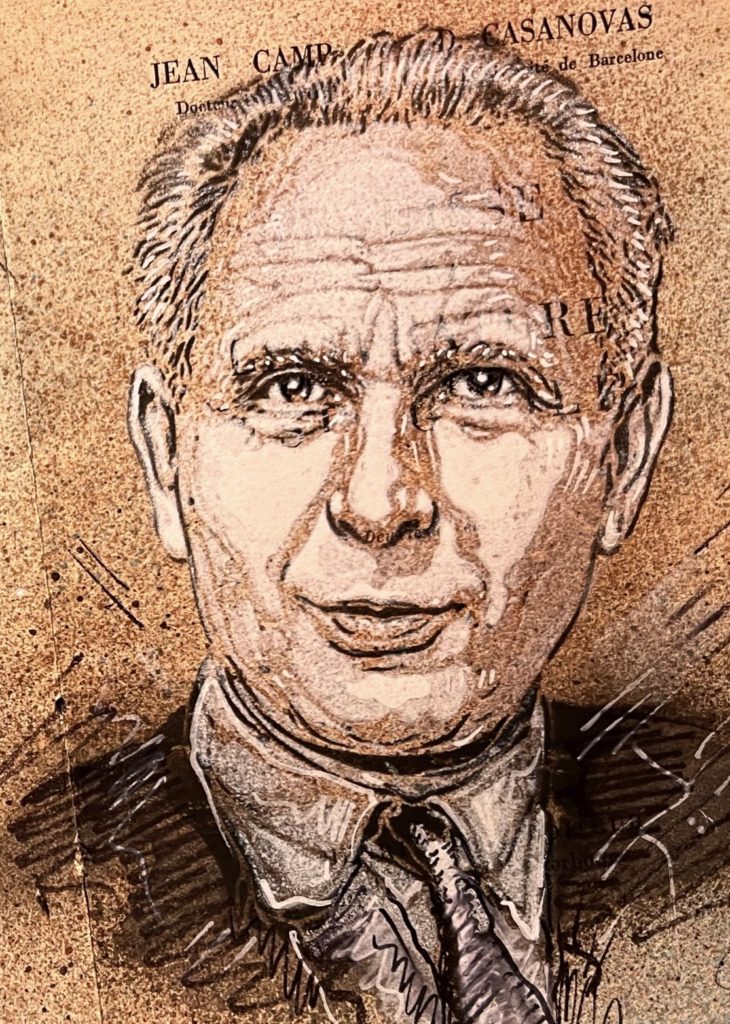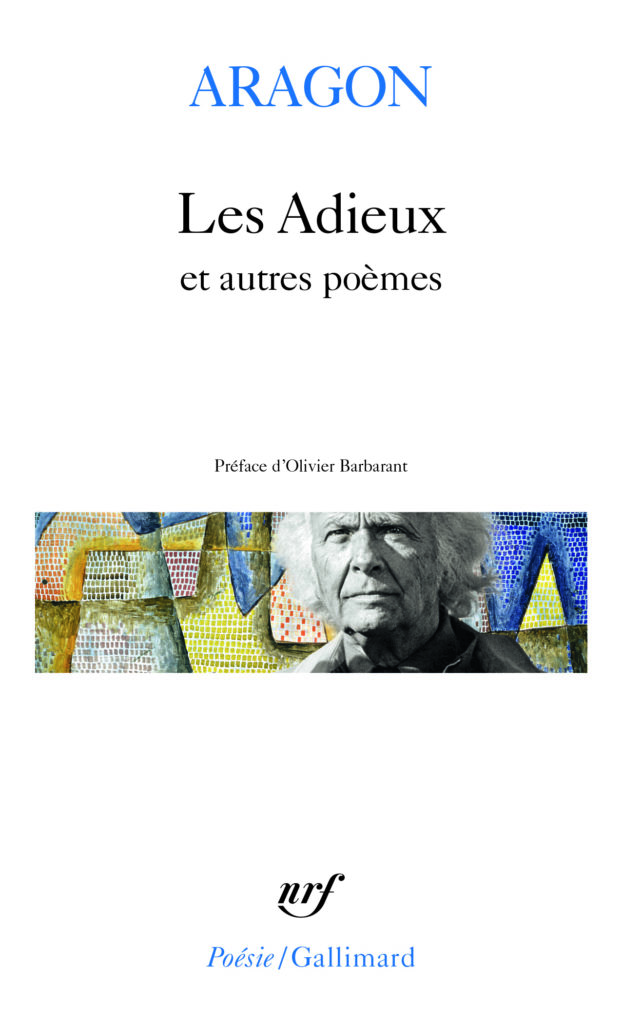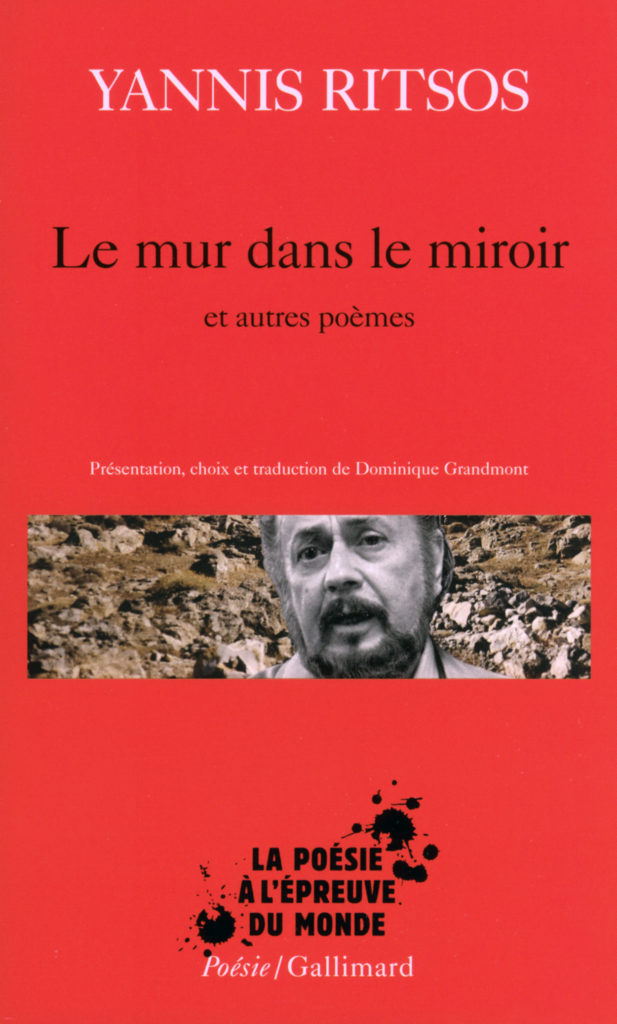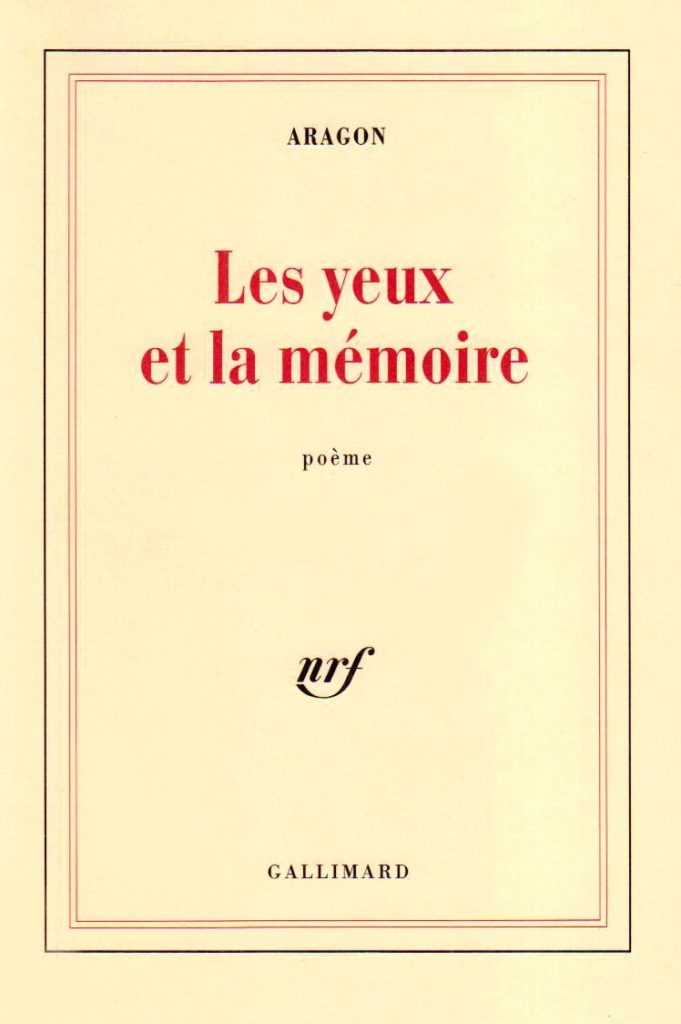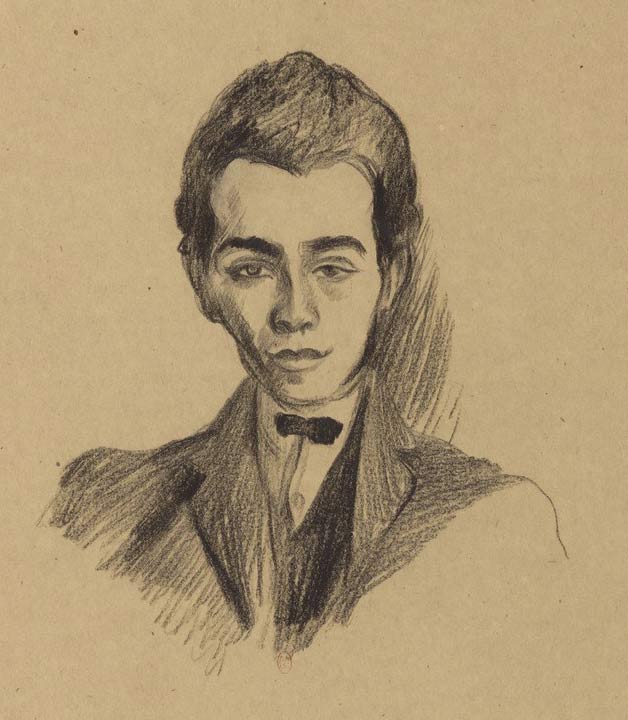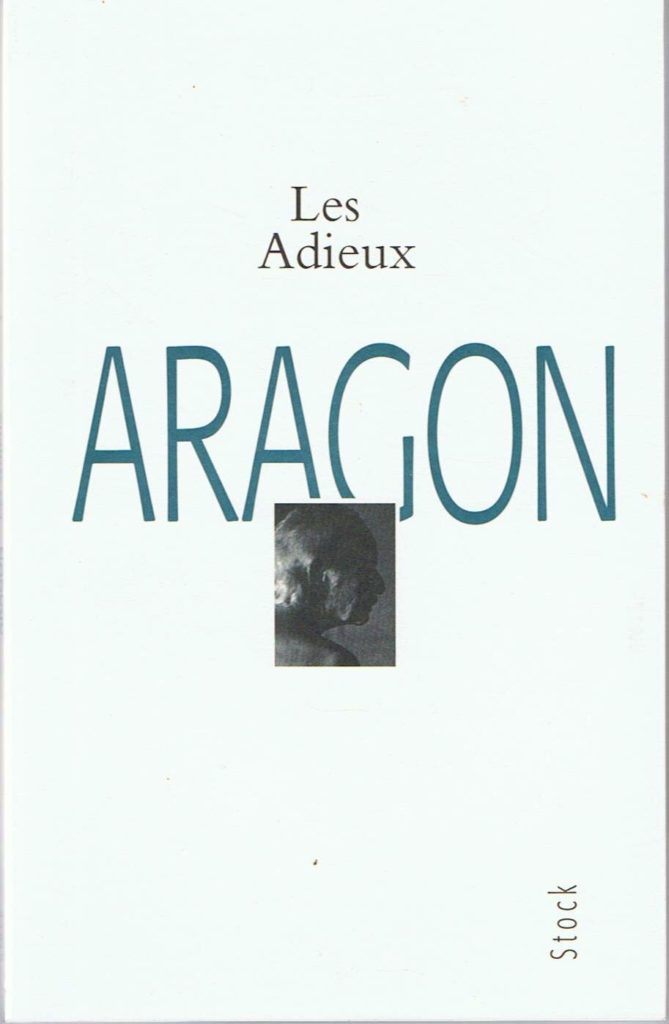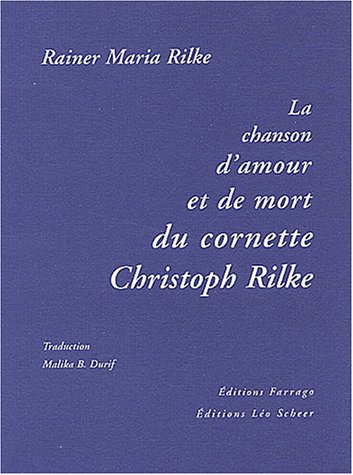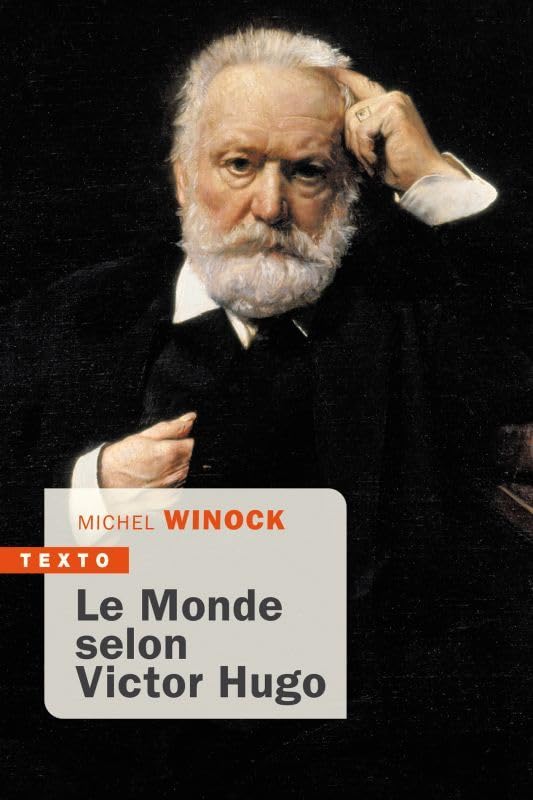
Je relis Victor Hugo et des écrivains qui ont publié sur son oeuvre :
Jusqu’à ce que mort s’ensuive (Sur une page des Misérables) d’Olivier Rolin. Gallimard, Collection blanche. 2024. Folio n°7580. 2025
La tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa. Alfaguara, 2004.
Le Monde selon Victor Hugo de Michel Winock. Éditions Tallandier, 2018. Collection Texto, 2020.
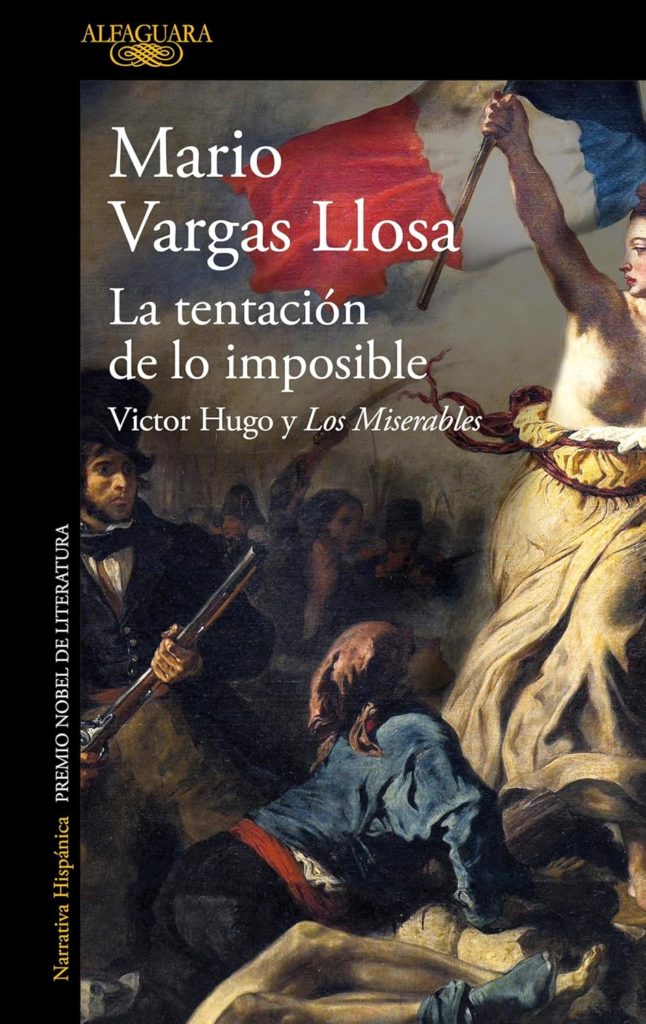
Mario Vargas Llosa. La tentación de lo imposible. 2004.
« Aunque Madame Bovary se publicó seis años antes que Los Miserables, en 1856, se puede decir que ésta es la última gran novela clásica y aquélla la primera gran novela moderna. »
« Las novelas, y sobre todo las grandes novelas, no son testimonios ni documentos sobre la vida. Son otra vida, dotada de sus propios atributos, que nace para desacreditar la vida verdadera, oponiéndole un espejismo que, aparentado reflejarla, la deforma, retoca y rehace. »
« No es precisamente un « entusiasmo » sino un malestar lo que dejan las buenas ficciones en el espíritu de los lectores que contrastan aquellas imágenes con el mundo real : la sensación de que el mundo está mal hecho, de que lo vivido está muy por debajo de lo soñado e inventado. »
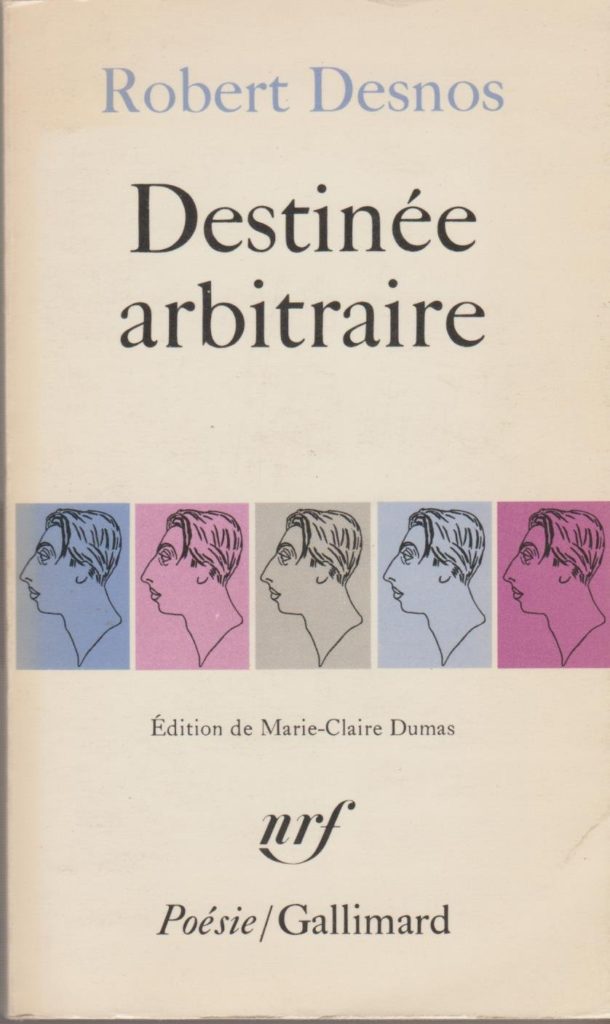
Le legs (Robert Desnos)
Et voici, Père Hugo, ton nom sur les murailles !
Tu peux te retourner au fond du Panthéon
Pour savoir qui a fait cela. Qui l’a fait ? On !
On c’est Hitler, on c’est Goebbels… C’est la racaille,
Un Laval, un Pétain, un Bonnard, un Brinon,
Ceux qui savent trahir et ceux qui font ripaille,
Ceux qui sont destinés aux justes représailles
Et cela ne fait pas un grand nombre de noms.
Ces gens de peu d’esprit et de faible culture
Ont besoin d’alibis dans leur sale aventure.
Ils ont dit : « Le bonhomme est mort. Il est dompté. »
Oui, le bonhomme est mort. Mais par-devant notaire
Il a bien précisé quel legs il voulait faire :
Le notaire a nom : France, et le legs : Liberté.
Signé Lucien Gallois. Paru dans L’Honneur des poètes, 14 juillet 1943. Repris dans Robert Desnos, Destinée arbitraire. Paris, NRF Poésie / Gallimard n°112, 1975.
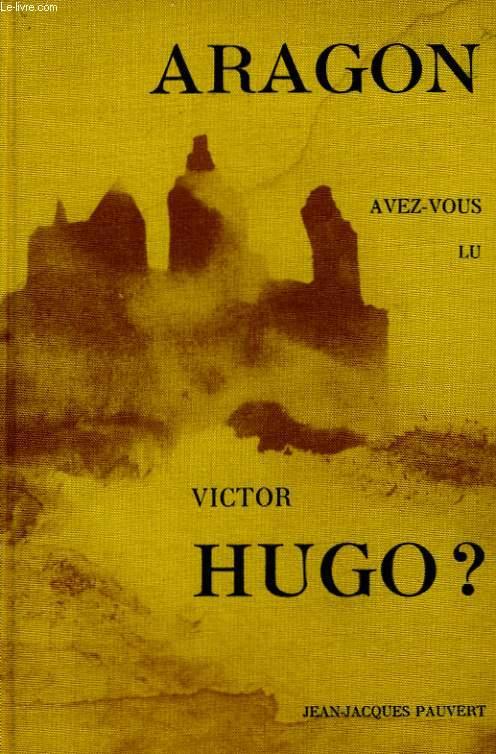
Le Paris de Victor Hugo (Aragon)
Personne n’a jamais parlé de Paris comme Victor Hugo. Et même si un jour, à nouveau, Paris doit se faire verbe et chair dans l’oeuvre d’un poète : Victor Hugo aura été le premier, celui qui a fait naître Paris à la vie lyrique, sacré Paris source et thème de l’inspiration lyrique, décor et matière, âme et personnage de la poésie nationale.
Victor Hugo est le vrai poète de la nation française et le plus grand poète de Paris. Cette vie, cet homme, cet art s’étendent de 1802 à 1885. Hugo naît à la veille de l’Empire et meurt deux ans après Karl Marx. Son œuvre oscille aux vents de ce long orage appelé le dix-neuvième siècle. Elle naît sur les ruines de la Bastille, elle meurt quand les associations ouvrières vont proclamer, avec le Premier Mai, que le printemps leur appartient.
On pourrait justement dire de Hugo qu’il est le miroir de la Révolution Française. Oui, lui, que son général de père traîna dans les fourgons de Napoléon, lui qui fut royaliste sous Louis XVIII, pair de Louis-Philippe, républicain en 48, exilé par le Princе-président, symbole de la liberté sous l’Empire, de la résistance à l’envahisseur dans la guerre de 70, épouvanté par la Commune, mais demandant la grâce des Communards… le génie qui boucha, longtemps après sa mort, l’horizon poétique et qu’aujourd’hui encore haïssent comme personne tous ceux qui s’étiolent à son ombre immense. Hugo, phénomène irréductible, poète le plus insulté de notre histoire, après qui la langue française n’est plus ce qu’elle était, et dont il faudra tenir compte comme de Shakespeare et d’Homère.
Et bien, c’est Hugo qui a fait de Paris ce qu’il est aux yeux du monde. Il ne pouvait pas en être autrement. Avant lui, c’était une bourgade. Dans cette bourgade, il y avait Notre-Dame et Le Louvre. Mais après lui il y a Notre-Dame de Paris et Gavroche, le gamin de Paris. Quant au Louvre, c’est dans ses vers qu’il a cessé d’être un palais pour devenir un monde. C’est qu’avec Hugo, Paris cesse d’être le siège de la cour pour devenir la cité d’un peuple. Le Paris de Victor Hugo n’est pas une collection de monuments, une série de cartes postales, mais l’être en mouvement, le monde en gésine, les quartiers bourgeonnants du siècle qui fut celui des révolutions, des émeutes, des chemins de fer, du préfet Haussmann, de la Commune de Paris. Il y a une anthologie formidable à faire de tout ce que Hugo a écrit de Paris, sur Paris, pour Paris. Juste pour donner le goût de ce langage insensé, de cet amour sans mesure pour la ville démesurée. Il était trop facile d’étourdir les gens avec le bruit majeur des vers, toute L’Année terrible, et des Contemplations aux Feuilles d’automne, tout ce qui résonne dans ce langage divin de ma ville… Et même dans la prose je n’ai pas repris ces passages des Choses vues, où Balzac agonise dans sa maison du quartier Beaujon, où tout Paris regarde passer les cendres de l’Empereur… Son commentaire monumental et immortel fait de Victor Hugo la statue toujours présente de Paris, l’explication de Paris, son prestige, sa résonance, sa gloire.
Avez-vous lu Victor Hugo ? Anthologie poétique commentée par Aragon. Paris, Éditeurs Français Réunis, 1952.